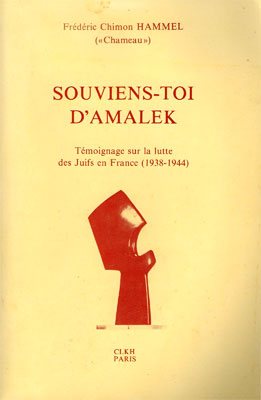 Des bruits circulent, insinuant qu'en cas de mobilisation, toutes les agglomérations
et notamment la ville de Strasbourg situées devant ou dans la Ligne Maginot seront évacuées. Le repli de l'Université est également prévu. Des professeurs prévoyants louent des logements
dans la ville que désignent ces rumeurs. Beaucoup de familles font de même.
Des bruits circulent, insinuant qu'en cas de mobilisation, toutes les agglomérations
et notamment la ville de Strasbourg situées devant ou dans la Ligne Maginot seront évacuées. Le repli de l'Université est également prévu. Des professeurs prévoyants louent des logements
dans la ville que désignent ces rumeurs. Beaucoup de familles font de même.
Mon beau-frère Roger a l'heureuse idée de louer une petite maison de vacances
au Mont-Dore, dans les Monts d'Auvergne.
Le 23 août 1939 les Allemands signent avec l'U.R.S.S. le fameux "Pacte de non-agression. Sans nul doute, on en est arrivé au point de non-retour. La guerre est inévitable. Strasbourg se vide de ses habitants. Je reçois des instructions pour emballer les appareils de valeur en vue de leur évacuation éventuelle et de fermer le labo.
Quelques jours avant l'invasion de la Pologne (1er septembre),
le Secrétaire de la Faculté des Sciences me fait dire que "si
je veux revoir les miens avant la guerre" je dois les rejoindre au plus
vite et qu'il me décharge de mes responsabilités. Inutile de
me le dire deux fois.
Au Mont-Dore, la famille s'est installée tant bien que mal. La maison est très
petite.
Mon séjour
est de courte durée. Au bout de deux jours apparaissent sur tous
les murs de France les affiches surmontées de deux petits drapeaux tricolores
entrecroisés annonçant la mobilisation générale. Mon fascicule
de mobilisation dit que je dois me présenter au Centre Mobilisateur du
Fort de Vincennes, à Paris, le deuxième jour. A l'encontre
d'une tradition bien établie, l'armée française décide
d'utiliser les compétences : une unité de chimistes est constituée.
Je suis devenu "ouvrier d'artillerie".
Le vendredi 1er septembre, jour de l'invasion
de la Pologne par soixante-dix divisions allemandes (dont sept blindées),
je prends, le coeur gros, le train Mont-Dore-Paris, persuadé que je trouverai
la ville sous les bombardements. Au contraire de 1938, je suis calme. Les nazis
montrent en Pologne ce dont ils sont capables et pourtant je n'ai pas
peur comme dans la caserne de Haguenau.
Mes prévisions sont erronées ; le calme règne à Paris, ce 2 septembre
1939. Pas un avion, même pas de mesures de protection. Au Fort de Vincennes,
par contre, il y a grand remue-ménage.
Je trouverai facilement mon centre mobilisateur. On me déguise en soldat. Cette fois
non plus, aucune distribution d'armes. Par contre, le port du masque à
gaz est obligatoire pour les militaires et pour tous les civils. Je reçois
l'ordre de me rendre "par mes propres moyens" au Palais de la
Mutualité. N'étant ni Parisien, ni syndicaliste, je n'ai
aucune notion ni de ce que c'est, ni où c'est. Il s'agit
d'une grande bâtisse située en plein Quartier Latin, mi-salle
de congrès, mi-théâtre, avec annexes et bureaux. La Mutualité
est réquisitionnée pour l'unité de chimistes de l'armée
française.
Il y a cependant une exception à ce manque de contact entre compagnons : André Ferré, Professeur de lycée à Limoges, socialiste antifasciste, souffre d'être séparé de sa femme et que soit utilisée la force pour régler les conflits entre nations. Nos idées sont très proches et, depuis lors, nos rapports se sont poursuivis.
Notre vie n'a
rien de bien militaire. Des gradés nous font des conférences de temps
à autre. Je ne veux pas prendre mes repas à la Mutualité. Le
premier jour, dimanche 3 septembre, il n'y a pas encore de garde ; j'en
profite pour prendre dans une pâtisserie une tasse de thé en guise
de déjeuner. C'est là que j'entends les informations de
midi : l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à
l'Allemagne. L'émotion est grande, et pourtant, depuis
des semaines, cette guerre paraît inéluctable.
Le lendemain,
première alerte aérienne à Paris. On n'entend ni avions,
ni canons anti-aériens. De nombreux bureaux fonctionnent encore à
la Mutua1ité. Les employées s'affolent et cherchent en vain
un abri. Je profite de la pagaille pour sortir et pour chercher, dans les environs,
un restaurant où je prendrai mes repas sans trop enfreindre nos lois alimentaires.
Dans la rue
des écoles, je tombe en arrêt devant un tout petit restaurant
à l'enseigne de la "Crémerie Le Pélican". Quelques plats exposés à la devanture semblent confirmer
la dénomination. Mais je me rends très rapidement compte que l'on sert volontiers dans ladite "crémerie" des beefsteaks bien saignants.
La fin de l'alerte vient de sonner; l'endroit est encore vide. Ne s'y trouvent que deux
propriétaires, deux jeunes femmes complètement affolées; les
voyant en plein désarroi, je leur propose de les aider. Elles me prieront…
d'écrire les menus, pour qu'elles puissent terminer la préparation
des plats. Malgré mon horrible écriture, elles sont satisfaites
de mon travail ; lorsque je veux payer la semoule au lait-compote de pruneaux
commandée, elles refuseront d'accepter l'argent du militaire
qui les a dépannées. Entre temps, la petite salle à manger s'est
remplie d'employés de bureau tous très pressés de retourner
à leur travail; et je comprends qu'il faut que tout soit prêt
à l'heure. A partir de ce jour, je deviendrai le "secrétaire"
du Pélican. Je fais des économies : sur les deux plats que je consomme,
je n'en paie qu'un seul.
Comme tous les ressortissants allemands, Arthur Fleischer, le chef de famille, est interné dans un camp de prisonniers civils, ce qui prive la famille de ressources. Dès la déclaration de guerre, tous les porteurs de passeports allemands seront internés. Aucune différence n'est faite entre sympathisants nazis et réfugiés politiques ou juifs. Ces derniers pourront s'engager dans la Légion étrangère.
Le deuxième foyer qui m'accueillera d'une façon émouvante est celui de la famille Donoff. C'est
la bonne vieille hospitalité juive, doublée d'une grande
sympathie pour le mouvement E.I.F. Tous les enfants de la famille sont éclaireurs.
Les parents Donoff, venus tout droit du "chtettel", espèrent trouver dans
le Mouvement un milieu susceptible de garder leurs enfants dans une ambiance
juive dont, hélas, la plupart des organisations et institutions juives
de Paris sont dépourvues. Si je dis "venus tout droit du chtettel", il ne faut pas le prendre
au pied de la lettre. Les Donoff habitent le quartier du "Pletsel"
(1) depuis bien des années. La majorité de leurs enfants sont nés
à Paris.
C'est mon premier contact avec un judaïsme que la vie moderne n'a pas frelaté. Le père
est chef de famille. Les enfants et sa femme lui vouent un profond respect.
Le père Donoff a une opinion sur tout. C'est parfois un mélange
très pittoresque d'enseignements du Talmud, de superstitions
folkloriques, de philosophie russo-personnelle et de bon sens. Cette vision
originale s'applique à tous les domaines de la vie: éducation,
morale, religion, politique, médecine, économie, justice, etc...
etc...
Les récits
du père Donoff sur sa jeunesse me passionneront et me révéleront
tout un monde juif inconnu, ce qui facilitera beaucoup la compréhension
du ‘Hassidisme qui, grâce à Martin Buber, est à l'origine
de ma découverte du judaïsme.
La famille
Donoff paiera un tribut terrible à la guerre : Robert, qui travaillera
pour la Sixième, sera pris à Chambéry avec sa femme Nelly, enceinte.
Ils ne reviendront pas. David sera mortellement blessé par la Gestapo
en essayant de s'enfuir d'un bureau d'aide aux Juifs.
Appelé chez le capitaine,
il m'apprend qu'avec cinq autres chimistes de notre compagnie
je dois me rendre à la Poudrerie du Bouchet. Je n'ai pas la moindre
notion de ce qu'est cette poudrerie, ni où elle se situe. Mes compagnons,
tous universitaires de la Région parisienne, m'expliquent que c'est
un immense laboratoire préparant la guerre des gaz, situé à
une quarantaine de kilomètres au sud de Paris.
Le 19 octobre
1939, nous nous présenterons au colonel Kovache, commandant de la Poudrerie,
et il nous affectera à l'un des nombreux laboratoires. Tout cela
va si vite que je n'ai guère le loisir de réfléchir. J'observe,
cependant, la contradiction entre ce qui se fait dans cette poudrerie et les
conventions internationales. L'ennemi que l'on combat n'en
tient aucun compte. Pourtant, je suis bien décidé à ne pas travailler
pour préparer la guerre des gaz. Je me demande avec anxiété
quelle doit être mon attitude, lorsque le colonel m'apprend que je
suis affecté au laboratoire de protection.
Une fois de
plus la Providence est intervenue : je n'ai plus à prendre de
décision.
Le bâtiment
de "la Protection" est une construction basse et longue, au
bord d'un des canaux traversant la Poudrerie (sans doute pour des raisons
de sécurité). Le labo est dirigé par le lieutenant des poudres,
Renaud, qui me reçoit gentiment. Son service se divise en plusieurs
parties: masques et vêtements de protection, détection, ypérite
et recherche. Habitué au travail de laboratoire, je suis affecté
à la recherche.
Ce labo est
dirigé par Raymond Dru, un civil assez original. Ses connaissances professionnelles
sont remarquables. Méticuleux et ordonné à l'extrême,
il doute des résultats de ses collaborateurs moins méticuleux que
lui. Mon patron de thèse avait la même attitude et je ne suis pas
gêné outre mesure. Une grande différence, cependant, entre le
Patron et Dru. Ce dernier est d'une politesse presque exagérée.
Il s'exprime avec beaucoup de finesse. Son écriture, très nette,
très belle, à très gros traits, dénote son originalité.
Très soigné, il porte une barbe en collier, ce qui à cette époque
"fait artiste". La moindre poussière sur ses vêtements le met hors
de lui. Au labo, il couvrira ses cheveux avec une calotte blanche "à
la Pasteur". Son humour tout à fait particulier et mordant dégénère quelquefois
en ironie.
Mes rapports avec Dru sont excellents. En dehors du travail, il me parle de sa femme et
de sa fille. Il est violemment antireligieux (Oh ! vous, avec votre Bon Dieu
!…).Toutefois, il ne trouvera jamais à redire lorsque j'observe le Chabbath à ma façon
: autant que possible, je ne fais pas de travail pratique ; je lis les publications
professionnelles.
Le groupe d'ouvriers
d'artillerie envoyés de la Mutualité à la Poudrerie du
Bouchet n'a de militaire que l'uniforme. Logés chez l'habitant,
ils ont toutes les libertés, travaillant aux mêmes heures et dans
les mêmes conditions que les employés civils. Tous les matins, nous
parcourons ensemble les deux ou trois kilomètres séparant Vert le
Petit de la Poudrerie.
Mes camarades sont Pierre, le taciturne, Paul, insatisfait et mécontent de tout; Jacques
dit ouvertement qu'il déteste les Juifs.
Pendant ce trajet matinal, nous parlons de la situation. C'est la "Drôle
de Guerre ". Personne ne comprend le calme régnant au front. Beaucoup croient que ce ne sera
jamais une vraie guerre. Mes camarades sont d'un autre avis. Ils disent : "cela ne vaut pas la peine de faire la guerre pour les Juifs
". Ce sera pour moi le coup de massue ! Qu'en Alsace, province frontière, la propagande hitlérienne
ait trouvé des oreilles plus qu'attentives est choquant ; l'histoire
montre que les Alsaciens sont volontiers du côté de ceux qui ne les
gouvernent pas. Mais que des universitaires parisiens n'aient pas compris,
en 1940, que la France est autant menacée que les Juifs, dépasse
mon entendement.
Un fait nouveau normalisera nos rapports. Le
colonel commandant la Poudrerie convoque un jour chez lui les militaires
qui ont donné satisfaction pour leur proposer de les faire passer du statut
de militaire à celui d'affectés spéciaux. Jacques et moi
en sommes. Jacques a dit à plusieurs reprises qu'il veut quitter
la Poudrerie pour aller dans une unité combattante.
A mon tour,
je me présente au bureau du colonel. Le règlement exige le "garde-à-vous". Le colonel ayant oublié
de dire "repos ", toute la
conversation se déroulera au garde-à-vous. Le colonel m'expliquera
que j'ai intérêt à devenir "affecté spécial"
; qu'en particulier, je serai à l'abri d'un éventuel
envoi au front. Je remercie, et ajoute que je ne peux accepter sa proposition.
- Le Colonel : Nous tenons à vous conserver. Pourquoi ce refus?
- Moi : Parce que je suis Juif, mon colonel.
- Le Colonel : Je ne comprends absolument pas. Il n'y a aucun rapport.
- Moi : Je tiens à suivre le sort de ma classe d'appel.
Je ne veux pas qu'une fois la guerre terminée, on dise : Voyez comme
les Juifs se sont planqués.
- Le Colonel : Je respecte votre décision, mais je ne vous approuve pas.
Bien entendu, Jacques me demandera, à ma sortie du bureau, quelle est ma décision.
Je lui fais le récit de notre conversation. A partir de ce jour,
il me traitera avec un certain respect.
Le soir, j'écris
des lettres. D'abord à ma femme, qui les transmettra à
mes parents, ensuite aux E.I.F. de Strasbourg. Très vite, j'établirai
la liste presque complète des Éclaireurs et des Éclaireuses
de la ville, disséminés dans toute la France. A cette époque,
j'aurai pour la première fois l'idée d'une "lettre collective". Mon record sera de 28 ou 29 lettres
(à la main !) en un seul dimanche. Je reçois des réponses très
nombreuses et très intéressantes. Naturellement, cette correspondance
sera bouleversée par la deuxième migration due à la Débâcle.
J'ai les adresses de près de 200 E.I.F. avec lesquels je suis en liaison épistolaire régulière.
Jusqu'au 10 mai, nos dimanches seront libres et nous en profiterons pour aller
à Paris, les liaisons par cars étant excellentes. Je peux ainsi prendre
contact avec les responsables des E.I.F. et revoir certains amis au hasard
de leurs permissions.
Je n'ai jamais encore donné le Séder, et n'ai pas eu le temps de m'y préparer ; cette fois-ci, pas d'autre solution. Je suis le seul de la famille pouvant le donner. Par la force des choses, il deviendra ce qu'il devrait toujours être, un Séder pour les enfants. Autour de la table, ils sont aussi nombreux que les adultes. Les questions fusent. Pharaon devient Hitler et Hitler Pharaon.
Tout à coup Evi, petite intellectuelle de sept ans, demande :
- Pourquoi est-ce que Pharaon a fait tuer justement les garçons?
- Parce qu'il faut un père, et que s'il n'y
a plus de père, il n'y a plus d'enfants.
- Mais s'il n'y a pas de mère, il n'y a pas non plus d'enfants.
- Oui, mais les hommes nourrissent la famille.
- Les femmes aussi.
- Et les hommes seront des soldats qui pourront attaquer les Égyptiens.
- Et Jeanne d'Arc, alors ?
- .......
Le frère d'Evi, Elie (six ans),
n'est pas intervenu; mais en se couchant, après la cérémonie,
il dit à sa mère:
- Je me réjouis quand je serai mort.
- Que veux-tu dire?
- Quand je serai au Paradis, je rencontrerai Pharaon et je lui casserai la gueule...
Pendant cette permission, nous nous promènerons beaucoup. Le temps est au beau fixe. Le Puy de Sancy a encore beaucoup de neige. Plus bas, fleurissent les soldanelles et les crocus. Dans un bosquet de hêtres, nous trouverons un véritable tapis de perce-neige. C'est la seule fois de ma vie que j'en trouve à l'état sauvage. Plus loin des champs de jonquilles sont en pleine floraison. Pour la première fois, j'essaierai de photographier des fleurs. Ces photos oh ! combien maladroites existent encore dans un de nos albums.
(1) Quartier de la rue des Rosiers et plus spécialement
Place des Hospitalières Saint-Gervais. Retour au texte
 |