 Dans un passage émouvant
des Frères Karamazov, Dostoïevski
raconte comment le petit Ilioucha, qui va mourir, propose à son père,
le capitaine Sniéguiriov, une ultime consolation : "quand je serai
mort, prends un bon garçon, un autre ;
choisis le meilleur d'entre eux, appelle-le Illioucha et
aime-le à ma place..." Mais Sniéguiriov s'écrie d'un
ton farouche, en éclatant en sanglots : "Je ne veux pas de bon garçon,
je n'en veux pas d'autre... Si je t'oublie,
Jérusa/em, que ma langue reste attachée..."
Dans un passage émouvant
des Frères Karamazov, Dostoïevski
raconte comment le petit Ilioucha, qui va mourir, propose à son père,
le capitaine Sniéguiriov, une ultime consolation : "quand je serai
mort, prends un bon garçon, un autre ;
choisis le meilleur d'entre eux, appelle-le Illioucha et
aime-le à ma place..." Mais Sniéguiriov s'écrie d'un
ton farouche, en éclatant en sanglots : "Je ne veux pas de bon garçon,
je n'en veux pas d'autre... Si je t'oublie,
Jérusa/em, que ma langue reste attachée..."
Ainsi l'auteur russe, nourri de Bible, a-t-il admirablement exprimé l'idée qu'aucune chose au monde ne saurait évoquer le thème de l'irremplaçable autant que Jérusalem.
Or, cet entrelacement de Jérusalem et de l'Irremplaçable, aucune conscience humaine ne le ressent avec autant de force obstinée et de poignante évidence que la conscience même qui en fit la découverte sur les bords des fleuves de Babylone et qui, depuis, sans interruption, ni suspension, ni pause, ni parenthèse, l'éprouve, le proclame, le chante et le crie tout au long de l'histoire : la conscience juive.
Car la conscience chrétienne a trouvé, très tôt, une autre Jérusalem à Rome et au Ciel ; la conscience musulmane, elle aussi, en a, dès son éveil, construit une autre à la Mecque et à Médine; et la conscience agnostique, enfin, en a édifié d'autres à Paris, à New-York, à Moscou ou à Pékin.
Seuls les juifs, bien avant qu'il n'y ait des Chrétiens, des Musulmans, des fidèles d'un troisième testament, ont refusé d'en vouloir une autre, et, depuis, avec une constance aussi farouche que celle de Sniéguiriov, persistent dans leur refus de remplacer Jérusalem, fût-elle ruine et poussière, par une autre Jérusalem, fût-elle céleste ou édénique.
 Je n'en
veux pas d'autre, se sont-ils écriés,
les Juifs, dans les amers sanglots des nuits et dans les timides lueurs des
aubes, je n'en veux pas d'autre,
a-t-il grincé des dents, le Juif, à moins qu'il
n'esquissât un sourire amer, chaque fois que sur la route de son
Exil, quelqu'un lui proposait l'échange, la halte définitive
et apaisante en une Jérusalem autre que celle qui, là-bas, sur son
rocher, paraissait bien morte et ne pouvait plus lui offrir que les pierres
d'un Mur vieillissant, dont bientôt on allait, de surcroît,
lui interdire l'accès.
Je n'en
veux pas d'autre, se sont-ils écriés,
les Juifs, dans les amers sanglots des nuits et dans les timides lueurs des
aubes, je n'en veux pas d'autre,
a-t-il grincé des dents, le Juif, à moins qu'il
n'esquissât un sourire amer, chaque fois que sur la route de son
Exil, quelqu'un lui proposait l'échange, la halte définitive
et apaisante en une Jérusalem autre que celle qui, là-bas, sur son
rocher, paraissait bien morte et ne pouvait plus lui offrir que les pierres
d'un Mur vieillissant, dont bientôt on allait, de surcroît,
lui interdire l'accès.
Je n'en veux pas d'autre, car jamais l'exil n'a été pour moi une marche déboussolée ou forfuite ; jamais dans les pires fuites je n'ai été un nomade sans repères ; jamais, que ce fût sur les bûchers ou dans les cendres dispersées au hasard des vents. Chacun de mes pas avait un sens ; jamais je n'ai été le Juif Errant, car j'ai toujours été le Pélerin de Jérusalem. Chacune de mes errances était orientée : jamais je n'ai été l'Installé, car mes prières, mes offrandes, mes nostalgies et souvent mes pas faisaient de moi le perpétuel Amant de Sion. Chacun de mes martyres était un sacrifice, car le rêve inépuisable de mon peuple transférait la plus humble, mais aussi la plus douloureuse de mes cendres au Mont des Oliviers.
Ainsi l'Exil lui-même était-il une route, la route du retour àJérusalem.
Et maintenant que cette route m'a amené à Jérusalem, maintenant que cette route a pour nom Israël, et qu'elle existe, là-bas, édifiée, bordée de larmes et de rires, d'arbres et d'êtres humains aussi nombreux que les millions d'irremplaçables qui n'avaient d'autre nom sur leurs lèvres en vivant et en mourant que celui de Jérusalem, maintenant que Jérusalem n'est plus le symbole de l'Irremplaçable, mais qu'elle en est ma réalité, maintenant vous voudriez que moi, Juif, j'en aime une autre, j'en veuille une autre, j'en accepte une autre ?
Photographies : © Shaul Lévy, Michel Rothé
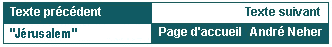
 |