Les sous-titres sont de la Rédaction du site
| Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits... Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions religieuses... Déclaration des Droits de 'Homme et du Citoyen. ... Nos deux nations amies et alliées ... |
Devant quiconque, n'étant pas Russe, prétend s'aventurer dans l'Empire des Tsars, un mur s'élève, imposant et rébarbatif. On persiste à enseigner aux enfants que la Russie est un État d'Europe : il faut pourtant moins de visas, de sceaux et de contreseings pour fonder un comptoir à Santiago ou faire sa fortune à la Bourse de Johannesburg, que pour passer une nuit d'hôtel à Varsovie. Le titre de citoyen français, qui devrait, à lui seul, assurer à tous ceux qui le portent, dans leurs relations avec l'étranger, un égal respect et un traitement égal, est de nul effet sur les représentants de l'administration russe en France indépendamment, si je puis dire, de son support confessionnel; et il y a vraiment quelque étrangeté à n'avoir jamais fait valoir, aux yeux de la chancellerie amie et alliée, la dignité de ce titre, qui se suffît à lui-même. Je sais la modestie de ma protestation, et sa probable inefficacité ; mais je l'estime nécessaire; aussi bien une protestation vaut-elle par elle-même, par la raison, par le droit sur lequel elle se fonde.
On acclame la France, mais, quand les jours de liesse sont passés, que les délégations chamarrées se sont évanouies avec la fumée du Champagne, on l'arrête à la frontière, comme les autres nations, peut-être un peu plus que les autres, étant plus représentative de la liberté : l'esprit français n'est pas article d'importation. Donc, même Français, et même catholique, l'étranger, suspect par définition, n'entre sur le territoire russe que s'il a été dûment étiqueté et parafé au départ. Mais, s'il est protestant, surtout s'il est juif, il faut qu'il ait l'âme chevillée au corps pour ne pas laisser toute espérance à la porte du Consulat Général : car c'est là, - pour le Parisien du moins, - que se joue le prologue de tout voyage en Russie. "Vous avez votre passeport ?... Vous vous appelez ?... Ah ! vous êtes ...Israélite ?
- Oui, Monsieur.
- Alors...
- …?...
- Alors, il faut vous procurer un certificat du chef de la maison pour laquelle vous partez, constatant que vous êtes bien à son service, et dont la signature doit être légalisée par le commissaire de police de son quartier. Il vous faut aussi une carte de légitimation, comme celle-ci... (et le fonctionnaire vous montre négligemment un spécimen de cette carte, au nom de M, Mayer Lehmann ou de M. Salomon Lévy...). Cette carte doit vous être délivrée par la Chambre de Commerce, avec légalisation de la signature du chef de maison, plus le visa légalisé et le cachet du Président de la Chambre de Commerce…"
Vous avez remarqué cet alors ? - compris tout ce qu'il signifie de démarches, de pourparlers, de vexations, de témoins à produire, de signatures à solliciter, - mieux encore, entrevu tout ce qu'il recèle, dans un État autocratique et religieux, de misères et d'iniquités.
![]()
Kichinev
![]()
De Jassy à Kichinev - il n'y a pas cent ans que les deux villes sont séparées par une frontière politique - c'est le même pays qui se continue, l'immense plateau qui s'étale sous la brûlure du soleil. Après quatre heures d'un roulement lent et d'interminables arrêts, on aperçoit enfin, dominant les rues sableuses et les petites maisons basses qui dévalent jusqu'au bord de la voie, des tours et des clochers, de lourdes coupoles blanches et vertes, des pâtés de pierres éclatant au soleil, tout l'appareil d'une grande ville : à dix mètres du train, dans un sentier qui borde les blés, par une attention symbolique du hasard, un paysan moldave bouscule une femme et la frappe à tour de bras : c'est Kichinev.
Il faut bien avouer qu'en France on ne connaissait pas le nom de Kichinev, il y a un an (plût à Dieu qu'il ne fût pas sorti de son obscurité !), qu'avec nos habitudes d'esprit un peu casanières nous ne pouvions pas très bien nous représenter ce qu'est l'aspect d'une ville de cent mille habitants - en Bessarabie -, et qu'enfin nous avions de la peine à concevoir que la localité inconnue naguère où se passèrent hier tant d'horreurs sauvages fût ce qu'on appelle une grande ville.
C'est donc avec une émotion où le piquant de l'impression présente se mêle au tragique du souvenir qu'on met le pied sur le quai d'une grande gare, qu'on traverse un buffet très élégant, avec nappes, services, vins et sodas à l'européenne, qu'on trouve devant la gare, après quelques touffes de verdure qui égaient gentiment la monotonie du sable, un tramway aussi confortable - ni moins ni plus - que ceux de nos petites villes françaises, et auprès duquel, en attendant le départ, un gamin crie ses journaux à vendre.
Le tramway suit de larges rues toutes droites que coupent à angles droits d'autres rues également droites et larges : cette ville barbare - elle fut turque jusqu'en 1812, et depuis elle est russe -, est bâtie comme par principes, à la manière de New-York ou de Buenos-Ayres, et sa symétrie rappelle celle des blocs américains. D'élégantes troïkas aux chevaux ardents, de hautes maisons avec de grandes fenêtres et de petits balcons, d'importants magasins très européens d'apparence, banques et pharmacies, "nouveautés" et librairies, un "Hôtel National", un "Grand Hôtel", des Konditorskaia où l'on déguste des glaces fort bien servies. Jardin Public paisible et riant, cartes postales illustrées.
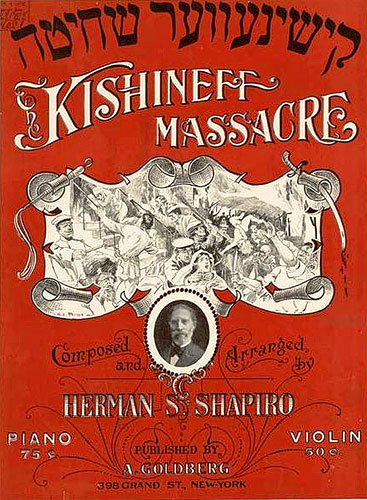 |
Sommes-nous donc si loin de chez nous ?... en pays de barbarie ? Il est vrai que les rues, brillantes dans le quartier riche, s'achèvent en une épaisse poussière de sable gris, entre des maisons basses sans étage, crépites de jaune, de rouge, de bleu, dont le toit s'avance en péristyle préservateur du soleil sur des colonnettes de bois également coloriées : agglomération de "cases nègres" sur un haut plateau balayé par d'immenses souffles chauds qui viennent de très loin... Parfois, un grand carré vide - un marché - où certains jours les étals s'emplissent et s'animent, où, le soir, de pauvres petites lumières falotes, d'huile ou de chandelle, éclairent en tremblotant le visage rude de quelques miséreuses accroupies devant leur balance, tandis qu'à l'estaminet voisin une aigre musiquette fait danser, entre deux bolées de "tchaï", de "kvass", ou de "pilsner" fabriquée à Riga, les soldats, les paysans, les filles...
Il est vrai qu'à deux pas de la confiserie à la mode - et ceci n'est pas, je l'affirme, une illusion de voyageur dont l'esprit serait trop occupé par l'objet de son voyage -, les malheureux regardent d'un air déliant l'étranger qui passe et portent dans leurs yeux l'affolement des effrois d'hier - tel l'assassiné dont la rétine convulsée garde, dit-on, l'image de l'assassin -; et, dans le vague de tous ces regards perdus au lointain d'un souvenir terrible, on croit lire la même interrogation inquiète : "Qu'est-ce que ces gens ? Que va-t-il encore nous arriver ?" Il est vrai que, si les chambres du Grand Hôtel sont modernes, mieux vaut n'y pas coucher, pour éviter la présentation de son passeport à l'autorité indiscrète, qu'il faut prendre des précautions, ne pas se faire remarquer de la police, ne pas parler trop haut dans le train, examiner à la dérobée ses compagnons de wagon, ne pas avoir l'air trop curieux, trop surpris, trop étranger dans le pays, ne pas compromettre les indigènes qui veulent bien vous indiquer les chemins et vous renseigner sur les choses, mais qui aiment mieux ne pas se montrer avec vous en public, et vous renseigner entre quatre murs...
Entre quatre murs ils parlent volontiers, et ce n'est pas sans émotion qu'on les entend faire appel à la loyauté française, pour que leur nom ne soit pas divulgué : la Sibérie pour eux est à la fois trop près et trop loin. Non que nous ayons appris des choses plus effroyables que celles qu'on sait déjà ; du moins nos constatations sont-elles, des rapports qui les ont précédées, une terrible confirmation.
Nous avons entendu le récit d'un M. G... qui fut attaqué en descendant du tramway, et laissé pour mort, heureuse circonstance à laquelle il dut la vie. De son bureau il voyait les émeutiers et les policiers, pêle-mêle, faire sortir les Juifs de leurs magasins. Il écrit quelques lettres, les donne à son employé pour le courrier, s'en va, saute dans le tramway. Il aperçoit un cadavre abandonné sur le chemin, puis plus loin, une trentaine de personnes qui brisent et saccagent tout ce qu'elles rencontrent, devant des soldats impassibles. Il veut d'abord descendre du tramway, puis, effrayé, reste. Du tramway un chrétien crie aux soldats : "Vous êtes ici pour protéger, et vous assommez !"
G. se sent réconforté par ce cri de protestation, mais voici qu'on a dépassé le groupe des pillards, qu'on arrive à la station, où un autre groupe hurle, frappe, le reconnaît pour juif, l'arrête. Un cri : "On va nous tuer !...", auquel la voix courageuse du même chrétien répond : "Nous sommes ici sans armes..." G. tombe sous des coups de pierres vigoureusement assénés, on le jette à la station où il fait le mort jusqu'au lendemain matin. Après une semaine et demie de maladie, le jour où pour la première fois depuis l'affaire il sortait de chez lui, il rencontre son défenseur chrétien : c'était un prince caucasien, qui s'offrit à être son témoin et qui, du reste, dit-il, avait déjà tout raconté au délégué de Pétersbourg.
Voici une petite marchande de nouveautés, qui avait sa maison à elle et quelques économies. Elle n'a plus rien... Sa maison a été pillée et brisée. Le dimanche de Pâques - le premier jour -, on était venu par trois fois casser leurs vitres. Le soir, ils jetèrent dans la cave le plus de marchandises possible et les objets personnels auxquels ils tenaient le plus. Sur neuf locataires, sept s'enfuirent, essayant de trouver un refuge ailleurs. Elle et son mari restent, puis le matin veulent s'en aller. Une chrétienne leur crie : "Ne sortez pas ! hier, c'était le pillage ! aujourd'hui, c'est l'assassinat". Des groupes arrivent, poussant des cris, brisent à tort et à travers. M. et madame F. voient tout de suite que leurs assaillants sont des gens aisés que les roubles n'arrêteront point, ils passent par la cour, s'en vont, et reviennent deux jours après. Les assaillants, avant de partir et pour assurer les conséquences de leur visite, avaient ouvert les conduites d'eau ... Ils ne peuvent même pas songer à partir pour l'Amérique : presque aisés hier, aujourd'hui ils ont des dettes : deux mille roubles de marchandises étaient chez eux en dépôt, ils doivent quatorze mille roubles à la banque, et ils ne peuvent abandonner pour rien une maison qui a sa valeur pour eux.
Et voici un témoignage qui nous fut fait solennellement, comme un témoignage devant la justice, par un personnage très important de la ville, un homme d'intelligence très nette, qui connaît la valeur des mots, et qui ne dit que ce qu'il sait et voit. C'est le dimanche à six heures du soir que lui parviennent les premiers bruits de l'émeute commençante. Comme depuis plusieurs jours on discutait en ville au sujet des troubles prévus, il comprit immédiatement que l'affaire serait sérieuse. La soirée apporta cependant quelque apaisement dans la rue et dans les esprits. Mais le lundi matin à huit heures des gens accourent de divers côtés chez lui, lui annoncent que la foule recommence à s'agiter, que les personnes et les propriétés sont menacées, qu'aucune mesure n'est prise pour leur protection. A huit heures et demie, deux des israélites les plus considérés et les plus influents de la ville se rendent chez le gouverneur, insistant pour qu'il intervienne; il répond avec tranquillité qu' "on va prendre des mesures". A dix heures, tout le Nouveau Bazar est envahi.
Évidemment, on ne commençait pas tout de suite et sans préambules par le viol des femmes et la violation des propriétés. Ce sont d'abord des gamins de douze à dix-huit ans qui cassent les vitres, jettent des pierres contre les murs; à leur suite, impassibles, les agents de police, sans les menacer, les accompagnent jusqu'à la limite de leur district, où parfois leurs collègues du district voisin les relaient dans cette étrange escorte. Nulle part aucune intervention des agents pour arrêter ces violences. Quand des juifs viennent se plaindre, la police les insulte ou répond qu'on ne peut rien faire.
C'est seulement après ces encourageants débuts que les émeutiers, par petits groupes, avec des cris d'assauts, brisent les volets, les portes, entrent dans les maisons et les magasins, il y a dans cette foule beaucoup de va-nu-pieds, d'ouvriers de passage, de Bulgares et de Moldaves des faubourgs, puis des domestiques et des femmes, et aussi trop de gens très bien mis qui donnent leurs indications, font passer leur peloton, indifférent et rapide, devant les maisons chrétiennes pour le jeter sans erreur sur la maison juive voisine. Peu à peu, à mesure que les émeutiers eurent conscience de l'impunité qu'on leur offrait, ils s'enhardirent. Certains groupes revinrent vers trois heures de l'après-midi aux lieux qu'ils avaient insuffisamment visités le matin, pour reprendre en le perfectionnant leur premier essai de pillage. A plusieurs juifs qui voulaient organiser une résistance et tiraient leurs armes, la police les leur confisqua, les rassurant par de bonnes paroles : "Si vous bougez, vous gâterez tout, les mesures sont prises !" Et les émeutiers, surpris quand même de trouver la voie si libre et l'adversaire si peu dangereux, s'excitaient à la chasse des victimes.
Le nombre des tués, des blessés, la nature même des blessures, les plafonds crevés, les robinets ouverts, les meubles et les marchandises déchiquetées montrent bien et l'ignoble brutalité des assaillants et l'indifférence de la police. Là où on leur opposait la moindre résistance, aucune trace de désordre : la plupart des maisons du troisième quartier, presque exclusivement habité par des juifs, sont indemnes grâce à un très petit nombre d'agents qui les protégeaient; tel bourgeois dut le salut de sa maison et de sa famille à l'intervention d'un chrétien courageux, tel boutiquier au "bakchich" habilement octroyé à un agent de son bloc, quand, tout à côté, la rue Pouchkine est absolument dévastée et que dans le quartier le plus opulent, où il y avait abondance de police, les émeutiers entrent comme ils veulent, où ils veulent, détruisant, pillant, frappant en toute franchise, enfonçant les tonneaux, brisant les bouteilles d'un débit de vins sans souci de la patrouille qui passe à deux pas. Dans la rue et dans les maisons le sang coule, les coffres-forts sont éventrés, l'agitation fait tache d'huile, s'étendant de plus en plus, jusqu'aux quartiers voisins de la campagne, où les bandits se répartissent comme un butin triomphal les pièces d'or et les objets précieux.
Cela devenait dangereux pour tout le monde : on voulait bien d'un honnête pillage, mais grâce à la facilité du travail (1) cela tournait au vilain. Et, pour arrêter les frais, un ordre suffit. Dès que l'émeute vit la troupe sortir des casernes, sérieuse et décidée, fusils chargés, dès que les escadrons balayèrent les rues - le lundi soir â six heures -, elle se fondit presque instantanément. Et pourtant, dans le rapport officiel, on a dit que les troupes étaient impuissantes à protéger les juifs attaqués ! Le mardi matin, il n'y avait plus de violences que dans les faubourgs écartés, et l'on commençait à recueillir les cadavres et les blessés, sur les trottoirs, dans les caves et les "closets" (2).
Mais la narration d'une victime ou la déposition d'un témoin, si précises et détaillées soient-elles, ne peuvent, à elles seules, rendre la physionomie exacte de ce que furent ces journées. Il les faut compléter par les mille souvenirs qui circulent dans la conversation des gens, bribes de vérité apportées par l'un et par l'autre.
Histoires atroces. - Ici une fillette de douze ans fut violée par un vieillard et retrouvée le lendemain couverte de plaies. Là, une femme fut violée près du cadavre de son mari ; elle est devenue folle. Cette autre, mère d'un enfant de quatre mois, violée par ces brutes - j'emploie le pluriel à dessein -, est enceinte, et, malgré son mari, s'obstine à demander le divorce, par respect pour la loi juive qui l'impose dans ce cas barbare.
On parle couramment de ces atrocités, qui pour nous jusqu'à présent n'étaient que des mots, des mots vides, signes de choses tellement lointaines qu'on ne cherche même pas à se les imaginer, mais qu'il faut bien se représenter et comme revivre, avec un frisson d'épouvante, quand on parle à ceux qui en furent témoins, qui vous disent les détails précis, la rue où l'événement s'est passé, les circonstances de brutalité qui l'entourèrent, le nom de l'amie qui en fut victime, l'horreur de ces situations d'autant pus douloureuses qu'il faut les cacher et que la vengeance est impossible.
Histoires touchantes aussi, d'héroïsme ou de charité. Le gardien d'une synagogue refusa d'ouvrir la porte et de livrer aux émeutiers les rouleaux de la loi : il fut tué... - Un homme âgé, des femmes et des enfants s'étaient jetés au fond d'une cave et y restaient dans un silence apeuré pour ne pas attirer sur leur retraite l'attention des bandes qui de temps en temps passaient dans la rue. Tout à coup un des enfants réfugiés reconnaît par le soupirail sa grand-mère qui, tremblante, fuyait, cherchant un abri ; l'enfant crie a la vieille d'entrer, de venir auprès d'eux. Affolées, les femmes veulent étrangler l'enfant, mais le vieillard les arrête d'un mot : "Une main juive ne peut pas tuer. Ouvrez..."
Quelques chrétiens se montrèrent très dignes et très courageux ; on cite le nom d'un ingénieur qui tint tête aux émeutiers et sauva plusieurs juifs ; de quatre jeunes filles et femmes chrétiennes qui s'offrirent immédiatement et s'employèrent à soigner les blessés. - On parle beaucoup du père Jean qui, le lendemain du massacre, manifesta, par une lettre aux Novosti, un bon mouvement de pitié pour les innocents - qu'il rétracta deux jours plus tard -, de l'archevêque de Jitomir, qui, tout en vitupérant le socialisme, prit en chaire la défense des massacrés.
On cite surtout le cas très significatif d'un officier de cavalerie : posté avec ses hommes à l'angle de deux rues, il entend a peu de distance, comme partant d'une cour ou d'une cave, des cris et des appels : entre sa compassion humaine et son intérêt militaire (la tendance n'était pas à l'intervention favorable, et il peut être maladroit de négliger la tendance...) il hésita un instant : sa conscience prit le dessus; il accourut vers la maison d'où partaient les cris, dispersa un rassemblement, sauva quelques malheureux : en rentrant au quartier, il fut réprimandé par son colonel, l'affaire s'ébruita jusqu'à Pétersbourg, et une semaine après il recevait une récompense du ministre de la guerre : et ceux qui content ce bel épisode des mauvais jours insistent - on comprendra pourquoi tout à l'heure - sur le fait que c'est le ministère de la guerre qui récompensa.
Histoires plaisantes, enfin, car celles-là même ne manquent pas : la vie est diverse et complexe. - Le gouverneur von Raaben n'a pas, malgré la responsabilité qui lui incombe, soulevé la haine des habitants; le rire désarme la haine elle-même. I1 était vieux, impuissant, très soumis à l'influence d'une dame aimable, aux conseils d'un ami douteux et aux malices de son sous-gouverneur, antisémite forcené, une sorte de policier intrigant que l'on compare, par égard pour les Français que nous sommes, à notre Fouché du premier Empire. On avait soufflé dans l'esprit de la dame que pendant Pâques éclaterait un mouvement anarchiste dirigé contre le gouverneur : il avait donc concentré des troupes au palais, c'était toujours autant d'indisponible contre l'émeute naissante. Effrayé, il ne sortait pas de ses appartements, ne s'éloignait pas du téléphone, et un placard amusant circula dans Kichinev, qui représentait le gouverneur caché sous son lit, la dame mettant ses jarretelles et l'ami du gouverneur disant : "Reste sous le lit, le désordre règne encore !" Quand on apprit le renvoi du gouverneur, ce fut l'occasion d'une autre caricature : le gouverneur, la dame et l'ami sortant de la ville sur un chariot traîné par le sous-gouverneur malin et triomphant. C'est ce même gouverneur, falot et timide vieillard, qui, accusé par la presse d'avoir reçu de l'argent des juifs de Kichinev pour faire cesser le massacre, eut l'étrange faiblesse de leur demander un certificat de bonne conduite sous la forme d'une attestation qu'aucune somme ne lui avait été versée par eux.
On parle aussi beaucoup du futur maire, petit-fils d'un boulanger grec, gros vigneron, sachant trafiquer de tout, riche à quinze millions de roubles, avare et rapace, et qui a payé cent mille roubles pour être noble : ce qui lui permet de profiter des avantages financiers que donne l'abonnement à la Banque de la noblesse.
On parle de Kruchevan, l'âme de l'antisémitisme, le fondateur du Bessarahetz à Kichinev, puis du Drapeau à Saint-Pétersbourg, - Kruchevan, l'austère célibataire, l'anachorète, habile excitateur, qui prétend à l'antisémitisme scientifique et dont la force est surtout de savoir écrire pour la masse.
Et particulièrement de Démètre Pisarjewski, un des ardents du Bessarabetz, ami de Kruchevan et son contraire, dont l'existence est un roman, ou le fut, car elle vient de se terminer de tragique façon. Peut-être fils de juive. Démètre Pisarjewski était antisémite par besoin d'action et par élégance ; jeune, riche, brillant, heureux, épris de la vie, il était le coq du village et tout le monde savait ses aventures aimables, dont la diversité l'amusait sans que leur simultanéité le gênât. Dans les journées de Kichinev il eut la maladresse, sinon de diriger les assaillants, du moins de se montrer au milieu d'eux avec sa casquette d'uniforme, et, parmi ces forcenés, de se distinguer par une particulière épilepsie, où l'alcool peut-être n'était pas étranger. Il fallut bien se décider à agir contre lui... Un jour qu'au beau milieu d'une intrigue amoureuse nouvelle une de ses anciennes aventures venait le déranger sous les espèces d'une mère coléreuse et menaçante, une autre "tuile" tomba sur lui : le procureur ordonnait la fermeture de son étude. Affolé par tous ces ennuis il se réfugia au cercle, joua et but toute la nuit, rentra chez lui à l'aube, et se fit sauter la cervelle. Ces juifs restent admirablement justes malgré le mal qu'on leur fait. Ils ne disent pas que Pisarjewski fut un méchant homme, mais un cerveau égaré, un tempérament violent, et c'est avec une pointe de sensibilité qu'ils parlent des malheureuses qui se succèdent à prier sur la tombe de cet homme qui fut beaucoup aimé !... - Un journaliste d'Odessa eut même l'amusante idée, tout de suite après les événements et tandis que l'autorité en interdisait le compte rendu dans la presse, d'écrire un feuilleton qu'il intitula Rachel, et qui n'était qu'un tissu d'allusions transparentes à la personne et au rôle de Pisarjewski. L'auteur est censé se promener dans les rues de Kichinev, il retrouve le quartier où habitait Rachel, une jeune fille qu'il avait aimée jadis, il apprend que sa maison a été saccagée pendant le pogrome, sa famille ruinée, elle-même violée, mais la maison d'en face est toujours là, debout, impassible, la maison qui porte l'enseigne du notaire, en lettres rouges...
Mille détails leur reviennent à l'esprit, dont ils n'ont compris l'importance qu'après l'événement ; à la réflexion, mille petits faits dont la juxtaposition est particulièrement significative au point de vue de l'état des esprits et des responsabilités. - Ils vous expliquent que les fêtes de Pâques étaient particulièrement favorables à l'explosion, non seulement parce que le crime prétendu rituel de Doubossari fut un prétexte commode, mais encore à cause de l'effervescence spéciale des orthodoxes en ce jour de fête : la nuit se passe à l'église dans la joie du Christ ressuscité, et s'achève en festins, dont la fumée resta manifestement au cerveau de beaucoup de ces élégants et de ces élégantes qui applaudirent les émeutiers, et s'offrirent la curiosité de regarder faire des victimes.
On fait remarquer que les poches des morts furent soigneusement vidées et que l'argent disparu s'élève à 250.000 roubles, que la grande majorité des émeutiers arrêtés ne sont pas de la ville, mais des va-nu-pieds du dehors, des gens sans aveu, chemineaux qu'attire toujours la richesse d'un pays où le tonneau coûte plus cher que le vin, habitués des traktirs de Nijni-
Novgorod et de Moscou, qui savent toujours où il y a un coup à faire. Leurs armes étaient plutôt sommaires : ils marchaient par les rues, la main repliée cachant sous le poignet des morceaux de plomb arrachés aux conduites d'eau qu'ils brisaient au fur et à mesure de l'attaque, et beaucoup des blessures atroces qu'on a observées sur les victimes ont été faites avec ces armes improvisées.
Et les souvenirs se pressent et s'accumulent, accusateurs. On sen- tait si bien l'émeute se former que le Grand Rabbin de Kichinev fit une démarche auprès de l'évêque orthodoxe pour lui demander de calmer les esprits : celui-ci se contenta de répondre qu'il croyait parfaitement que les Juifs faisaient le pain azyme avec le sang des enfants chrétiens (3).
Huit jours avant l'affaire, un important négociant d'Odessa, qui se trouvait à Pétersbourg, avait entendu parler très clairement du pogrome qui se préparait, et en faisait pressentir la venue, dans les lettres qu'il envoyait à sa famille. Le dimanche, premier jour du massacre, une dame israélite de Kichinev, riche et richement apparentée à Odessa et à Kiev, rencontre, inquiète et nerveuse, un important fonctionnaire de l'entourage immédiat du Gouverneur et lui demande : "Alors qu'est-ce qu'on va nous faire demain ?" "N'ayez pas peur, répondit-il, à vous on ne fera rien."
Vers le milieu de mai, comme l'agitation renaissait, un des blessés de Pâques, décidé à partir à l'étranger, faisait une démarche au bureau de police pour obtenir son passeport ; il y rencontra beaucoup de chrétiens, qui demandaient l'autorisation d'avoir des armes pour eux, pour leurs domestiques, pour leurs valets d'écurie. Notre juif sollicite la même autorisation : ou l'avait accordée aux autres, on la lui refuse, il interroge, insiste :
- Nous ne pouvons rien vous dire.
- Dites-le-moi, voyons, entre nous : c'est parce que je suis juif ?
- Vous nous mettez au pied du mur. C'est vrai.
Dès le matin, la maison et la cour de M. F., marchand de bestiaux, sont envahies ; à neuf heures, tout le reste étant brisé, on s'attaque à la caisse. Il a couru chez son avocat, puis chez le gouverneur, où il reçoit une réponse rassurante : "Nous enverrons des troupes". Les troupes ne viennent pas, il court à la police, où on lui répond plus franchement :
"Va-t-en, juif, nous n'avons pas d'ordres de Pétersbourg". De neuf heures à cinq heures les hommes continuent leur besogne tranquillement, à cinq heures le coffre est enfoncé et 50.000 roubles s'envolent.
 |
Au lendemain des massacres, quand arriva le procureur d'Odessa, il pleura en voyant les cadavres et en écoutant le récit des événements, mais le directeur de la police, qui fut envoyé de Pétersbourg, demeura impassible, - et modifia son rapport dans le sens que l'on devine pour être agréable à M. de Plehwe, qui lui avait dit, en le parcourant dans sa première forme, qu'il ne pourrait pas le présenter ainsi à l'empereur. Les délégués juifs de Kichinev allèrent rendre visite au gouverneur d'Odessa, subirent, en manière de consolation, un discours qui était une apologie de l'antisémitisme et qui se terminait, naturellement, par des considérations sur le socialisme. Même semonce de M. de Plehwe aux délégués de Kichinev qui vinrent lui demander audience à Pétersbourg et qu'il reçut d'ailleurs correctement : il se défendit d'être antisémite, mais porta contre eux la même accusation : "Vous êtes socialistes !" - Ce qui lui attira cette réplique : "Nous ne l'étions pas en 1881 !" -. Dans la presse, tout ce qui n'accabla pas les juifs, fut suspect : le Droit, de Saint-Pétersbourg, qui disait que ces deux journées étaient une honte pour le pays, reçut une observation très sévère ; le Voskhod, journal juif de Pétersbourg, reçut deux observations, deux semaines de suite; à la troisième il aurait été supprimé. Le premier numéro du Bessarabetz après les événements portait en vedette la question : "Qui a le plus souffert ?..." des Juifs qui ont été tués ou des chrétiens qui les supportaient depuis si longtemps ? Dans le troisième numéro on ouvrit une souscription pour les familles fatiguées de piller. Et quand les juifs voulurent faire une collecte pour les leurs, saccagés et meurtris, la publicité leur fut interdite.
De l'examen et du rapprochement de tous ces faits ressort logiquement une conclusion indiscutable : la complicité de l'Administration. Et je tiens à ce mot d'Administration, parce que je crois qu'il représente l'exacte vérité. De France, - de loin, - les violents, aisément simplistes, accuseraient volontiers le tsar. Le tsar n'est pas en cause. Dans la nuit de Pâques, à l'heure bienheureuse où les fidèles échangent le baiser sur la bouche pour fêler la Résurrection du Sauveur, Nicolas II ne savait sans doute pas que le lendemain, sur un point déterminé de son empire, un massacre de juifs allait éclater; peut-être même n'en sut-il rien encore, trois ou quatre jours après l'événement. Du moins personne ici ne l'accuse, - et pour cause... A Kichinev comme à Odessa, à Kiev comme à Berditchev, vous pouvez parler des ministres, de M. de Plehwe, - pas trop haut, - mais ne faites pas la plus légère allusion au tsar lui-même : immédiatement les plus hardis se dérobent, les voix s'assourdissent, les regards fuient, l'entretien se défile en formules d'excuses : L'Empereur a des ministres et s'en fie à leurs rapports, naturellement... L'Empereur n'a pas de volonté nette, il se laisse influencer, il n'est pas le maître... L'Empereur n'a pas une santé robuste, et la force lui manque de travailler par lui-même... L'Empereur n'est pas d'esprit très ferme, il ne voit pas bien les choses, n'en comprend pas la portée, on ne peut pas lui en vouloir..." Et de toutes ces excuses accumulées on ferait une admirable accusation, mais, dans la forme, les convenances politiques sont respectées, les murs qui vous écoutent ne retiendront rien, - pour cette fois ; - le tsar est hors de cause, la Russie est sauvée, - et la conversation tourne sur M. de Plehwe. - Attribuer la responsabilité du mal à cet être collectif que nous appelons le gouvernement, ne serait pas non plus tout à fait juste : nous aimons, nous, à concentrer dans ce mot très simple la complexité de nos mauvaises humeurs : c'est une entité politique et un sujet de conversation pour pays libres, où se mêlent un peu confusément la notion vague d'un Etat centre de tout, la considération bourgeoise des "pouvoirs établis" et l'idée précise de quelques personnalités réunies par le hasard des combinaisons parlementaires sur un banc spécial du palais législatif : c'est un mot trop européen, trop occidental, trop français. Ici le comité des ministres n'est pas un conseil des ministres, les ministres sont de grands chefs de service qui reçoivent eux-mêmes l'impulsion de l'un d'entre eux plus particulièrement favorisé de la confiance impériale... Et la conversation retombe toujours sur M. de Plehwe. M. de Plehwe, ministre de l'intérieur, grand détenteur des forces de police et de gendarmerie, M. de Plehwe, âme de policier égarée dans une apparente situation d'homme d'Etat, est merveilleusement apte à faire rendre son maximum d'effet à l'organisme qu'il dirige, mais il emprunte sa propre force à cet organisme lui-même, et l'on conçoit quelle en doit être la puissance dans un pays où la sécurité du monarque et la sauvegarde des idées dont il vit, semblent être la cause finale de toutes les institutions et l'essentiel devoir de tous les sujets.
L'Administration, c'est l'affaire Vidrine : les marchands juifs qui sont autorisés à s'établir hors du territoire, peuvent amener avec eux le nombre de commis nécessaire à la bonne marche de leur entreprise; le gouverneur contesta au marchand Vidrine le droit d'appeler un commis juif parce qu'il ne l'avait pas amené avec lui, l'assemblée générale du Sénat donna raison au gouverneur; - et c'est l'affaire Guen : un artisan typographe a le droit de séjour hors du Territoire, mais comme artisan typographe seulement, - il devient patron d'une imprimerie, n'est plus considéré que comme marchand, et renvoyé impitoyablement dans la zone. L'Administration, c'est, à Kichinev, le guichetier du télégraphe refusant le télégramme du docteur Mutznik, qui voulait informer le ministre de ce qui se passait, et c'est l'agent de police répondant au marchand de bestiaux affolé : "Va-t-en Juif, nous n'avons pas d'ordres de Pétersbourg !"
Masse formidable d'oukases et d'arrêtés qui peut écraser n'importe qui, n'importe où, n'importe quand; corps innombrable de fonctionnaires autoritaires et soupçonneux, qui montent une garde souvent invisible, mais toujours présente, auprès de tout être humain qui vit à demeure ou circule temporairement dans les limites de l'Empire, - le suivent partout, dans sa vie privée comme dans sa vie publique, surveillent et contrôlent même les autres administrations, lesquelles ont parfois la tentation de regimber, - je rappelle ici l'incident de l'officier de Kichinev récompensé par le ministère de la guerre, - exécuteurs farouches des ordres qu'on leur donne, et malicieux de ceux qu'on n'ose pas leur donner : l'Administration, c'est l'étroitesse vexatoire des règlements multipliée par le zèle des fonctionnaires, et, quand cet admirable organisme aperçoit dans son champ d'action quelques catégories de faibles et de suspects sur lesquels on peut tout et que personne ne défendra, il ne faut pas s'étonner que son exubérance se manifeste de temps en temps par une "opération de police un peu rude".
Si l'on a besoin d'une preuve particulièrement précise, immédiate, directe, de ce lien étroit entre l'Administration et le crime, dans l'affaire de Kichinev, il faut se rappeler un fait sur lequel on n'a pas suffisamment insisté : c'est qu'il n'y a ici que 50.000 juifs sur plus de 120.000 habitants, que ces juifs sont presque tous ouvriers ou petits marchands, non suspects de trafics incorrects, que les relations entre juifs et non juifs étaient bonnes, qu'en 1881 même la ville était restée en paix malgré la généralité des massacres juifs en Russie, et que ce n'est que depuis sept ou huit ans que la paix y est troublée, - depuis l'apparition du Bessarabetz ! Or, dans un pays où l'Administration a sur les journaux, - soit qu'ils paraissent en Russie même, soit qu'ils viennent du dehors, - tous les droits, si j'ose m'exprimer ainsi, - l'interdiction d'entrée à la frontière, l'interdiction de la vente sur la voie publique, la censure, la saisie, la suspension, la suppression, - si le Bessarabetz vit, s'il vit seul et sans contrepoids, c'est que l'Administration le veut ! En Russie, nous disait un indigène aussi spirituel que véridique, en Russie tout vient d'en haut, même l'émeute...
![]()
Odessa
![]()
Aussitôt après l'événement, l'Administration, émue des proportions que l'affaire avait prises et aussi de la répercussion inattendue qu'elle avait eue sur l'opinion à l'étranger, ordonna d'en effacer les traces au plus vite. Les vitres, les portes, les murs furent réparés, - encore qu'il reste aujourd'hui quelques dégâts visibles, - et l'organisation des secours fut tolérée. Chaque jour des familles viennent "toucher" au Comité de secours, font leurs adieux, partent pour l'Amérique.
Beaucoup se sont réfugiées à Odessa. Odessa leur offrait, en effet, comme un asile naturel. Odessa est très voisine de Kichinev, - on part de Kichinev à dix heures du soir pour arriver à Odessa à six heures du matin, - beaucoup de relations de commerce et de famille existent entre les Juifs des deux cités, et les incidents qui troublent l'une agissent fatalement sur l'autre. En outre, c'est une grande ville, riche, où l'existence apparaît de loin comme moins difficultueuse, un port important où se rencontrent beaucoup d'éléments divers, où l'absolu de l'autorité s'assouplit et s'éparpille : du haut de l'escalier de granit qui domine la statue du duc de Richelieu, la vue s'étend sur la mer à l'infini, et il semble qu'on respire, avec l'air du dehors, un peu de liberté.
 |
Sur près de cinq cent mille habitants, il y a à Odessa cent vingt mille juifs : soixante mille environ sont indigents. Et le nombre en grandit tous les jours; chaque année, à Pâques, la distribution gratuite du pain azyme aux pauvres augmente dans des proportions considérables. De partout, les Juifs persécutés se réfugient ici : c'est, aux époques agitées, l'exutoire de toute la Russie centrale et méridionale.
Il y a quelques semaines, deux mille artisans juifs ont été chassés de Kiev : tous les jours il en arrive quelques-uns à Odessa, ils s'entassent ici, sans savoir comment ils vivront demain. M. Brodovsky a consacré au prolétariat juif d'Odessa une étude très complète et très documentée. II connaît toutes les maisons, toutes les familles, les cours, les caves du faubourg Moldavanka, où gîte la partie la plus pauvre de la juiverie odessienne. D'immenses maisons-casernes s'ouvrent sur une grande cour peuplée de mar-maille ou sur un long boyau bordé lui-même de cahutes et de caveaux : en voici une qui contient cent cinquante chambres, - environ mille personnes; - une autre, en deux corps de bâtiment, qui, sous la voûte d'entrée, sur les panneaux d'ardoise du "dvornik", (concierge) étale aux yeux étonnés les noms de 51 familles pour l'aile droite et 52 pour l'aile gauche. Dans ces sous-sols, prenant un peu de lumière par un soupirail qui s'entr'ouvre sur la cour, des logements de deux chambres, ou d'une seule, - parfois pour deux familles composées chacune de cinq ou six personnes ; et le prix de la location de ces taudis varie entre deux roubles et demi et six roubles par mois, (environ six francs cinquante et seize francs) quand le mari, ouvrier ou petit marchand, gagne un rouble (deux francs soixante- cinq) par jour, la femme, vendeuse au marché, un demi-rouble. - Seize francs par mois, soit 192 francs par an, ne représentent peut-être pas un loyer très élevé; mais, dans la misère de ces gens, et pour ces immondes logis souterrains, c'est, comme on dit, "bien payé".
Il faut avouer que ces maisons n'appartiennent pas toutes à des non-juifs, que d'ailleurs la police intervient parfois pour fermer, vider et détruire les locaux particulièrement insalubres, mais que les propriétaires savent, par la voie ordinaire du bakchich, faire lever l'interdit.
A quelques kilomètres d'Odessa, dans la banlieue, les bains du Liman offrent un spectacle peut-être plus triste encore. Au bord d'une baie qui s'ouvre sur la mer Noire, un établissement de bains de boue s'est élevé, luxueux et très fréquenté par les citadins rhumatisants et neurasthéniques. Mais, sur la colline, des bicoques misérables s'étagent, à demi enfoncées dans le sol, où couchent sur des grabats, pêle-mêle, des vieillards, des femmes, des enfants, - Juifs venus de l'intérieur auxquels la Communauté d'Odessa avance parfois les 0 franc 50 par jour et par personne nécessaires à leurs dépenses de nourriture et de logement, et qui souvent, n'ayant pas de quoi retourner chez eux, resteront là, indéfiniment...
Naturellement, du fond de cette misère, des espoirs s'élèvent auxquels le sionisme donne corps et vie. Ces hommes ont conscience de former ici une société complète, avec la variété nécessaire de ses éléments, ouvriers et savants, intellectuels et financiers, dirigeants et manœuvres. Un riche banquier juif peut avoir ses bureaux confortablement installés dans Richelievskaia et vivre sa vie heureuse en son hôtel du boulevard Nicolas... La société russe lui est fermée, il ne sera jamais propriétaire sur les bords de la mer Noire de la villa où il passe ses soirs d'été, il ne peut pas, sans passeport régulièrement visé, aller vingt-quatre heures à Benderi ou à Kichinev, il est "prisonnier" dans le Territoire comme les autres : il songe, par contraste, au pays où il sera enfin "chez lui": il est sioniste.
Voici un médecin juif qui habite la Russie depuis vingt-cinq ans, qui a élevé tous ses enfants à la russe, dont deux filles sont mariées à des médecins juifs de vieilles familles odessiennes, et qui se sent toujours à la veille d'un arrêté d'expulsion auquel il n'échappe que par des prodiges de diplomatie; il sait que, chassé d'ici, il ne sera, rentrant dans sa patrie, qu'un "Juif" encore, ou même qu'un "Juif russe" : comment ne rêverait-il pas d'une patrie propre, autonome et indépendante? Il est sioniste.
Et ces hommes consacreront au sionisme des qualités d'intelligence, une énergie, une ardeur qui ne s'emploieraient, dans des pays plus heureux, qu'au paisible exercice de quelque vice-présidence d'un comité de bienfaisance, ou qu'ils réserveraient tout simplement au soin de leurs affaires personnelles, ne sentant pas, entre eux et leurs frères, le lien de la commune servitude. Ici ils sont les pasteurs du peuple, et le peuple suit, foule d'humbles et de pauvres disséminés dans les diverses catégories du labeur social : si, d'ailleurs, en d'autres temps, l'incapacité de posséder le sol et de faire partie des corporations, jeta les juifs presque exclusivement dans la pratique des affaires financières, ici, l'ostracisme qu'ils subissent est pour ainsi dire moins professionnel qu'administratif et géographique ; dans les étroites limites où on les enserre, obligés de gagner leur pain au jour le jour, ils ne dédaignent aucun métier comme le fait parfois le juif plus difficile auquel la liberté donne des ambitions : les couvreurs ici sont presque tous juifs, beaucoup sont juifs parmi les cochers, les musiciens d'orchestre, les conducteurs de camions...
Cette fierté qu'ils éprouvent d'être à eux seuls "un monde", le sentiment s'en manifeste dans toutes leurs conversations, il soutient et vivifie en eux l'idée de la transplantation en bloc. Ils ne remarquent pas qu'il y a sionisme et sionisme, que l'esprit d'entreprise économique et financière n'est peut-être pas étranger au sionisme du banquier, que celui du médecin repose particulièrement sur des considérations ethnologiques ou politiques, et que diffère également de l'un et de l'autre celui du rapetasseur de bottes et du vendeur de concombres, qui n'aspirent, tristement et sans phrases, qu'à "sortir de là". Ceux-là mêmes ne songent pas que leur malheur présent est fait pour une grande part de l'humilité de leur condition, et que la Palestine ne leur saurait rendre, du jour au lendemain, l'âge d'or ! Mais ils sont unis dans la foi, et la foi ne voit pas les difficultés.
Remués périodiquement à travers les siècles par des espérances messianiques qui ne se sont pas réalisées, ils ont gardé, des tressaillements passés, une facilité plus grande à tressaillir encore. Très instruits de leurs antiques origines, l'histoire a laissé au fond de leurs âmes comme le sel d'une poésie qui les destinait à recevoir fructueusement les germes du sionisme. Une idée à la fois mystique et sociale les réchauffe, un mot prestigieux les unit et les exalte. Le portrait du docteur Herzl est partout : appuyé au balcon de l'hôtel où il loge à Bàle en temps de congrès, le profil de sa barbe caressante se détachant sur les brouillards du Rhin qui se perd en une poétique perspective, l'apôtre du sionisme laisse errer aux lointains de la campagne et de l'avenir la douceur rêveuse de ses yeux. Il semble que grâce au sionisme, à son organisation, à ses ramifications dans les moindres localités juives, ils se sentent moins menacés et moins seuls, et les lettres hébraïques du mot "Sion", inscrites dans l'étoile symbolique, sur le papier des comités sionistes et sur la porte du restaurant "kascher" où ils s'entretiennent, font sur ces malheureux assoiffés d'une vie meilleure, l'effet d'un emblème neuf auquel la froide raison n'a pas encore touché et qui possède toute sa vertu génératrice de dévouement et d'espoir.
Mais, hélas ! en attendant une aurore qui ne se lève pas, ces malheureux se heurtent, pour l'obtention de leurs passeports, au mauvais vouloir de la police, ceux qui n'ont pas encore l'âge du service militaire ont 800 francs à payer pour avoir le droit d'émigrer, (4) le voyage coûte cher, l'admission en Palestine est difficile, - et les juifs continuent de croupir, proie toute prête pour le choléra et le typhus, dans les sous-sols de Moldavanka. (5)
| page suivante |
 |
© A . S . I . J . A .