| Pour lire la traduction des mots colorés dans le texte, posez le pointeur de la souris sur le mot, sans cliquer : la traduction apparaîtra dans une bulle. Les mots soulignés renvoient à d'autres pages (il faut cliquer dessus). |
- Oui, Paula, tu es sage, tu es appliquée et le hossen ne saurait manquer. Mais finis de trier les petits pois.
- Les petits pois seront triés à l'instant, Madame Maier ! Et puis, avec mes trente ans, je ne suis pas encore une vieille fille. Bernheims Gelle, la Gudule des Bernheim, en avait trente quatre, quand elle s'est mariée, et avec cela, elle louchait ! J'ai, Dieu merci, ma bonne constitution et, de plus, j'ai mes économies. Douze cents marks, c'est de l'argent, n'est-ce pas, Madame Maier ?
- Bien sûr, Paula, mais finis de trier les petits pois !
- Mais je finis à la minute, Madame Maier... Et il avait une rose à la boutonnière, et il me l'a offerte. Une rose rouge, qui sentait tellement bon ! Oh, Madame Maier, si mon rêve pouvait se réaliser !
- Il y a bien des rêves qui se sont réalisés, Paula ! Mais finis de me trier les petits pois !
- Voilà, j'ai fini Madame Maier !
C'était par une belle matinée de juin que cette conversation se déroulait dans la cour du marchand de bestiaux Willy Maier, à Schmieheim, en pays de Bade. Madame Maier, quinquagénaire encore imposante, épluchait des pommes de terre, tandis que son "aide", Paula, triait, comme nous l'avons entendu, des petits pois. Orpheline, elle avait été recueillie à l'âge de quinze ans par les Maier. Et depuis quinze ans, elle leur prêtait des services fidèles et appliqués. Nul n'aurait pu prétendre que Paula fût une beauté. En dépit de la fierté qu'elle tirait de sa "bonne constitution", personne n'aurait pu nier la couleur rousse de ses cheveux, ni ses innombrables taches de rousseur. Là-dessus, à la rigueur, on pouvait fermer les yeux. Mais elle avait aussi la réputation d'être un peu simplette ; et cette réputation débordait largement les frontières de son village natal. Il y avait même dans la région un dicton : "Bestousst comme Maier's Paula", "toquée comme la Paula des Maier". Ce n'était pas une exagération.
 |
Ainsi Paula était heureuse et contente. Elle le serait restée si, tout à coup, son amie, la Gelle des Bernheim, n'était devenue Kalle, fiancée, pour se marier, peu après, à un marchand en pays de Bavière. Et la Gelle avait, pourtant, trente-quatre ans. Elle était humble et effacée. Mais elle avait une nettinye, une dot, de huit mille marks. En conséquence, Paula pensait que c'était son tour à présent. Jour après jour, elle laissait entendre à Madame Maier combien elle était en droit, elle aussi, d'espérer la venue d'un hossen, d'un fiancé. Voilà qui constituait précisément l'objet de la conversation dont nous étions les témoins, par cette belle matinée de juin, dans la cour des Maier.
Et juste à l'instant où Paula laissait tomber les derniers petits pois
dans la marmite et secouait le contenu de son tablier à l'adresse des
poules, qui guettaient cela depuis longtemps, on frappa au portail de la cour.
La jeune fille accourut et ouvrit. Mais elle resta comme figée à
l'entrée.
- "Eh bien, qu'est-ce que c'est ?" s'écria Madame Maier.
Pas de réponse. Paula demeurait comme clouée sur place. Alors
Madame Maier se leva et s'approcha elle-même du portail. Dehors, il y
avait un jeune homme. On voyait que c'était un commis. Il tenait un boeuf
en longe. Le garçon était vigoureux. Ses souliers, sa blouse et
sa casquette étaient blancs de poussière. Tout cela formait un
tableau banal, aussi bien pour Madame Maier que pour Paula. Tous les jours des
bouviers se présentaient de la sorte pour amener des bêtes ou pour
en emmener. Mais ce garçon-là, sous sa moustache noire, mâchait
la tige d'une rose, et au bout de la tige, il y avait une merveilleuse rose
rouge et fraîche. "Mon hossen
! Exactement comme je l'ai vu cette nuit", murmura Paula.
Madame Maier l'écarta du portail. "Sotte, rentre, et fais du feu !" La
jeune fille obéit.
Puis Madame Maier interrogea le commis :
- D'ou venez-vous ?
- De Valf.
Monsieur Maier a traité hier avec le Zall (Salomon). Il a acheté
ce boeuf. Je suis en route depuis hier soir à huit heures. Voici un papier
de Monsieur Maier.
Il fourragea dans sa blouse et remit à Madame Maier un billet copieusement
poissé.
Madame Maier déplia le billet et se mit à le lire.
Son mari, parti en Alsace pour acheter du bétail, lui écrivait
que les offres n'étaient guèrent intéressantes jusqu'à
présent, mais qu'il escomptait trouver au marché de Saverne
de quoi remplir un plein wagon de bestiaux. Il la chargeait de payer au garçon
deux écus comme convenu, et de lui fournir la nourriture et le logis
pour la nuit.
- Entrez, c'est en ordre. Connaissez-vous l'étable ? Vous n'étiez
jamais ici ?
- Que si, répondit le garçon, j'étais déjà
plusieurs fois chez les Bernheim, mais jamais chez vous.
Il mit la bête à l'étable, lui donna à boire et lui jeta
du foin. Ensuite, il alla à la cuisine et demanda une brosse, avec laquelle
il enleva, dans la cour, la poussière de ses habits. Puis il s'assit
sur le banc de la cour, gardant toujours la rose à la bouche. Au bout
d'une heure, le repas était prêt. Paula lui apporta la soupe. Alors,
il enleva la rose de sa bouche et la tendit à la jeune fille.
- Tenez, voulez-vous de cette fleur, Mam'zelle ? Ce serait dommage de la laisser
se faner trop tôt.
- Oh, merci beaucoup. Elle sent si bon. Est-ce que vous aimez les fleurs autant
que moi ?
- Quand je suis affamé, je prends une fleur à la bouche. La bonne
odeur chasse la faim.
- Oh, le pauvre, vous avez faim ! Eh bien, bon appétit.
- Je vous remercie. Ce matin, à Gerscht, l'aubergiste à l'Étoile
a ouvert sur le coup de six heures. C'est là que j'ai donné au
boeuf de l'eau et du fourrage. Pour moi, j'ai pris un petit verre de Schnaps,
d'eau-de-vie, et un petit pain.
- Mais pourquoi n'avez-vous rien emporté à manger ?
- Hum ! vous savez ... naguère, il y a deux ans, quand ma mère
vivait encore, elle me préparait toujours mon paquet de provisions. Mais
à présent, j'habite chez mon beau-frère et chez ma soeur,
et ils ont six enfants, qui ont toujours faim.
- Est-ce que vous êtes encore célibataire ?
- Célibataire, franc et quitte !
- Pourquoi ne vous mariez-vous pas ?
- Moi ? Je suis un pauvre garçon. Qui voudrait d'un Meschoress,
un commis ?
- Et moi, je suis une pauvre fille. Je suis ici Bilsel, bonne à
tout faire.
- Alors on va de pair !
- J'en serais d'accord. Comment t'appelles-tu ?
- Je suis le Sender Blum, de Valf !
- Et moi, la Paula Blum de Schmieheim !
- Nous formons donc un ensemble de Blum, de fleurs, un vrai bouquet de fleurs.
Alors les deux se mirent à rire si fort que Madame Maier, tout étonnée,
passa la tête par l'entrebâillement de la porte de sa cuisine.
- Paula, est-ce que tu vas rester dehors pour la nuit ?
- J'arrive, Madame Maier. Je viens de me fiancer.
- Qu'est-ce que tu viens ...? s'écria Madame Maier en se précipitant
dans la cour. Est-ce que tu perds la tête ?
- Non, Madame Maier ! Seulement, le Sender et moi, nous nous sommes promis à
l'instant !
- Comment, un Knass, des fiançailles ? Mazeltof, félicitations
!
Boums ! Une assiette avait volé en éclats sur les dalles de la
cour. Quelqu'un était entré sans se faire remarquer. Ayant entendu
les dernières paroles de Paula, il avait enlevé l'assiette placée
devant Sender et l'avait lancée à terre.
- Encore un Meschouggener, un loufoque ! s'écria Madame Maier,
les joues empourprées, il ne nous manquait plus que vous !
- Tous les hazaunim, sont quelque
peu meschougge, loufoques, sans quoi ils ne seraient pas hazen,
dit en riant le visiteur, qui était effectivement le hazen de
Schmieheim.
Paula s'était baissée. Elle ramassait avec soin les débris
de l'assiette.
- Aide-moi, Sender, il faut conserver précieusement les morceaux du knass
!
Madame Maier se retourna vers le hazen :
- Mais ne voyez-vous pas ce que vous avez fait ?
- Hé, qu'ai-je fait ? Est-ce que ces deux-là ne sont pas hossen
et kalle ?
- Des sots. Voilà ce qu'ils sont, ces deux-là, et vous en êtes
un autre ! Mais en voilà assez. Ouste ! Paula, au travail ! Et vous,
jeune homme, au large ! Voilà votre argent.
Elle lui jeta une pièce de dix marks.
- Gardez le reste pour la nourriture et l'hébergement. Quant à
vous, hazen, vous
me paierez l'assiette !
- C'est moi qui paierai l'assiette, dit Paula en s'essuyant les yeux ; ayez
l'obligeance de me donner mon salaire et je vais me préparer. Je pars
avec Sender.
- Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas partir ? Nous l'avons recueillie comme
yaussem, orpheline, et cela fait quinze ans que nous la gardons comme
notre enfant, vous le savez bien, hazen ! Et maintenant, quand mon
mari n'est même pas là, tu veux partir seule avec un étranger,
un inconnu, et t'en aller, par-dessus le marché, de l'autre côté
du Rhin ?
- C'est mon hossen. Le Bon Dieu
me l'a envoyé. Ce n'est pas pour rien que j'ai rêvé de lui,
cette nuit.
- Eh bien, attends au moins que mon mari soit rentré. Il prendra des
renseignements sur ce jeune homme. Que sais-tu de lui, toi ? S'il est digne
de toi, tu l'auras. Nous organiserons la hassne, le mariage, et nous
te donnerons une dot. Il y a longtemps que mon mari et moi sommes d'accord là-dessus.
- Je sais que le Sender est honnête, mon coeur me le dit. Je pars avec
lui, je ne le quitterai plus.
- Hazen, vous êtes quand même un homme pieux ! Dites-lui
donc qu'une jeune fille juive n'accompagne pas un homme avant d'avoir été
sous la Houppa, le dais nuptial.
- Il a sa soeur à la maison. Je resterai chez elle jusqu'à la
hassne.
- Eh bien, va-t-en, ingrate créature ! Va-t-en, que je ne te voie plus
! Ta dot, tu peux la rayer d'un gros trait. Viens prendre ton salaire, espèce
de misérable !"
Madame Maier était hors d'elle. Paula pleurait comme un petit enfant.
"Je sais que je vous fais de la peine, Madame Maier, et jamais je n'oublierai
ce que vous et Monsieur avez fait pour moi, mais le Bon Dieu m'a envoyé
mon hossen et je dois partir avec lui.
- Mais enfin, dites-lui, vous, que cela ne va pas, cria Madame Maier au jeune
homme ; que dira votre famille, si vous arrivez tout à coup avec une
inconnue ?
- Je n'ai pas d'égards à prendre, répondit le jeune homme,
d'un ton farouche ; si Paula veut partir avec moi, nous nous en irons ensemble.
- Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer, dit le hazen.
- Taisez-vous, s'écria Madame Maier, plus un mot ! C'est à mon
mari que vous aurez affaire ! Quant à toi, entre maintenant, et viens
chercher ton argent."
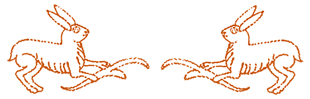
Une demi-heure plus tard, Paula et Sender suivaient de concert la route en direction
du Rhin. Le jeune homme portait sur son dos, au moyen d'une courroie, la valise
de Paula, tandis que celle-ci balançait dans chaque main un carton contenant
ses biens. La jeune fille avait mis son Schabbesstaat, son costume
de Shabath : des bottines jaunes, une ample jupe brune à ruchés
noirs, également garnie de dentelles noires, un châle de laine
à grands carreaux, bordé de franges orange, et sur sa chevelure
bouclée, une petite capote de paille à coquelicots bleus. Le ciel
était sans nuages et le soleil brillait déjà avec assez
d'intensité. Au loin, la chaîne foncée des Vosges se profilait
nettement dans le firmament.
Sender avait déjà fait une longue marche à l'aller. Malgré
cela, et tout chargé qu'il était, il avançait allègrement
à côté de sa fiancée. Celle-ci était heureuse,
archi-heureuse, d'avoir à présent un fiancé. N'est-ce pas
le Ciel qui le lui avait envoyé ? Comme il avait bien parlé, le
vieux et vénérable hazen,
quand il disait que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni ! Et
sait-on si Sender serait jamais revenu, si elle l'avait laissé partir
?
Bien sûr, Madame Maier lui avait souvent dit qu'elle prendrait soin d'elle,
plus tard, et qu'elle la doterait. Mais à quand donc ce "plus tard" ?
Elle avait à présent trente ans. Dans dix ans, elle en aurait
quarante ; elle serait une vieille fille, pouvant prétendre, tout au
plus, à un veuf avec des enfants. Et voilà que le Ciel lui avait
envoyé un garçon de - ah mais ! - quel était au juste l'âge
de son hossen ? Elle n'en savait
rien. En fait, elle ne savait absolument rien de lui. Oh, si Madame Maier avait
quand même raison ? Si Sender était, en vérité, un
mauvais garçon, un noceur, un buveur, un joueur ou pis encore ? A cette
pensée, Paula eut le coeur gros. Cependant, après quelques pas,
elle se sentit mieux. Non, le Bon Dieu ne lui aurait pas envoyé Sender,
s'il n'avait pas été un brave garçon.
- Sender, quel âge as-tu donc ?
- Vingt neuf. Et toi ?
- Tout autant. C'est comique, n'est-ce pas ?
- Je te croyais plus jeune.
- Oui, tout le monde me croit plus jeune. Sender, que dira ta famille ? Est-ce
qu'ils vont bien m'accueillir ?
- Je ne leur demanderai pas la permission. La maison m'appartient pour moitié.
- Ah, tu possèdes une maison ! Mais, tu sais, moi non plus je ne suis
pas sans le sou. J'ai un livret, à la Caisse d'Épargne, de douze
cents marks, et tout à l'heure, j'ai touché cinq cents marks comme
arriéré de salaire.
Sender s'arrêta, bouche bée :
- Mais, dis donc, tu es riche !
Paula fut enchantée de le voir si content.
- Oh, riche ! Dix-sept cents marks, ce n'est pas la richesse, mais il est bon
d'avoir une réserve. J'ai, de plus, une malle à linge, qui me
vient de mes parents et que Madame Maier m'expédiera par le train. Elle
est trop lourde à porter.
- Je ne t'aurais jamais crue si riche. Mais, même sans rien, je t'aurais
prise quand même, car tu me plais !
- C'est bien vrai, Sender ?
- Pourquoi ne serait-ce pas vrai, puisque je te le dis ?
- Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse !
- Et moi donc ! Je ne suis plus qu'une moitié d'homme depuis que ma mère
ne vit plus. Viens, asseyons-nous sur ce banc, pour nous reposer un peu, et
je te parlerai de moi.
Il s'assirent sur le banc de pierre entre deux noyers.
- Mon père était marchand de bestiaux. Il est mort quand ma soeur
avait dix ans. Moi, j'en avais cinq. Il laissa à ma mère la maisonnette,
rien de plus. Ma mère ne perdit pas courage. Elle s'engagea comme garde
d'accouchée, cuisinière et garde-malade. Nous eûmes ainsi
de quoi manger. Quand ma soeur atteignit ses seize ans, ma mère la plaça
à Barr,
dans une bonne famille, et elle put aider ma mère à gagner notre
vie. C'était une jolie fille, et au bout de quelques années, elle
fit la connaissance du Lehmann, qui est actuellement son mari. Ce fut pour son
malheur et pour le nôtre. Ce Lehmann avait servi sept ans en Afrique,
comme soldat. Il était de belle tournure et fils de braves gens. Mais
c'était un grand vaurien, ce que nous ignorions à ce moment-là.
Sachant que ma soeur possédait un peu d'argent, il avait spéculé
là-dessus. Ma mère prit une hypothèque de huit cents marks
sur la maison et lui donna cette somme comme nettinye, comme dot.
Ils se marièrent et habitèrent Barr, où il monta un commerce
de tissus. Seulement, au lieu de travailler, il passait ses journées
dans les cafés, à jouer et à boire. Finalement, tout ce
qu'ils possédaient fut vendu aux enchères, et ma soeur retourna
à la maison avec six enfants. Ma mère dut travailler pour eux,
tandis que Lehmann flânait quelque part en France, sous le prétexte
de se créer une existence nouvelle.
Un certain jour, il revint à Valf.
Il avait un peu d'argent sur lui et se vanta d'avoir découvert un filon.
Il emmena ma soeur, qui lui était toujours très attachée,
ainsi que les gosses. Plus tard, nous comprîmes d'où venait, soudain,
ce souci pour sa famille. Il s'était adonné au métier de
Schnorrer, de mendiant. Mais en se présentant tout seul aux Caisses de
Bienfaisance, il ne bénéficiait que d'un secours modique et s'entendait
dire qu'un homme aussi jeune et valide pourrait bien travailler. Ses compagnons-schnorrer
lui expliquèrent qu'il serait beaucoup plus avantageux pour lui de traîner
sa femme et ses gosses avec lui ; de la sorte, il recevrait non seulement de
l'argent, mais aussi des habits, du linge, des chaussures pour la femme et les
enfants, toutes choses qu'il pourrait revendre ensuite aux brocanteurs de la
grande ville la plus proche. Le truc consistait à se présenter
aussi démunis et déguenillés que possible, de manière
à obtenir un maximum. L'argent, il l'employait pour lui-même. Quant
à ma soeur et aux enfants, il les laissait dépérir dans
des bouges jusqu'à l'expédition suivante.
J'avais vingt ans quand ma soeur nous écrivit de Nancy
que Lehmann les avait abandonnés, une fois de plus, elle et les enfants,
et qu'ils se trouvaient, malades et mourant de faim, chez une pauvre famille
polonaise, qui n'avait elle-même pas de quoi manger. Ma mère déboursa
ses dernières économies et je me rendis à Nancy pour chercher
ma soeur et les gosses. Je les ramenai à la maison, où ils se
remirent lentement de leurs aventures. Lehmann resta absent pendant deux ans,
mais un jour il réapparut, et en cinq sec il avait reconquis les bonnes
grâces de ma soeur. Il avait été, tout ce temps-là,
en prison ; mais bien sûr, à l'entendre, il était innocent.
Ses amis, disait-il, l'avaient trahi ; au cours d'une rafle de police, ils lui
avaient glissé dans la poche de faux billets de banque, et c'était
ainsi qu'il avait dû expier pour d'autres.
Naturellement, il n'apprécia guère la vie à Valf, qu'il
appelait un misérable village, et, immédiatement, il parla de
reprendre, avec ma soeur et les enfants, le chemin de la medine, du
large, du vagabondage. Mais à présent, j'étais assez grand
et fort pour lui tenir tête, et je lui appris à respecter la puissance
de mes poings. En aucun cas, je ne voulus permettre un nouveau départ
des enfants. Comme Lehmann se montrait effronté, je le menaçai
des gendarmes. Il fut donc obligé de nous laisser les petits, mais ma
soeur s'en alla vadrouiller avec lui et ne l'abandonna point.
Lorsque ma mère mourut, je pris moi-même soin des enfants. Rachel
a quatorze ans, c'est une fillette très raisonnable, qui remplace la
mère auprès des petits ; David a treize ans ; puis viennent Dina,
qui a douze ans, Camille qui en a dix, Moïse qui en a neuf, et Esterle
qui en a huit et qui est la préférée, mais aussi celle
qui nous fait le plus de soucis. Voilà ! maintenant tu sais pourquoi
je suis resté célibataire. Un pauvre meschoress,
ayant à sa charge six enfants dont les parents sont des schnorrer,
qui aurait voulu de lui ?
- Moi, dit Paula, en se serrant tendrement contre Sender.
- Oui, toi ! Mais sais-tu bien quelle charge tu aurais eu à supporter
! Heureusement qu'avant-hier ma soeur est rentrée à la maison.
Une fois de plus, Lehmann est au Dépôt, à Paris, à
cause de diverses filouteries. Ayant déjà subi des condamnations,
il ne s'en sortira sûrement pas à bon compte. Ma soeur m'a juré
qu'elle ne reprendrait plus la vie commune avec lui. Elle en a assez. Maintenant
elle se rend chaque jour, avec Rachel et David, à Barr, où je
lui ai procuré, à la fabrique de résilles, un travail facile
et correctement payé. Si leur tâche est bien faite, on leur confiera
du travail à domicile, et si tu veux y participer, il y aura du profit.
- Ah, c'est merveilleux ! Quelle joie pour moi de travailler et de gagner pour
nous faire avancer !
- Jusqu'à présent, comme meschoress,
j'ai gagné assez pour satisfaire les appétits de tous, mais pas
davantage. Les marchands de bestiaux, eux, font du bénéfice. Mais
un meschoress, c'est un pauvre hère. Oui, si j'avais un peu
d'argent, je ferais moi-même des affaires ! Je suis bien vu chez tous
les paysans du Ried. En une seule journée, je pourrais
gagner plus que je ne gagne actuellement en une semaine.
- Mais maintenant nous avons de l'argent, Sender. Prends tout ce que je possède.
Est-ce que cela ne suffit pas pour faire des affaires ?
- Largement. Je vais commencer tout doucement, avec prudence, et tu verras,
avec l'aide de Dieu, cela ira !
- Et alors mon mari ne sera plus un meschoress, mais un vrai marchand
! Aussi bien qu'un autre ! Que dis-je ? Meilleur que n'importe quel autre !
Sender riait tout bas. - Nous voilà à forger des projets d'avenir,
quand nous ne sommes même pas encore mariés !
- Qui nous en empêcherait ? Nous sommes majeurs.
- C'est entendu. Mais il faut quand même des papiers.
- Des papiers ? Je n'en ai aucun, dit Paula toute confuse.
- Demain, j'irai voir Monsieur l'Instituteur, c'est lui le greffier. Il sait
ce qu'il faut.
- Greffier ? Qu'est-ce que c'est que cela ?
- Le Secrétaire de la commune. C'est Monsieur le Maire qui nous mariera.
- Qu'est-ce que c'est qu'un Maire ?
- Petite sotte ! C'est le Godel-Isch chez nous, c'est-à-dire
le grand homme, le bourgmestre.
- Ah, bien. Mais pour nous marier, il nous faut aussi un Rebbe, un
Rabbin. Avez-vous un Rebbe ?
- Non, pas nous. Mais il y en a un à Niedernai. Il vient à notre
Schoul, et nous avons aussi un bon
hazen.
- Oh là là ! Que ce sera long tout cela, et cela coûtera
aussi beaucoup d'argent !
- En quatre semaines, tout sera fait, et quand il s'agit de pauvres gens, ni
le Rebbe ni le Hazen ne demandent rien pour la hassne.
Pendant un certain temps, ils continuèrent de se livrer à leurs
pensées. Puis le roulement d'un véhicule attira leur attention.
C'était un lourd chariot tiré par quatre chevaux solides. Il n'était
pas chargé. Le voiturier les interpella.
- Sender, d'où viens-tu ? Est-ce que tu veux venir avec moi ?
- Avec plaisir, Xavier ! Tu arrives à point.
En un clin d'oeil, ils prirent place sur le chariot.
- Tu sais, Xavier, voici ma kalle ! Je l'ai cherchée à
Schmieheim.
Le roulier se mit à rire.
- Tu n'es pas bête, Sender ! Je la prendrais bien à côté
de la mienne ! Si ce n'était pas ta kalle, je lui réclamerais
un baiser pour le prix du parcours.
Paula rougit et s'écarta légèrement.
- N'ayez crainte, Mam'zelle ! Le Sender et moi, on est de vieux copains, pas
vrai Sender ? Et s'il me paye une chopine à Gerscht, je vous conduirai
jusqu'à la maison ; sinon, faudra rentrer de Zellwiller
à pied.
- C'est entendu, Xavier, nous boirons une chopine à Gerscht, à
l'auberge de l'Étoile ; mais d'où viens-tu ?
- J'ai livré du tabac à Offenbourg.
Alors Sender expliqua à Paula quelle chance ils avaient. Xavier était
au service de l'exploitant Walter, un riche paysan de Zellwiller, village situé
à une demi-heure de Valf. Le petit détour par Valf n'était
rien du tout. Et c'est donc vers dix heures du soir déjà qu'ils
arrivèrent à destination. Sans la complaisance de Xavier, ils
auraient dû passer la nuit à Gerscht, car la route était
trop longue pour être faite à pied en une seule étape.
Sender et Paula remercièrent le roulier qui disparut dans la nuit. La
lune était voilée et Paula n'aperçut pas grand-chose de
son nouveau pays. Sender se baissa et hissa à nouveau la valise sur ses
épaules.
-Ramasse les paquets, Paula, je vais te conduire maintenant chez la Sorele.
- C'est ta soeur qui s'appelle Sorele ?
- Non, elle s'appelle Marie ; tu la verras demain.
- Je croyais que je devais loger chez elle ?
- Ils couchent maintenant tous dans une seule chambre. Il y a une petite chambre
à côté, avec le lit de Lehmann, mais pour l'instant, c'est
Esterle qui y couche, parce qu'elle est malade. Il n'y aurait pas de place pour
toi. Sorele est notre voisine et ma Gettel, ma marraine. Elle habite
toute seule et elle a de la place. Elle te gardera de bon coeur jusqu'à
notre mariage.
Paula se tut et chemina dans la nuit à la suite de Sender. Celui-ci
s'arrêta devant une maisonnette, dont le volet laissait encore filtrer
de la lumière. Sender déposa la valise et frappa à la porte.
- Qui est là ? dit une voix de femme.
- Le Sender.
La porte s'ouvrit et au bout d'un moment parut dans l'embrasure une petite vieille
femme, dont les belles pommettes rouges étaient soulignées par
la lueur d'une bougie.
- Déjà de retour du pays de Bade ? Tu ne devais rentrer que demain,
pourtant. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose ? questionna la Sorele.
- Oui et non ! Je t'amène ma kalle !
- Est-ce que tu es meschougge ?
- Pas du tout, Sorele, laisse-nous rentrer, on te racontera tout.
La femme les précéda avec la bougie. Sender et Paula la suivirent.
A l'intérieur, une lampe à pétrole brillait au-dessus d'une
table très propre. Paula vit un plancher d'une netteté méticuleuse,
sur lequel était répandu du sable blanc. Contre le mur, il y avait
un buffet en bois de cerisier, orné de garnitures en cuivre qui reluisaient.
Au mur, près de la porte, se trouvait une grande aiguière en cuivre
avec son bassin, et à présent Paula remarqua également,
à côté de la lampe à pétrole, la lampe de
Shabath, à sept becs. Sorele éteignit la bougie. Puis elle se
tourna vers ses hôtes.
- Voilà, asseyez-vous, et racontez-moi d'où vous surgissez tous
les deux dans la nuit.
Ils prirent place autour de la table et Sender commença son récit
:
- Tu connais Monsieur Maier de Schmieheim, Sorele ? Ma kalle était
pendant quinze ans au service de Madame Maier. Elle est une Yaussem,
une orpheline, et n'a plus personne sur la terre. Hier, nous nous sommes promis
et nous sommes immédiatement partis ensemble.
- Hum ! Partir comme çà, moi rien, toi rien ! Et qu'est-ce que
Madame Maier a dit ?
- J'ai eu tort, répondit Paula, je sais que j'ai été ingrate,
car j'étais comme une enfant chez les Maier. Madame Maier aurait voulu
me garder encore quelques années. Ensuite, elle m'aurait donné
une dot. Mais la nuit dernière, j'ai rêvé que mon hossen
était venu et qu'il m'avait apporté une rose. Sender est venu,
et m'a apporté une rose. Pouvais-je faire autrement que d'aller avec
lui ?
- Tu l'aurais encore retrouvé dans quatre semaines, il ne se serait pas
enfui ; ne sais-tu donc pas, ma fille, que Sender est marié ?
- Sender-est-marié ! s'écria Paula avec consternation.
- Mais, Sorele, que dis-tu là ? s'indigna Sender.
- Eh ben, oui, dit Sorele, quand on a la charge d'une famille de six enfants,
c'est comme si on était marié. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il
gagne, il doit le dépenser pour ses neveux et nièces. Désormais,
il lui faudra, par-dessus le marché, te nourrir, toi. De quoi vivrez-vous
?
- Oh, je vais travailler, je suis jeune, déclara Paula.
- Et ma kalle ne vient pas les mains vides, renchérit Sender,
elle possède mille sept cents marks comptant, et en plus du linge et
des habits. Et puis, tu sais, Sorele, que Marie, Rachel et David sont allés
à Barr, pour travailler à la fabrique de résilles.
- Ils y sont allés hier, et ils en sont revenus, dit Sorele d'un ton
sec. Il parait que, pour Marie, le travail est trop pénible et le chemin
trop long.
- Je ne comprends pas, maronna Sender, elle m'avait promis ferme.
- Elle a souvent promis ferme sans rien tenir, dit Sorele.
- Mais ce n'est pas possible, s'emporta Sender, il faut bien qu'elle travaille
quelque chose ! Je l'y obligerai, je ne lui donnerai plus rien.
- Toi, dit Sorele, je te connais, tu donneras ta dernière bouchée
de pain, et tu te coucheras à jeun, plutôt que de laisser jeûner
les gosses.
- C'est vrai, les gosses, dit Sender tout penaud, je ne peux pas supporter que
des enfants aient faim !
- Qu'est-ce que je te disais, ma fille ? Va, rentre, suis mon conseil ; attendez
un an, deux ans, avant de vous marier et partez à Belzbummern
; à l'abri de la Mischpohe,
de la famille Lehmann ; tant que le Sender sera près d'eux, ils le dépouilleront
jusqu'à la chemise ; il est aussi bête que grand ; s'il m'avait
écoutée, ce fieffé coquin de Lehmann ne serait jamais venu
ici.
- Sorele, s'écria Sender avec désespoir, tu ne crois pas ce que
tu dis ; toi-même, tu leur donnes ta dernière bouchée de
pain, aux petits.
- Cela, ce sont mes affaires ; et moi, je ne veux pas me marier !
- Je ne m'en irai pas, dit Paula avec énergie, le Bon Dieu m'a envoyé
Sender, et je resterai avec lui, tant que je le pourrai.
- S'il en est ainsi, alors reste ! répondit Sorele avec un sourire aimable
; si tu t'arranges pour mener ton Sender en laisse, et tenir les Lehmann à
distance, tu en réchapperas peut-être. Mais il se fait tard. Toi,
Sender, tu vas rentrer, et toi, ma fille, je te garde chez moi. La suite à
demain.
| Page suivante |
 |