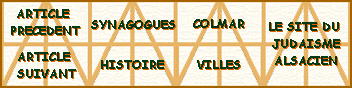III
 Fragment d'un manuscrit en hébreu, 14ème siècle (© Bibliothèque municipale de Colmar) |
C'est ce que Rabbi Jésell comprenait à merveille. Pendant cinq ans il laissa la ville appliquer dans toute sa rigueur le rescrit de 1541, c'est-à-dire que sous le prétexte que les Juifs devaient se munir d'une permission de l’obristmestre pour entrer à Colmar, on n'en admettait aucun. Enfin un mandement de Charles-Quint, daté du 23 décembre 1547, vint signifier au magistrat et au conseil que :
"c'est très à tort qu'ils se prévalent du privilége du 11 avril 1541 pour interdire aux Juifs l'accès et le passage dans leur ville, attendu que les franchises et les bonnes coutumes dont les Juifs sont en possession les autorisent à aller et à venir librement sur toutes les routes de l'Empire, et notamment à se rendre dans les villes impériales et à fréquenter les marchés pour s'y procurer la subsistance de leur corps."
Armé de ce titre, Jésell sollicita du magistrat une solution favorable à ses coréligionnaires et conforme aux intentions de l'empereur. On lui promit une réponse sous trois ou quatre semaines. Mais, deux mois après, n'ayant toujours pas de nouvelles, il s'adressa à Henri de Fleckenstein, lieutenant du grand-bailli de Haguenau, pour le prier d'intervenir, et le lui fit en même temps ordonner par l'empereur. La lettre de Jésell à Henri de Fleckenstein présente beaucoup d'intérêt; il défend sa cause par des arguments de l'ordre le plus élevé.
"Quoique nous n'ayons pas la même foi, dit-il en terminant, nous n'en sommes pas moins des hommes que Dieu tout puissant a créés pour vivre sur terre avec d'autres hommes."
Le 1er août 1548, le représentant du grand-bailli écrivit au magistrat pour lui donner connaissance des ordres qu'il avait reçus et pour l'engager à ne plus mettre obstacle à l'entrée des Juifs à Colmar.
Ainsi pressé, le magistrat résolut d'agir de son côté à la cour impériale. Le 14 août il fit partir pour Spire, où Charles-Quint se trouvait en ce moment, le docteur Wendling Zippern, syndic de la seigneurie de Sainte-Croix dont la ville était propriétaire depuis 1536, en le chargeant de présenter un mémoire à l'empereur.
On commence par y rappeler les maux que les Juifs ont causés autrefois parmi les bourgeois; pour y mettre fin, l'empereur Maximilien 1er, "plus sympathique à la communauté chrétienne d'une ville impériale qu'aux Juifs infidèles," avait accordé à la ville le droit de les expulser; mais cette mesure n'ayant pas produit l'effet qu'on en attendait, Charles-Quint fit de son côté défense aux Juifs de prêter de l'argent aux bourgeois de Colmar autrement que sur gages mobiliers, et plus tard il leur interdit même absolument l'entrée de la ville à moins d'une autorisation de l’obristmestre. La ville se croyait d'autant plus assurée du maintien de ce privilège, que dans les circonstances difficiles où l'on se trouvait, elle n'avait jamais donné lieu à aucune plainte et s'était montrée invariablement attachée à la religion catholique. Malgré cela, le juif Jésell venait de porter à la connaissance du magistrat et du conseil le mandement du 23 décembre 1547 qui, d'un trait de plume, privait la ville de tous les avantages qu'elle avait si laborieusement obtenus. Il est constant que la prétendue nécessité où sont les Juifs de faire leurs achats à Colmar, n'est pas fondée, car les endroits où ils demeurent ont des foires et des marchés comme Colmar, et qu'en y venant ils n'ont pour but, que de se livrer à leurs pratiques usuraires, aux dépens des corps, des âmes et des biens des bourgeois; que les ressources de la population en ont déjà été fortement amoindries, et que si les Juifs devaient jouir d'une pareille liberté, il lui sera bientôt impossible de subvenir aux contributions de plus en plus lourdes que l'Empire exige d'elle. Par toutes ces raisons on supplie l'empereur de retirer le mandement que les Juifs avaient surpris à sa religion, et de maintenir la ville en possession de ses privilèges.
Un rapport du docteur Zippern sur son voyage à Spire, où il arriva le 24 août, fournit des renseignements curieux sur la manière dont il accomplit sa mission. Il n’était pas inconnu à la chancellerie impériale, où il s'aboucha successivement avec le conseiller Christophe de Sternsée et avec le docteur Marquard. Ce dernier trouva le mandement peu régulier dans la forme et susceptible d'être cassé. Il offrit d'en parler lui-même à l'empereur et de lui présenter la requête de la ville ; puis il s'en excusa. Le docteur Zippern résolut alors de ne s'en fier qu'à lui-même, et s'arrangea de manière à remettre son mémoire à Charles-Quint, le 31 août, au moment où il se rendait à la messe. Cette démarche lui fit obtenir une audience du prince. Charles-Quint écouta attentivement le député de Colmar, lui donna l'assurance de n'être pas défavorable à la ville et le renvoya à son conseiller Antoine Perrenot, alors évêque d'Arras, plus tard cardinal de Granvelle.
Il fut reçu dès le lendemain et s'expliqua librement avec le prélat, qui lui dit de revenir le jour suivant. ll n'eut garde d'y manquer; mais le lendemain, 2 septembre, Perrenot était absent et Zippern apprit qu'il était parti en toute hâte, à cinq heures du matin, pour Bruxelles. L'agent de Colmar fit part de ce contre-temps au docteur Marquard, qui jugea qu'il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter, et qu'en attendant la solution, la ville pouvait appliquer ses priviléges en toute sécurité. Il demanda copie de toutes les pièces et promit de veiller de son mieux aux intérêts de ses commettants. Sur cette assurance, le docteur Wendling Zippern retourna à Colmar.
Pendant ce temps la ville refusait de se prononcer sur les réclamations des Juifs, ou plutôt elle donnait clairement à entendre qu'à moins d'y être contrainte, elle ne tiendrait pas compte du mandement impérial qu'ils avaient obtenu. C'est alors, sous la date du 19 décembre 1548, que Rabbi Jésell fit assigner Colmar devant la chambre impériale de Spire, pour l'obliger à ouvrir ses portes aux Juifs comme par le passé.
Le conseil sentit plus que jamais la nécessité d'obtenir un nouveau rescrit pour bien déterminer la portée et l'étendue des priviléges antérieurs. Dès le jeudi avant la Saint-Martin, il avait fait repartir le docteur Wendling Zippern pour Bruxelles, où Charles-Quint avait transféré sa cour, en lui adjoignant le messager de la ville Charlot Essig. Tout ce que cette nouvelle députation put obtenir, ce fut une déclaration du conseil aulique, par l'entremise du docteur Henri Hass, l'un de ses membres, portant que le mandement du 23 décembre 1547 n'accordait nullement aux Juifs la liberté d'aller et de venir, que chaque fois qu'ils voudraient passer par la ville, ils auraient à le demander à l'obristmestre, qui ne sera tenu de leur en accorder la permission que pour leurs achats d'aliments ou de vêtements, et que le magistrat aura toujours la ressource de leur infliger telle peine qu'il voudra, s'ils devaient abuser de leur séjour pour exploiter la bourgeoisie. Mais en même temps que le docteur Hass transmit cette déclaration au mandataire de Colmar, il l'avertit qu'elle ne pourrait pas être grossoyée avant un ou deux mois, et qu'il se passait quelquefois trois mois entiers sans qu'on pût obtenir une signature de l'empereur. Le docteur Zippern rendit compte de tous ces incidents par une lettre du 26 décembre.
Une déclaration dans ces termes ne faisait pas l'affaire de la ville. Elle commençait à se passionner; l'amour-propre était engagé; coûte que coûte il fallait avoir raison de ces malheureux Juifs à qui l'on refusait le droit de cité, sans vouloir leur laisser comme compensation le moyen de gagner leur subsistance par d'infimes trafics. En un mot, Colmar ne voulait aucune restriction au droit qu'il prétendait de leur fermer ses portes. Pour en finir, la ville résolut de confier la direction de ses négociations à la cour de Charles-Quint, à son greffier-syndic Balthasar de Hellu, dont nos archives possèdent un journal fort bien tenu, relatif à son ambassade à Bruxelles.
Il y arriva le 26 janvier. Il était porteur d'une nouvelle supplique contre le projet de déclaration, accompagnée d'un mémoire fort long pour l'évêque d'Arras. Il était chargé en outre de présents pour le docteur Hass ; mais du premier coup-d'oeil, Zippern, qui dans l'intervalle avait appris à connaître le tarif des complaisances à la cour de Charles-Quint, jugea le cadeau insuffisant. Il savait, comme il s'exprime dans une note jointe au journal du greffier-syndic "qu'en celieu on n'obtenait rien à moins d'y mettre trois ou quatre cents florins, uti constat multis exemplis", et pour rehausser la valeur du don, on y ajouta une voiture de vin.
Le 29 janvier, Antoine Perrenot reçut très gracieusement le mémoire qu'on lui soumit, et le docteur Hass non moins gracieusement le présent qui lui était, destiné; il promit de faire de son mieux pour le gagner, mais ne dissimula pas que Colmar aurait du mal à se débarasser complètement des Juifs, attendu que les privilèges qu'il avait obtenus ne leur interdisaient pas d'une manière absolue le passage par la ville. A son avis, le plus sage était de se contenter de la déclaration du conseil, sauf à faire en sorte d'obtenir la rédaction la plus favorable aux vues de la municipalité.
Balthasar de Hellu suivit ce conseil et remit au docteur Hass une note où, prenant pour base le projet de déclaration, il indique les moyens les plus propres à en tirer parti. Ce fut d'après ces observations que la chancellerie rédigea, sous la signature du chancelier Obernburger, un projet de rescrit daté du 5 février 1549, conçu à peu près en ces termes :
"À la requête du stettmestre et du conseil de Colmar, qui exposent que les Juifs se prévalent d'une prétendue autorisation impériale obtenue à la dernière diète d'Augsbourg, pour enfreindre la défense qui leur a été faite en 1541, de fréquenter les foires et les marchés de leur ville, l'empereur Charles-Quint renouvelle cette défense dans toute sa teneur, avec cette réserve cependant que les Juifs auront toujours le droit de passer par la ville, ou de s'y procurer les objets nécessaires à l'entretien de leurs corps, en acquittant le péage accoutumé et en donnant avis à l'obristmestre de la nécessité où ils se trouvent. Ils devront de plus ne pas s'arrêter dans leur chemin, porter les marques et les vêtements prescrits, acheter au marché ou dans des boutiques ouvertes les denrées dont ils ont besoin, ne pas s'introduire chez les particuliers, et s'il leur faut un sauf-conduit, ils pourront se le procurer auprès du bourgmestre moyennant finances."
Cependant le greffier-syndic n'acceptait cette déclaration que comme un pis-aller. Une petite scène dont il avait été témoin avait singulièrement diminué sa confiance dans le conseil aulique. Il dînait un jour chez le docteur Hass, où il se rencontra avec un ancien chancelier du comte-palatin nommé Sickingen, qui à ce moment parait avoir été attaché d'une manière ou d'une autre à la cour de l'empereur. La conversation tomba sur les Juifs, et le docteur Hass dit à Sickingen que du temps où il était au service du comte-palatin, il passait pour ne pas leur vouloir grand bien. "Je ne sais, répondit Sickingen, si je leur étais favorable ou non, mais ce que je puis dire, c'est que si je siégeais aujourd'hui dans une affaire concernant les Juifs, je me garderais bien d'opiner contre eux, persuadé à l'avance que cela ne servirait à rien." Le docteur Hass baissa les yeux sans mot dire, et Balthasar, en notant ce jeu muet, se dit que c'était le Saint-Esprit même qui avait parlé par la bouche de Sickingen. À partir de ce moment il résolut de saisir de l'affaire l'empereur en personne.
À force de chercher, il parvint à se mettre en rapport avec le camérier de Charles-Quint. Adrien, c'était son nom, le reçut d'abord assez froidement, mais notre ami Balthasar ne se rebuta point. Il s'assura les bonnes grâces de la femme de l'honnête Adrien, qui témoigna le plus grand désir de l'obliger et dont il vante beaucoup le mérite. Elle lui procura une nouvelle entrevue avec son mari, et fortement pressé par Hellu, Adrien promit de parler de l'affaire à l'empereur. Ce nouveau protecteur agit avec tant de zèle que Charles-Quint le chargea de demander au greffier un mémoire latin sur l'objet de ses démarches.
Deux jours après, Balthasar de Hellu fit remettre au confesseur de l'empereur l'exposé qu'on lui avait demandé. Au fond il ne diffère guère des suppliques antérieures. Le greffier y fait sonner très haut la fidélité de ses commettants à la religion catholique, qu'ils devaient cependant abandonner vingt-cinq ans plus tard, l'obéissance dont ils avaient toujours fait preuve et qui devait leur valoir un accroissement plutôt qu'une réduction de privilèges, les charges de plus en plus lourdes que l'Empire leur impose et auxquelles ils ne pourraient plus suffire, si on rouvrait leur ville aux Juifs ; il ne craignit même pas de parler desdémarches faites auprès des conseillers de l'empereur et de leur peu de succès, forsan ex ea causa quod negotium minus sufficienter aut debito modo deduxerimus.
Ce n'est qu'après de longues réflxions que Balthasar se permit cette insinuation, et il eut soin de recommander au fidèle Adrien de faire en sorte que son mémoire ne suivît pas, comme les précédents, le chemin du conseil aulique où l'évêque d'Arras et le docteur Hass n'auraient pas manqué d'en être blessés.
Cette précaution ne servit de rien. Charles-Quint prit connaissance de la requête et la remit à Antoine Perrenot, en lui ordonnant d'y donner telle suite que les Juifs ne pussent plus venir à Colmar, où il ne voulait plus les voir; il dit en outre à son obligeant camérier, que le greffier de Colmar devait s'adresser dorénavant à l'évêque d'Arras, qu'il avait eu tort de vouloir éviter son intermédiaire, attendu que toutes les affaires d'Allemagne étaient de son département.
Il s'écoula quelque temps sans que Balthasar de Hellu eût des nouvelles. Le camérier Adrien même ne savait où l'on en était. Le greffier lui fit part de ses inquiétudes; il craignait qu'en dernier ressort le docteur Hass ne fût encore une fois saisi de l'affaire, ce qui l'aurait nécessairement ramené à la déclaration du 5 février, où Colmar trouvait si peu son compte. Adrien lui répondit avec beaucoup d'assurance : "Qu'Arras renvoie l'affaire à Hass, au diable ou à sa mère, il ne faudra pas moins que les Juifs déguerpissent, puisque telle est la volonté de l'empereur." En même temps il dit à son client que si, dans trois jours, il n'avait pas obtenu une décision dans ce sens, il n'aurait qu'à le lui dire et qu'il en ferait son affaire.
Balthasar de Hellu s'attendait à être mandé chez l'évêque d'Arras, et il ne se trompa point. Un matin Perrenot le fit appeler, lui dit qu'il avait examiné sa nouvelle requête et qu'il n'y avait rien trouvé de nature à le faire revenir sur sa première détermination ; que le but de la ville était de mettre fin, à la fois, aux usures et aux trafics des Juifs ; que ces deux points étaient accordés, mais que la ville n'était pas fondée à défendre aux Juifs de passer dans ses murs et de s'y approvisionner des denrées nécessaires; qu'ils étaient des hommes comme les autres et avaient besoin de se nourrir, et que si l'un d'eux s'écartait des prescriptions de la déclaration, la ville était suffisamment armée pour les punir.
L'ambassadeur de Colmar essaya decombattre ce raisonnement à l'aide des arguments tout faits de sa fameuse supplique, sur les manoeuvres dont les bourgeois étaient victimes. Mais Perrenot répliqua que c'étaient là de pures calomnies ; que lui, le greffier, avait induit l'empereur en erreur en soutenant que la ville était autorisée (par le diplôme de 1541) à refuser l'entrée aux Juifs ; qu'il ne s'agissait que de marchandises à vendre et d'usures, et nullement de l'entretien du corps ; qu'il était bien entendu que les Juifs ne devaient point passer à Colmar à l'insu du magistrat, mais ce n'est pas à dire qu'ils n'y dussent point passer, et que c'était méconnaître la lettre et l'esprit du diplôme impérial que de les en empêcher. Il ajouta encore qu'il savait fort bien que la ville de Colmar n'avait pas donné à son greffier l'ordre de passer outre à l'avis du conseil aulique et de s'adresser directement à l'empereur, et que si elle n'était pas satisfaite de la déclaration qu'elle avait obtenue, elle fît ses remontrances à l'empereur par écrit et non par député, afin qu'on pût les examiner et en délibérer.
Le greffier reconnut, en effet, que la ville ne lui avait pas ordonné de recourir à l'empereur; mais, ajouta-t-il pour sa justification, "du moment qu'elle me chargeait de cette affaire, ne devais-je pas m'en occuper fidèlement et ne rien négliger pour la faire réussir?" ll pria l'évêque de l'excuser, en lui faisant remarquer que lui-même ne verrait pas avec déplaisir l'un de sesserviteurs déployer quelque zèle dans une affaire qu'il lui aurait confiée.
Perrenot répliqua qu'il n'était pas toujours bon de se montrer si zélé.
Le brave Balthasar prit congé sur ce mot. Tout autre, à sa place, aurait été abasourdi d'avoir été rabroué à ce point ; pour lui il retourna auprès du camérier Adrien, tout prêt à le faire agir de nouveau pour peu qu'il s'y prêtât. Adrien parut contrarié de cette brusque solution et demanda une traduction française du privilège dont la ville s'appuyait. Balthasar s'empressa de déférer à ce désir, mais en recommandant de faire en sorte que la pièce ne tombât pas entre les mains des conseillers auliques; autrement il vaudrait mieux s'en tenir là. Ce mot et la lecture du document refroidirent singulièrement le zèle de l'officieux Adrien. Il objecta qu'on ne lui avait pas dit que le privilège n'interdisait pas absolument l'entrée de Colmar aux Juifs, et que s'il en était ainsi, il était préférable de n'en plus parler à l'empereur, qui pourrait bien ne pas aimer qu'on voulût emporter l'affaire de vive force. Cependant il s'entremit encore pour obtenir quelques changements dans le projet de déclaration.
Le journal de Balthasar de Hellu ne va pas plus loin. Le greffier revint à Colmar sans avoir fait lever une expédition du nouveau titre contre les Juifs. Il fallut envoyer de nouveau, à Bruxelles, le messager Charlot Essig muni depouvoirs datés du 15 mai 1549, d'une lettre pour le secrétaire dela chancellerie Haller, chargé de grossoyer le diplôme, d'une armure pour Adrien et d'instructions particulières de Balthasar de Hellu. L'expédition en forme de la déclaration ou du rescrit impérial porte la date définitive du 5 juin 1549.
Je ferai voir plus loin jusqu'à quel point la ville tint compte de cette interprétation officielle d'un texte qui, pour elle, devait avoir force de loi. Contentons-nous, dans ce moment, de savoir que cet acte, issu du pouvoir législatif de l'empereur, n'interrompit pas le procès engagé par Rabbi Jésell à la chambre impériale de Spire. Je n'ai pas la prétention de retracer ici la marche compliquée de cette affaire, quel que soit l'intérêt que présenterait pour les juristes l'histoire d'une action judiciaire devant la cour suprême. Il me suffira de dire que le procès, ou comme on disait alors, la guerre de droit, la guerre juridique, par une réminiscence des guerres privées qui, elles aussi, n'étaient qu'une forme de la procédure, il suffira, dis-je, qu'on sache que ce procès se poursuivit avec une grande ardeur jusqu'en 1551 ; qu'après force exceptions et incidents, il s'assoupit tout d'un coup pour une cause dont on ne sait rien, à moins que ce ne soit la mort de Jésell le demandeur, et qu'il fut repris, en 1566, au nom de Gerson de Türkheim et de Lazare de Sonnenberg, pour avorter en 1572, sans que la ville ait rien relâché de ses exigences. Si les intérêts étaient les mêmes, les passions s'étaient calmées.
Et le combat finit faute de combattants.
IV
Au moment même où Colmar commençait cette lutte, d'autres exilés, poursuivis au nom de l'empereur, donnèrent à la ville l'occasion de déployer des sentiments de modération, d'humanité, de justice qui contrastent, s'ils ne les compensent, avec ses procédés à l'égard de ses propres Juifs.
On connaît les coups qui frappèrent successivement les Juifs de Portugal. En 1496, le roi Emmanuel le Fortuné avait rendu une loi qui les bannissait de ses États. Ceux qui restèrent furent baptisés, et sous le nom de nouveaux chrétiens ne restèrent pas moins l'objet des soupçons et de la haine publique. L'inquisition établie en Portugal par le roi Jean III - celui qui sur le trône prononça ses voeux comme jésuite et qui acceptait les ordres du provincial - confirmée en 1536 par le pape Paul III, se rendit l'instrument des passions populaires, et s'efforça de pénétrer dans le for intérieur des nouveaux chrétiens pour éprouver la sincérité de la foi que la contrainte leur avait imposée.
En Espagne, les Maranes n'étaient pas mieux traités, et il est facile de comprendre le courant d'émigration auquel la persécution donna lieu. La fuite d'un grand nombre ajouta de nouvelles présomptions à toutes celles qui pesaient déjà sur les nouveaux convertis, et on les accusa auprès de Charles-Quint de chercher soit à se rendre en Orient chez les Turcs, soit à se fixer dans les terres de l'Empire ou dans les pays voisins, pour de là, par l'espionnage et par des envois d'armes et de munitions, venir en aide aux ennemis de la foi chrétienne et de l'empereur, en attendant une occasion favorable pour se réfugier en Turquie. Pour prévenir ces mauvais desseins, Charles-Quint, assiégeant Metz donna commission, le 20 mai 1544, à George de Laxaw, capitaine impérial à Ratisbonne, conseiller du roi des Romains Ferdinand 1er, et vice-chancelier du royaume de Bohême, "d'arrêter dans toute l'étendue de l'Empire, en Allemagne comme en Italie, les faux chrétiens et autres marchands qui vendent des armes aux Turcs, de saisir leurs biens meubles et immeubles, de les déférer aux tribunaux des territoires où on les arrêtera, de requérir contre eux-mêmes la peine capitale et la confiscation de leurs biens. De leur côté, les officiers de justice auxquels ils auront été remis et dont la juridiction le comportera, pourront informer contre eux par tous les moyens de droit, la torture comprise, pour obtenir l'aveu de leur. crime et la dénonciation de leurs complices, saisir leurs biens et les mettre sous séquestre. De plus le commissaire délégué pourra s'adjoindre tous les auxiliaires dont il aura besoin pour remplir sa mission ." Le même jour, 20 juin 1544, George de Laxaw présenta à Charles-Quint, à titre de lieutenant, et fit commissionner comme tel, Jean Vinsthing d'Utrecht, qui obtint, le 20 avril 1545, du roi Ferdinand 1er , la confirmation de ses pouvoirs. George de Laxaw remit à son subdélégué tout le soin de cette affaire; il devait s'y appliquer d'autant plus qu'il en aurait les profits.
La persécution dont les nouveaux chrétiens étaient l'objet en Portugal, en amena un si grand nombre dans les Pays-Bas, que les derniers arrivants durent chercher fortune plus loin. Il s'établit ainsi vers l'Italie un nouveau courant qui, partant d'Anvers et débordant sur toutes les routes qui remontaient le pays, se rassemblait de nouveau en Alsace pour passer de là à Bâle et en Suisse. Jean Vinsthing se mit à l'affût au débouché de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, et trouvant une première fois main-forte à Sainte-Croix-en-Plaine, y fit arrêter deux voitures avec seize adultes. De là il courut à Colmar, où il trouva, vers onze heures du matin, quelques membres du magistrat prenant leur repas à la buvette qui avait donné son nom de Cave-à-la-Balance à l'hôtel de ville. En produisant sa commission, il en obtint l’arrestation de deux autres voitures déjà entrées en ville, chargées de quarante-trois personnes de tout âge et de tout sexe, y compris les trois voituriers et un étudiant qui s'était joint à la caravane. Aux premières questions qu'on leur adresse, les étrangers répondent qu'ils sont Portugais, qu'ils ont quitté leur pays à cause de la famine qui y règne, et qu'ils se rendent à Venise. On ne saisit d'abord sur eux que vingt-une couronnes portugaises cachées dans un soulier, et pour tout bagage on ne trouve que quelques sacs remplis de guenilles à l'usage des enfants. Mais quelques jours plus tard, le 19 juillet, on procède à de nouvelles recherches ; on oblige les prisonniers à se déshabiller les uns après les autres, hommes et femmes, devant le prévôt, les quatre sergents et le messager de la ville, et on découvre leurs pécules dans les chaussures ou cousus dans les vêtements. Les seules sommes importantes se trouvèrent sur une vieille femme du nom de Catherine Lopis, cachées sous ses vêtements dans un linge roulé autour du corps. Elle avait ainsi en réserve 158 pardallus en or, 155 demi-pardallus, 404 ducats de Portugal et 16 doubles ducats. Après cette découverte, les femmes et les enfants furent confinés dans la prison ordinaire ou Weibelstub, les hommes furent mis aux cachots ou dans des cages (in die kefich).
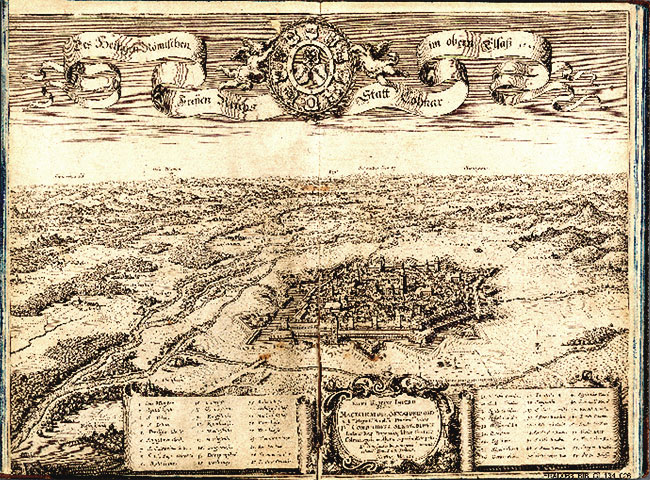 |
Ces arrestations précipitées eurent un grand retentissement dans le pays. Ces six voitures, que le commissaire impérial avait portées par terre, pour me servir d'une expression que la procédure avait empruntée à la guerre, étaient précédées et suivies de nombre d'autres, longue chaîne qui ne pouvait manquer d'être sensible aux secousses qui la brisaient. Le 17 juillet déjà, le magistrat recut une lettre de "François Gastaire, gouverneur on prieure de Lieure" écrite au nom des Portugais que l'arrestation d eleurs compatriotes avait refoulés dans la vallée de Sainte, Marie. "Lesdits suplians vous font remonstrer, disait-il, qu'il plaise à votre bonne grace leurs vouloir permettre aller et venir jusque à votre dite bonne grace... Lesdits suplians vous feront extention de leur mandement impérial, ou ils vous l'ennoyront si c'est de votre bon plaisir de le veyoir… Lesdits pouures supplians font grosses coustanges (dépenses), que leurs sembles estre grosse extortion, et vous demande en l'honneur de nostre Seigneur Jesucrist bonne et bref justice ; en ce faisant fere euures de pitié et de .charité... Je vous assure qu’ils font bonne cérimonie et grande deution de gens bien chrestiens."
Le 18 juillet, la ville de Bâle écrivit également à Colmar pour obtenir au moins la délivrance des lettres dont les prisonniers devaient être porteurs pour un de ses manants.
Dès le 16 juillet, le commissaire impérial avait demandé au magistrat de lui adjoindre quelques-uns de ses officiers pour procéder aux interrogatoires. Mais la difficulté était de trouver un interprète. Les prisonniers ne savaient que le portugais et un peu de latin. La régence d'Ensisheim à laquelle on s'adressa n'avait personne à sa disposition, et l'on dut recourir à l'orfèvre Gaspard Henschelot ou Hanschele, bourgeois de Colmar, à qui le poète et romancier George Wickram a dédié en 1557 son livre des Bons et des Mauvais Voisins » (Von güten vnd bösen Nachbaren).
L'interrogatoire porta sur un certain nombre de points fixés à l'avance par le commissaire impérial, pour s'assurer de l'origine des prévenus, de leurs relations entre eux et avec les nouveaux chrétiens, de leurs projets, du lieu où ils comptaient se rendre, si c'était à Venise et non à Ferrare, à Ancône, à Naples ou à Thessalonique. Les hommes durent prêter serment, les femmes durent donner la main comme gage de la vérité de leurs paroles.
Le groupe principal des prisonniers de Colmar se composait de la famille de Catherine Lopis, avec ses deux fils Fernando et Nuño Lopis, ses deux filles Violante Lopis et Clara de Torres, avec son gendre Fernando Gomis et sa bru Anna Gornis. Ils sont de Portalegre, bons chrétiens, quoique de date récente, et s'occupent de commerce. La figure la plus intéressante, c'est Clara, sur laquelle on n'avait trouvé en la fouillant que quelques bijoux, une longue chaîne en or, un corsage pailleté d'or, un lacet en soie ferré d'aiguillettes de même métal. Interrogée la première de ses compagnes, elle déclara n'être pas mariée, mais que de deux prétendants qui avaient demandé sa main, elle avait dû épouser à Anvers Francisco Lopis, et que le nom de l'autre lui échappait. Sa mère fut plus explicite: elle parla de trois prétendants dont l'un, Fernando Lopis, était médecin, l'autre, Fabian Rodrigo, était le propre fils du médecin du roi ; mais, à son grand regret, sa fille ne voulait ni de l'un ni de l'autre et s'était déclarée pour Francisco Lapis. Les trois devaient les suivre.
Les autres prisonniers sont des cordonniers, des tailleurs, des forgerons, la plupart de Portalegre. Tous protestent de leur orthodoxie. Ils sont baptisés et font leurs pâques. Ils ne connaissent aucun nouveau chrétien qui soit retourné au judaïsme. Ils n'ont quitté le Portugal qu'à cause de la famine, et ils cherchent à Venise ou à Milan une terre plus clémente. Cependant une veuve, à laquelle le procès-verbal donne le nom de Beancoïro Lopis, reconnait qu'elle est partie en abandonnant les deux plus jeunes de ses cinq enfants. Une autre femme, âgée de soixante-dix ans, confesse qu'elle n'est devenue chrétienne que depuis qu'elle est mariée et mère de famille.
Les prisonniers de Sainte-Croix subirent un interrogatoire semblable le 22 juillet. Dans leur ensemble, leurs réponses ne diffèrent pas de celles de leurs compatriotes.arrêtés à Colmar. Ce sont les mêmes protestations, les mêmes allégations. Les hommes sont marchands, cordonniers, tailleurs, originaires de Montforte, de Lisbonne, de Villa-Viçosa. Parmi eux il y en a deux qui ont cinquante ans et qui ont été circoncis avant de recevoir le baptême.
Le 24 juillet, le commissaire courut interroger ses prisonniers de Herrlisheim. L'enquête y donne à peu près les mêmes résultats que les précédents. Les hommes sont cordonniers, teinturiers, tailleurs, natifs de Villa-Viçosa, de Lisbonne. Jordin Diez, àgé de vingt-huit à vingt-neuf ans, est marin, et en cette qualité il est atteint du mal français ; il a un beau-frère qui fait le commerce de sucre, d'huile et d'autres denrées dans l'île de Madère. Les réponses d'une femme, Agnès Albris, née à Lisbonne, trahissent une irritation et un dédain pour ceux qui tenaient son sort entre ses mains, bien différents du ton humble et soumis de ses compagnons. Elle ignore qui étaient ses parents, juifs ou chrétiens, et cependant elle reconnaît qu'elle n'a été baptisée qu'à l'âge de dix ans. Comme les autres elle prétexte que c'est la faim qui lui a fait quitter le Portugal ; mais quand on lui demande pourquoi les vieux chrétiens y restent, elle répond qu'elle n'en sait rien. Elle ignore également où la caravane se rend. Une autre femme, Marguerite Diez, âgée d'environ cinquante ans, n'a été baptisée à Lisbonne qu'à l’âge de dix ou douze ans.
En somme, la seule présomption grave que fournirent les trois interrogatoires, sur le but caché du voyage, c'est que pendant que les inculpés prétendaient vouloir se rendre à Milan ou à Venise, il fut établi qu'ils s'étaient fait précéder de marchandises à la destination d'Ancône.
On interrogea également les voituriers, dont le témoignage fournit à Jean Vinsthing des éléments d'accusation plus à son gré. Jehan Frère, de Malines, avec qui les prisonniers de Colmar avaient fait marché pour les conduire d'Anvers à Zurich moyennant cent vingt couronnes, déclara que les Portugais qu'il conduisait avaient déjà été arrêtés successivement à Avesnes, à Dangckcor (?), à Bar-le-Duc, à Saint-Nicolas-du-Port; que partout on les prenait pour des Juifs ; que dans les hôtelleries ou ils descendaient, ils demandaient, un logement à part; qu'ils préparaient eux-mêmes, leurs aliments; qu'ils étaient suivis de six voitures chargées de marchandises ; qu'ils lui avaient promis une barrette, ainsi qu'à, son domestique, s'ils voulaient bien ne pas les signaler comme Juifs.
Gylger Gram, l'un des voituriers qui avaient amené les prisonniers de Herrlisheim, déclara de son côté qu'ils avaient été arrêtés une première fois dans les terres de l'évêque de Liège ; que leur projet avoué était de se rendre dans un pays situé sur les frontières de la Turquie, et qu'il avait entendu dire à un prêtre du Luxembourg que l'empereur leur avait concédé ce refuge.
Le 26 juillet, le commissaire transmit ces interrogatoires au magistrat de Colmar, en le priant de donner à l'affaire telle suite que de droit. Mais avant tout, la ville voulut avoir l'avis du docteur Thiébaud Bapst, professeur de droit à l'université de Fribourg, son conseiller habituel dans les cas, difficiles.
Quatre questions lui avaient été posées :
- Était-ce au commissaire impérial de se porter accusateur des Portugais arrêtés, ou bien la ville était-elle tenue de les poursuivre d'office en vertu de son droit de haute juridiction ?
- Y avait-il des présomptions assez fortes pour motiver le recours à l'information criminelle, autrement dit à la torture ?
- Si la question amenait les accusés à faire l'aveu de leur apostasie, quelle peine devait.on leur appliquer?
- Enfin si leur innocence était reconnue, la ville aurait-elle son recours contre le commissaire?
La consultation du docteur Bapst est datée du 4 août. Sur la première question, il répondit que si même le commissaire refuse de soutenir personnellement l'accusation la ville n'est pas moins tenue de poursuivre.
Sur la seconde, que le bruit public et les présomptions résultant des interrogatoires suffisent pour motiver l’emploi de la torture.
Sur la troisième, que si même le droit commun ne porte contre l'apostasie que la peine de la confiscation, la ville n'est pas moins fondée à appliquer aux prisouniers les peines édictées par la commission de Jean Vinsthing, qui vont jusqu'à la peine capitale.
Sur la quatrième, que si l'accusation est reconnue fausse, il n'y a pas lieu de rechercher le dénonciateur, qui n'agit qu'en vertu des ordres de l'empereur.
Quoi qu'elle fît, la ville se trouvait donc parfaitement à couvert au point de vue des légistes. Mais soit qu'il lui répugnât de se charger d'une action publique où elle était désintéressée, soit qu'on éprouvait quelque compassion pour les malheureux étrangers, qui avaient une première fois sacrifié leur croyance à la patrie et qui sacrifiaient maintenant la patrie à leur sûreté, et qu'on fût ému de pitié pour ces enfants, pour ces femmes dont l'une était accouchée en route, et dont plusieurs étaient enceintes, avant de s'ériger en tribunal de l'inquisition, le magistrat envoya, le 31 août, un message à l'empereur pour savoir cequ'il devait faire.
Les Portugais, que la ville avait séquestrés dans ses cages, lui avaient présenté deux jours auparavant, après vingt-sept jours de captivité, une requête dans les termes les plus touchants pour la supplier, au nom des cinq plaies de Jésus-Christ, de les réunir à leurs femmes et à leurs enfants; de ne pas les détenir dans une prison plus dure que leurs compagnons d'infortune de Sainte-Croix et de Herrlisheim, et de hâter leur mise en liberté, dût-il leur coûter tout l'argent qu'on avait saisi sur eux. Cette supplique, en mauvais latin, est signée Ferdinandus Lopis et omnium sodalitium(sic) meorum.
La réponse de l'empereur tardait à venir. Le bruit s'était même répandu parmi les prisonniers que Charles-Quint était tombé malade. Les femmes portugaises, consternées de cette nouvelle qui n'avait cependant rien de fondé, écrivirent de leur côté au magistrat, le 2 septembre, pour lui demander de permettre au mari d'une d'entre elles de se rendre auprès de l'empereur afin de hâter la décision. Les pauvres femmes profitèrent de l'occasion pour demander, de leur côté, à être réunies à leurs maris : " Par la douloureuse passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, s'écrie Anna Gomis au nom de ses compagnes, qu'avons-nous fait pour être séparées de nos époux? Nous sommes dans la désolation, et nous n'avons personne qui nous console (capropter sumus valde desolate, neque quisquam habemus qui nos consoletur). Plusieurs d'entre nous sont dans un état de grossesse avancée et ne savent quand elles enfanteront."
Mais le 31 août l'empereur avait prononcé sur le sort des prisonniers de Colmar. Son secrétaire, Jean Obernburger, manda de sa part au magistrat de Colmar "de faire jurer aux prisonniers qu'ils étaient de vrais chrétiens et non des apostats ou des Maranes ; que leur dessein n'était pas de se rendre en Turquie, mais dans un pays où ils habiteraient avec des chrétiens. S'ils prêtent ce serment, on devra les mettre en liberté en exigeant les réversales (urphed) usitées en pareil cas." Les captifs se soumirent à tout ce qu'on exigeait d'eux. Mais cela ne suffit pas. L'accusateur et les geôliers avaient leurs notes à présenter. L'entretien des prisonniers avait coûté 101 livres 40 schilling 9 pfennig, ou en monnaie française quatre cents et quelques livres tournois ; cette dépense fut mise à la charge des prisonniers. De son côté, Jean Vinsthing, qui n'avait d'autre salaire que les prises qu'il faisait, réclama quelque chose pour sa peine et pour celle des agents que la ville lui avait adjoints sur sa demande. Par contre, la ville donna aux Portugais un sauf-conduit en bonne forme, où elle fit mention de toutes les circonstances de l'affaire, ainsi que de la solution que l'empereur lui avait donnée.
V
 Il me reste à rechercher comment la ville de Colmar usa des privilèges qu'elle avait obtenus, quand les Juifs, privés de leur chef Rabbi Jésell, cessèrent de les lui contester.
Il me reste à rechercher comment la ville de Colmar usa des privilèges qu'elle avait obtenus, quand les Juifs, privés de leur chef Rabbi Jésell, cessèrent de les lui contester.
Vers 1550, je trouve une requête des Juifs de Winzenheim et de Wettolsheim pour solliciter du magistrat le maintien de la coutume qui leur permettait, les jours de marché, d'acheter hors la porte de Deinheim les agneaux et le menu bétail nécessaires à leurs ménages, et de se livrer au commerce des chevaux.
En 1581, il fallut la double recommandation de Reimbold Wetzel de Marsilien et d'Eguenolphe de Berkheim pour faire obtenir à un médecin juif, Lazare de Jebsheim, l'autorisation de se pourvoir chez les apothicaires de la ville des médicaments dont il avait besoin.
La même année, un jeune Juif de Hochheim, près de Francfort, qui par ignorance de l'usage, était entré à Colmar sans sauf-conduit et sans permission du magistrat, fut jeté en prison et ne recouvra sa liberté qu'en jurant ne pas tirer vengeance de son arrestation et de ne plus jamais repasser les portes de la ville.
En 1621, un Juif de Mackenheim ayant changé, à la porte de la ville, un écu que lui offrait un soldat, fut condamné à une forte amende, sans que l'intervention du bailliage de Markolsbeim pût le sauver.
L'année suivante, le maquignon juif Cossmann, de Wettolsheim, qui avait inutilement demandé l'autorisation de fréquenter le marché de Colmar, fit agir en sa faveur George-Thierry de Wangen et de Guéroldseck, dans les Vosges, gouverneur du mundat de Rouffach. Cette recommandation fut de nul effet.
Cossmann crut qu'une recommandation plus puissante serait mieux accueillie. L'archiduc Léopold d'Autriche, évêque de Strasbourg et de Passau, administrateur des abbayes de Murbach et de Lure - assurément le plus grand seigneur de l'Alsace - lui fit délivrer une lettre signée de sa main pour appuyer sa demande. Dans cette missive, ce prince de l'Église et de l'Empire faisait observer à la ville que Cossmann s'engagerait à ne s'occuper que du commerce des chevaux, à éviter d'endetter la bourgeoisie, à ne pas s'occuper du change, à ne pas pratiquer l'usure. Colmar était d'autant mieux fondé à se relâcher de sa rigueur accoutumée que, depuis quelque temps, Kaysersberg, Sélestadt, Obernai et Haguenau traitaient les Juifs avec plus de douceur.
Le magistrat fut inébranlable. Il répondit à l'illustre prélat qu'il ne lui était pas possible de faire à sa demande l’accueil qu'elle aurait mérité; qu'il était tenu de veiller au maintien des priviléges octroyés à la ville, et que l'eût-il voulu, il se fût heurté à une règle qui revêtait un caractère absolu du serment annuel des bourgeois, ce serment par lequel ils s'engageaient, sous peine de déchéance de leur droit de bourgeoisie, à ne pas avoir de relation avec les Juifs.
La réunion de l'Alsace à la France ne modifia guère l’attitude de la ville à l'égard des enfants d'Israël. Foulée par Louis XIV, humiliée par les intendants, par le conseil souverain, par les Jésuites, la commune avait cessé d'étre maîtresse chez elle : les Juifs n'en restèrent pas moins proscrits. La ville ne céda que sur un seul point.
L'établissement du conseil souverain d'Alsace à Colmar en avait fait le centre judiciaire de la province, et la ville dut forcément s'ouvrir aux justiciables de tous les cultes. Il en était résulté un certain relâchement dans l'application des anciens règlements concernant les Juifs ; on avait notamment fini par tolérer des domestiques juifs dans les auberges fréquentées par leurs coréligionnaires.
Cependant cette tolérance ne donnait aucun droit et, pour mieux le constater, le magistrat et le conseil décrétèrent, le 24 novembre 1781, l'expulsion de David Lévi, juif au service d'un cabaretier chrétien.
Comme au temps de Rabbi Jésell, la nation entière prit fait et cause pour la victime. Ses agents, Aaron Beer et Isaac Mayer, qui se qualifiaient de préposés généraux de la nation juive d'Alsace, firent opposition au décret, ou du moins demandèrent qu'il fût sursis à son exécution.
Conformément aux conclusions du procureur fiscal, le magistrat ordonna de passer outre au cas particulier; cependant pour concilier les droits de la ville avec les convenances des Juifs qui y avaient affaire, il fut décidé que les cabaretiers continueraient à pouvoir faire apprêter à manger pour les Juifs par des personnes de leur religion, sous la condition qu'elles ne se feront jamais un titre de cette facilité pour réclamer un domicile fixe et permanent.
C'était une concession immense, si l'on se reporte aux rigueurs des deux derniers siècles; mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agissait que des plaideurs. Les affaires avec les bourgeois ne restaient pas moins interdites aux Juifs, témoin un autre décret, du 20 novembre 1784, par lequel le magistrat fit défense, à qui que ce soit, de louer aux Juifs, à la semaine, au mois ou à l'année, à peine de cent livres d'amende, des appartements, chambres, granges ou magasins ; les aubergistes qui étaient dans le cas de recevoir des Juifs, ne devaient leur donner asile que pendant une huitaine de jours, et si leurs affaires les retenaient plus longtemps, leurs hôtes étaient tenus d'en faire la déclaration et d'obtenir une prolongation en leur faveur.
Enfin la Révolution vint briser cette tradition que rien n'avait pu fléchir. Au nom de principes supérieurs à toutes les traditions, parce qu'ils les comprennent toutes, elle osa rendre justice à cette race humiliée, ravalée, flétrie par tant de siècles de persécutions. Elle ne se demanda pas si les Juifs étaient dignes de ses bienfaits, elle comprit que c'était une justice qui leur était due, et qu'ils étaient susceptibles de se redresser encore après une si longue oppression; contrairement à tous les précédents, malgré les réclamations de toute l'Alsace, sans écouter l'avis des hommes les plus autorisés, même au sein de ses conseils, elle accorda à tous les Juifs, sans distinction, la qualité de citoyen français.
Trois générations se sont renouvelées depuis, et les esprits les plus chagrins doivent reconnaître aujourd'hui que la Révolution ne s'est pas trompée. En dépit de l'ombre du passé qui, pendant dix ans, de 1808 à 1818, s'est projetée sur eux, les Juifs d'Alsace ont accompli, comme ceux des autres provinces, des progrès surprenants. Toutes les classes ont ouvert leurs rangs pour les recevoir. L'élite a marché en tête. Vous pouvez les reconnaître partout, ces hommes qui précèdent leur temps et qui devancent leurs coréligionnaires, dans les lettres, dans les arts, dans l'enseignement, dans les sciences, dans l'industrie, dans les finances, dans la magistrature, dans l'armée, au barreau. Au point oit ils sont arrivés, il est honorable pour eux de leur rappeler d'où ils sont partis. Le succès répond aux longues épreuves que la race a traversées, qui l'ont trempée et où elle s'est aiguisée. C'est là le secret de sa force. Le reste suit à grands pas. Laissons faire la contagion du point d'honneur, dont les Juifs ont si longtemps ignoré la tradition. Les rangs infimes se déshabitueront de plus en plus des tristes expédients du moyen âge. Partout la nécessité du travail les gagne. Le capital, devenu plus abondant, plus accessible, n'est plus, dans ce qui constitue son emploi le plus bas, l'instrument exclusif des Juifs. L'assimilation se fait lentement, mais sûrement, et le succès démontre combien il est vrai de dire que quand il s'agit de résister à de vieux préjugés, de réparer des injustices séculaires, la loi ne risque rien de prendre les devants sur l'opinion et les moeurs.
Colmar, 8 décembre 1866.
| Page précédente |