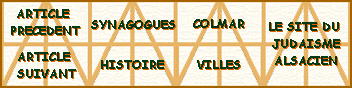Edition du texte : Daniel FUKS
I.
 |
Loin de là : à partir du second concile d'Orléans, en 533, l´Eglise s'applique à interdire aux Chrétiens le connubium avec les Juifs, et dès que la société chrétienne du moyen âge se fût organisée, malgré les exemples de tolérance que lui donnèrent quelques-uns de ses plus illustres pontifes, elle se mit en mesure de les repousser de toutes les voies par où ils auraient encore pu s'assimiler aux peuples chrétiens.
Cette scission, préparée par d'anciennes antipathies de races, favorisée par l'antagonisme des dogmes religieux, par les calomnies que les Juifs propageaient contre le culte opposé, par ce honteux trafic d'esclaves chrétiens qu'ils vendaient aux Maures d'Espagne, après les avoir façonnés, notamment à Verdun, à certains emplois du harem, devint plus violente par la pratique du prêt à intérêt. Défendu aux Chrétiens sous peine d'excommunication, le prêt à intérêt fut abandonné aux Juifs qui en firent pour ainsi dire leur unique ressource, et l'on peut facilement juger de ce qu'il devint dans une société où le capital était rare et constamment menacé dans la personne de ceux qui le louaient. En 1254, la grande confédération des villes du Rhin fixe le taux annuel de l'intérêt à quatre sous par livre, à deux deniers quand il s'agissait de prêt à la semaine, c'est-à-dire à 20 et à 43 pour cent, et tout indique qu'au quatorzième siècle et même plus tard encore, quand déjà le prêt à intérêt n'était plus exclusivement entre les mains des Juifs, ces usures avaient encore quelque chose de très normal, du moins dans la vallée du Rhin, l'une des grandes artères du commerce au moyen âge.
Il ne faut pas s'étonner qu'une oppression pareille de la terre et du travail ait amené des réactions sanglantes. En 1337, un tavernier de village, compère Thomas, plus connu sous le nom d'Armleder, parcourt les campagnes de l'Alsace, met le siège devant les petites villes et se fait livrer tous les enfants d'Israël qu'il immole en vertu dela mission qu'il tenait du ciel. Un certain nombre d'entre eux, échappés au massacre de Mulhouse, d'Ensisheim et de Rouffach, se réfugient auprès de leurs coréligionnaires de Colmar, où déjà, en 1293, ceux de Rouffach avaient trouvé un asile contre les poursuites de l'évêque de Strasbourg. Armleder eut l'audace de venir réclamer ses victimes, et sur le refus de les lui livrer, il se dédommagea en ravageant le territoire de la ville.
Cette générosité, démentie aussitôt après, n'était peut-être pas absolument. désintéressée. Colmar avait éprouvé que les Juifs, pressés par tout l'Empire comme une éponge à laquelle on fait rendre le liquide dont elle s'est gonflée, pouvaient lui être de quelque profit. La ville avait pris une large part à la lutte que l'empereur Louis de Bavière avait eue à soutenir contre son compétiteur Frédéric-le-Beau et contre le Saint-Siège, et quoiqu'elle eût fortement penché d'abord pour le descendant des Habsbourg, une fois qu'il l'eut reprise en grâce, Louis IV ne trouva pas moins qu'elle avait fait en sa faveur des sacrifices considérables, et par un diplôme daté de Bâle, 19 août 1330, il accorda aux bourgeois dispense de payer aux Juifs, pendant deux ans, les sommes qu'ils leur devaient. Cette faveur coûtait moins à Louis que s'il avait concédé à la ville le produit de l'impôt spécial dû par les Juifs. Mais il n'en avait garde. Quatre ans après, le 20 août 1334 à Constance, on le voit mander au prévôt, au bourgemestre, au conseil et à la communauté de Colmar de prêter aide et conseil à noble homme Jean de Ribeaupierre, lieutenant du grand-bailli en Alsace, chargé de faire pour son compte la rentrée de la contribution et des autres redevances des Juifs de leur ville.
Cependant après le soulèvement d'Armleder, malgré la belle conduite de Colmar, l'empereur n'était pas tellement rassuré sur le compte des Juifs réfugiés dans ses murs, qu'il ne crût prudent d'intervenir. Inutile de dire que Louis de Bavière ne faisait pas exeption à la règle et que les sentiments qu'il portait aux Juifs n'étaient rien moins que désintéressés.
Pour lui, le peuple d'Israël était comme la poule aux oeufs d'or, une de ces ressources précieuses qu'il importait de ménager, parce que dans les nécessités de l'Empire il y avait là toujours matière à extorsions. Le mieux était d'intéresser la ville à la conservation de ses hôtes, et l'empereur crut atteindre ce but en déclarant, le 13 mars 1338, à Colmar, le prévôt, le conseil et les bourgeois responsables pendant deux ans, corps et biens, dettes et taxes, des Juifs qui habitaient parmi eux, jusqu'à concurrence des sommes dont ils étaient redevables envers l'Empire.
Veut-on savoir au juste à combien se montaient les sommes que l'empereur pouvait à cette époque tirer des Juifs de Colmar ? Une assignation du 16 septembre de la même année nous en fournit le chiffre exact. Pendant que la contribution de la ville n'était à cette époque que de trente trois marcs, soit de sept cent cinquante livres de Bâle, celle des Juifs, payable comme la première à la Saint Martin, montait au chiffre énorme de quatre mille livres de Bâle, c'est-à-dire à seize mille livres tournois. Louis de Baviére disposa, en 1338, de cette somme pour solder la dépense qu'il avait faite cette année pendant ses fréquents séjours à Francfort.
Il semble qu'en rendant les villes responsables de la rentrée de la contribution due par les Juifs, l'empereur avait trouvé un excellent biais pour les obliger à les défendre. Mais, dans la pratique, ce mode de perception ne laissa pas que d'avoir ses inconvénients. Il habitua les villes à compter avec les Juifs; il leur donna le droit de s'immiscer dans leurs affaires, de se rendre compte de leurs profits, de les pressurer, de les soumettre à des avanies, en même temps que les fréquentes assignations de l'empereur les fatiguèrent. Quand dix ans plus tard la peste noire vint exercer ses ravages, quand les populations épouvantées accusèrent les Juifs de les empoisonner, à la haine furieuse que cessoupçons soulevèrent vinrent se joindre des convoitises qui la rendirent implacable. De toutes parts on se rua sur les enfants d'Israël, et peu s'en fallut que l'extermination ne devînt générale. Le fer et le feu donnèrent satisfaction à la rage des persécuteurs, et à Colmar, la Fosse-aux-Juifs (Judenloch), canton de la banlieue où, comme à Strasbourg, on les brûla en masse sur un bûcher commun, rend encore témoignage de leur supplice. En même temps la ville mit la main sur leurs biens.
C'est alors qu'intervint Charles IV, nouvellement revêtu de la dignité impériale. Le massacre des Juifs lui importait peu, mais la confiscation de leurs biens le touchait au vif. Les Juifs étaient serfs de la chambre impériale ; à ce titre l'empereur pouvait prétendre à leur succession. Colmar avait dépassé toutes les mesures, non pas en immolant les Juifs, mais en les dépouillant: ce fut sur ce point que Charles 1V l'attaqua. Le 2 avril 1349, il lui dépêcha de Spire le bailli provincial de la basse Alsace, Jean de Vinstingen ou de Fénétrange, pour régler les difficultés survenues au sujet des biens desJuifs qui avaient été massacrés, en lui donnant pleins pouvoirs de relever les auteurs et les complices du massacre de toutes les peines qu'ils avaient encourues, sous la condition que le prévôt, le conseil et les bourgeois de Colmar mettraient le bailli provincial en possession des biens délaissés par les victimes. En même temps il lui remit, en l'antidatant, une absolution en règle du crime qui avait été commis, absolution que Jean de Vinstingen délivra à la communauté de Colmar, dès qu'il eut obtenu "une part suffisante" des biens dont les bourgeois s'étaient emparés.
Cette transaction ne mit pas fin aux difficultés. En 1347, l'empereur avait engagé à Bourcard d'Eptingen, dit Sporer, à Rodolphe von der Warte et à d'autres créanciers, le produit de la contribution des Juifs de Colmar. Ainsi Bourcard d'Eptingen touchait annuellement, pour un capital de deux marcs d'argent, ou de deux mille livres tournois, un intérél de vingt marcs on de dix pour cent. Comme de raison, les porteurs de ces délégations prirent leur recours contre la ville qui avait anéanti leur hypothèque et, après avoir satisfait Charles IV pour le meurtre desJuifs, Colmar dut encore éteindre les dettes de l'empereur à valoir sur la contribution des Juifs. Le mode d'administration en usage se prêtait facilement à des quiproquos de ce genre, et Charles IV le prévoyait lui-même, quand par un diplôme daté de Nuremberg, 12 février 1348, il mandait aux villes impériales d'Alsace que, dans l'impossibilité de se souvenir en tout temps des droits qu'il leur avait reconnus ou accordés, il les autorisait à considérer comme nuls et non avenus tous ceux de ses actes qui renfermeraient des dispositions contraires à leurs franchises et bonnes coutumes. Malheureusement, dans cette circonstance, Colmar ne put se prévaloir de l'exception. Avec Bourcard d'Eptingen notamment, le conflit dégénéra en hostilités ouvertes. Le réclamant trouva des alliés dans sa famille, et ce ne fut sans doute que contraint par la force qu'il souscrivit, le 12 juin 1352, à Sainte-Croix, une paix de cinquante ans avec la ville de Colmar. Il s'engagea pour tout ce temps à ne pas faire valoir ses titres contre elle. Si, passé ce délai, il ne voulait pas laisser prescrire ses droits, il s'obligeait à lui en donner avis dix ans avant l'expiration de la trêve, et si, pour appuyer ses prétentions, il devait de nouveau recourir aux armes, il s'engageait à dénoncer la reprise des hostilités huit jours à l'avance. Dans cette convention intervinrent, outre Berthold de Bucheck, évêque de Strasbourg, Conrad d'Eptingen, dit Sporer, frère du signataire du traité et chanoine de la cathédrale de Bâle, et ses deux oncles les chevaliers Conrad et Bourcard Münch de Landscron. Il est vrai que le même jour - pour s'éviter la peine de poursuivre cette affaire à un demi-siècle de là et probablement sans faire à ses associés la part dont il était convenu - Bourcard d'Eptingen donnait sous main à la ville quittance pleine et entière de tout ce qu'il avait à prétendre.
En Europe les supplices peuvent bien faire disparaître des individus et des générations: ils ne peuvent pas anéantir une race. Moins de quarante ans après les exécutions en masse qui avaient accompagné l'apparition de la peste noire, on retrouve des Juifs à Colmar. Ce fut le roi des Romains, Wenceslas, qui demanda à la ville de les admettre. Colmar ne fit aucune difficulté, et les autorisa à convertir en lieu de sépulture un enclos qui leur appartenait devant la porte de Deinheim ; on consentit à ce qu'ils y enterrassent non seulement les Juifs de la ville, mais encore ceux du dehors, en s'engageant à prévenir ou à empêcher tout ce qui pourrait les troubler dans la jouissance de leur cimetière, comme dans les cérémonies de leurs funérailles. La rentrée des Juifs à Colmar, précédée du reste par quelques admissions partielles au droit de bourgeoisie, est constatée par une charte de1385 au nom de la ville. Chose curieuse, Wenceslas revint presque aussitôt sur cette mesure. Mais la ville, réconciliée à ce moment avec les enfants d'Israël, ne se prêta pas à les expulser de nouveau, et pour ce fait le tribunal aulique la condamna, comme les Juifs, au ban de l'Empire.
A la sollicitation de la ville et sur la recommandation du bailli provincial Stislas von der Weitemühle, qui rendit témoignage de sa bonne conduite et de son attachement au chef de l'Empire, quand la plupart des villes impériales se liguaient contre lui, le successeur de Charles IV releva les uns et les autres, par deux diplômes datés de Prague, 20 mai 1388, de la sentence rendue contre eux. Le même jour, par un troisième diplôme, Wenceslas accorda pour dix ans aux bourgmestre, conseil et bourgeois de Colmar, les contributions que la communauté juive devait à l'Empire. Le présent était considérable, mais soit qu'il fût grevé de certaines charges auxquelles le ville ne voulut pas souscrire, soit que Wenceslas eût disposé d'une autre manière du revenu qu'il tirait des Juifs de Colmar, peu de temps après, les Juifs, excités par la ville, "se laisssèrent détourner de l'obéissance qu'ils devaient à l'empire", et furent remis de nouveau au ban, et avec eux, comme précédemment, les bourgeois de Colmar. Ce ne fut que le 29 novembre 1389 que, de part et d'autre, ils reçurent leur absolution du prince fantasque et extravagant qui occupait alors le trône impérial.
A ces rigueurs succédèrent de nouvelles grâces, non pour les Juifs, mais pour la ville. En 1392, le roi des Romains déclara les bourgeois et les manants de Colmar quittes de toutes les dettes qu'ils avaient contractées auprès des Juifs, et il existe deux sentences de Henri Bescheler, lieutenant du chevalier Pierre de Saint-Dié, prévôt de Colmar, du 19 juillet de cette année, par lesquelles il prononce, au nom de l'Empire, la nullité de toutes les créances dont la communauté juive de Colmar était porteur contre les Chrétiens de la ville. Les Juifs durent comparaitre et acquiescer personnellement à ce jugement inique. Je ne sais si les comparants qui figurent dans ces deux chartes représentent la communauté entière. Celle énumération comprend en tout vingt-neuf personnes, dont dix neuf chefs de ménage. L'un d'eux, Vifelin de Paris, a, comme les patriarches, deux femmes portant les jolis noms de Joséa et de Méléa. Un autre Vifelin est médecin. Puis viennent des Juifs de Spire, de Fribourg, de Haguenau, de Kaysersberg, de Türkheim, de Herrlisheim.
Cette mesure qui ruinait les Juifs de Colmar parait avoir eu un caractère assez général. Du moins existe-t-il dans nos archives une lettre-patente du bailli provincial Borziwoy de Swinar, datée de Prague, 19 juin 1397, par laquelle il atteste que du temps où il eut à sévir contre les Juifs d'Alsace, le roi des Romains avait réellement annulé toutes les créances des Juifs contre les chevaliers de l'Empire. Ainsi, cette grâce, qui profite à la fois à la ville de Colmar et à la noblesse immédiate, était en même temps un châtiment infligé pour une cause inconnue.
Cet heureux accord entre la ville et l'Empire, auquel les Juifs durent leur rentrée à Colmar, avait peu duré et ne se rétablit plus. La politique des empereurs put encore varier à leur égard ; elle pouvait, suivant les circonstances, leur être favorable ou contraire : pour la ville, elle ne se départit plus des sentiments hostiles qui se manifestèrent à chaque occasion et qui, à plus d'un siècle de là, ne devaient même pas se tenir pour satisfaits de l'expulsion des Juifs.
Une première fois le magistrat contesta aux Juifs le droit d'agrandir leur cimetiére. ll fallut un jugement arbitral de Jérothée de Rathsamhausen, confirmé, le 5 septembre 1419, par le comte Bernard d'Eberstein, lieutenant du bailli provincial d'Alsace, pour sanctionner le fait de cet agrandissement, mais sous la condition que la communauté ne dépasserait plus, sans le consentement de la ville, les limites qui lui furent fixées. La ville de son côté fut invitée à protéger les Juifs sur leur cimetière, soit quand ils creusent les fosses, soit quand ils enterrent leurs morts.
Cette question surgit encore une fois en 1428. Une mortalité effrayante avait de nouveau ravagé l'Alsace en faisant de nombreuses victimes parmi les Juifs. Le cimetière dut encore être agrandi, et grâce à l'intervention de Frédéric de Fleckenstein, successeur du comte Bernard d'Eberstein , la communauté obtint de la ville l'autorisation de joindre à son enclos un jardin qui lui appartenait, mais en s'engageant à ne plus faire d'acquisition de terrains susceptibles d'être ajoutés à son cimetière.
Cette clause était un premier pas dans une voie nouvelle. Jusque-là les Juifs, pour tout le reste hors du droit commun, avaient du moins joui à Colmar de la faculté d'acquérir des immeubles. On ne peut pas douter que la rue qui leur doit son nom ne leur ait été très anciennement affectée, et qu'ils ne fussent propriétaires des maisons qu'ils y habitaient. Or, qui disait propriétaire, disait bourgeois, le droit de bourgeoisie découlant non-seulement de l'admission au sein de la commune, mais encore de la possession d'une parcelle de la terre libre où s'élevait la cité. Le fait est que les premiers noms qui figurent sur les rôles d'admission au droit de bourgeoisie à Colmar, dont les Curiosités d'Alsace avaient commencé la publication, sont précisément ceux de deux juifs. Quand la ville, fatiguée de leur donner l'hospitalité, commença à réagir contre les enfants d'Israël, ce fut précisément sur ce point qu'elle les attaqua, en restreignant pour eux la faculté d'acquérir des immeubles. Le 31 octobre 1437, elle se fit délivrer, par l'empereur Sigismond, un diplôme daté de Prague, portant défense à qui que ce soit de leur vendre on louer des maisons on des emplacements dans l'intérieur des murs ou dans l'étendue de la banlieue, sans l'agrément du pouvoir municipal.
Ces restrictions ne lui suffirent pas longtemps. Dés la seconde moitié du quinzième siècle, on voit poindre l'idée de se débarasser des hôtes qui l'incommodaient tant. L'empereur Frédéric IV dut intervenir pour obliger la ville à les garder. Après lui avoir adressé en vain plusieurs mandements, il envoya à Colmar le chevalier Pierre Velche, son conseiller fiscal général de l'Empire, pour ramener le magistrat et le conseil à l'obéissance qui lui était due. Mais, par ses plaintes et ses remontrances, la ville avait du moins obtenu que le nombre des ménages qu'elle avait à admettre fût réduit à deux, et de concert sans doute avec le commissaire impérial, elle rendit, le 27 octobre 1468, le décret suivant qui fait bien comprendre la fonction économique que les Juifs remplissaient alors :
- Les Juifs établis à Colmar devront jurer d'obéir au prévôt, aux stettmestres, au conseil et particulièrement à l'obristmestre, en tout ce qu'on leur ordonnera dejuste, d'être portés pour les intérêts de la ville, et de faire leur possible pour lui éviter malencontre.
- S'il s'élève une contestation entre un Juif et un bourgeois ou manant de Colmar, il ne devra l'actionner que devant le tribunal de la ville.
- Les Juifs se garderont d'acheter ou de recevoir en gage un objet mobilier provenant de vol ; si cependant ils ignorent l'origine du meuble et agissent de bonne foi, ils ne pourront pas être poursuivis, en ayant toutefois la précaution de prendre par écrit le nom de celui de qui ils le tiennent.
- Si dans le délai de quatre semaines le propriétaire légitime réclame l'objet vendu ou engagé, le Juif ne devra rien celer de ce qu'il sait, mais ne se dessaisira du meuble à aucun prix ; il renverra le réclamant devant le prévôt de Colmar, qui recevra la plainte et assignera le Juif. Celui-ci confiera au prévôt le nom de la personne de qui il tient l'objet en litige, et le plaignant pourra le reprendre en payant au Juif la somme que celui-ci en avait donnée, sauf au volé à prendre son recours contre le voleur. Mais s'il nedégage pas son bien dans le délai d'un mois, le Juif pourra en disposer librement.
- Défense est faite aux Juifs de prêter à un bourgeois ou manant de Colmar sur hypothèque, sur cédule ou sous caution; ils ne bailleront d'argent que sur un gage qui par son volume se prête à être charrié ou porté par un seul homme. Par semaine l'intérêt sera d'un pfenning pour un florin et au-dessous jusqu'à six schelling, soit, en admettant le florin à 10 schelling et à 120 pfenning, de 43 1/3 à 70 pour cent par an ; d'un helbling ou d'un demi-pfenning pour six schelling et au-dessous jusqu'à deux schelling, soit de 36 à 108 pour cent. Au-dessous de deux schelling l'intérêt est d'un helbling par deux semaines. Cependant si le Juif prête sans exiger de gage, le principal seul et non l'intérêt pourra donner matière à procès.
- Si les Juifs sont réfractaires à une ordonnance de l'empereur ou de tout autre personnage, ils seront responsables envers la ville de tout le dommage qui pourra en résulter pour elle.
- Ils observeront fidèlement toutes les libelles de la ville, et n'achéteront aucun immeuble ni dans la ville ni au dehors sans l'agrément du conseil.
- Ils paieront à la ville l'impôt annuel et contribueront à l'entretien de ses fortifications ; de plus, comme decoutume, ils donneront des étrennes au magistrat.
- Si pour une guerre, ou pour tout autre motif, il est nécessaire de frapper la commune d'une contribution extraordinaire, les Juifs y participeront proportionnellement comme les autres habitants.
- Pendant la semaine sainte, les fêtes de Pâques, à la Fête-Dieu, aux fêtes de Notre-Dame, ils resteront chez eux sans se faire voir dans les rues.
- Ils n'auront chez eux que leurs enfants non mariés et leurs domestiques, et ne pourront pas plus d'une nuit donner asile à un coréligionnaire de passage, à moins d'une permission du magistrat.
- Le Juif étranger qui voudra entrer en ville paiera un blappert ou demi-schelling à la porte, et au portier un pfenning. S'il passe plus d'une nuit à Colmar, pour chaque nuit en sus il acquittera un schelling, au paiement duquel on pourra obliger son hôte.
- Enfin la ville ne sera tenue de protéger les Juifs que contre les violences de ses propres justiciables. Ils ne seront pas fondés à invoquer son intervention contre les vexations du dehors.
Le Juif qui prêtait serment enfonçait, jusqu'au poignet, la main dans un exemplaire du Pentateuque, et répétait, mot pour mot, le texte dont le magistrat lui donnait lecture :
- "Adonaï, Dieu éternel et tout puissant, toi qui règnes sur tous les malahim (anges), unique Dieu de mes pères, je t'invoque, toi, ton saint nom et ta toute puissance ; aide-moi â tenir le serment que je dois prêter aujourd'hui, et si je jure à tort ou par fraude, puissé-je être privé de toutes les grâces du Dieu éternel; que toutes les peines et toutes les malédictions dont Dieu a menacé les Juifs maudits retombent sur moi; que mon âme ni mon corps n'aient part aux promesses que Dieu nous a faites et que je ne puisse prétendre ni au Messie ni â la terre promise d'Israël."
- "Je promets aussi et j'atteste Adonaï, le Dieu éternel, que je ne veux demander, solliciter où accepter, ni chez les Juifs, ni chez les Chrétiens, aucun éclaircissement, explication, exonération ou dispense, qui puisse me permettre de tromper qui que ce soit au moyen du serment que je vais prêter."
Ce n'était là que l'introduction au serment proprement dit. Il commençait par une nouvelle invocation : "Adonaï, créateur du ciel, de la terre et de toutes les créatures, le mien comme celui de tous les hommes qui m'entourent, j'invoque en ce jour ton saint nom en témoignage de la vérité de mes paroles." Comme de raison, le serment se modifiait suivant les circonstances auxquelles il s'appliquait. Il se terminait par de nouvelles imprécations : "Si le droit ou la vérité me fait défaut en cette affaire, si j'use de mensonge, de fausseté ou de fraude, que je sois horam (excommunié) et maudit dans l'éternité ; que je sois englouti et consumé par le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe; que toutes les malédictions consignées dans la Thora reposent sur moi ; que jamais le vrai Dieu qui a créé les feuilles et l'herbe et toutes les créatures, ne m'assiste dans mes affaires et dans mes nécessités. Mais si je dis vrai et que j'aie raison, puisse le vrai Dieu Adonaï me venir en aide!"
Cette cérémonie redoutable se terminait par une allocution du magistrat qui présidait, pour rappeler encore une fois au Juif la sainteté du serment qu'il venait de prêter.
II
L'histoire des communes est depuis longtemps l'objet d'études consciencieuses et savantes, et cependant je doute qu'elle soit connue au point de rendre compte de tous les faits généraux qui s'y rattachent. Comment se fait-il par exemple que dans nos provinces, où les villes les moins importantes ont pu, dans le treizième et le quatorzième siècle, élever leurs magnifiques cathédrales, doter royalement des communautés de nombreux établissements charitables et religieux, comment se fait-il, dis-je, que dès le commencement du seizième siècle, Bilibald Pirkheimer, conseiller de l'empereur Maximilien et ami d'Albert Durer, qui a gravé son portrait, l'un des plus savants hommes de son temps et des plus à même de bien observer, constate un affaiblissement général de toutes les grandes communes allemandes? Cette observation se justifierait d’elle-même si elle était plus récente d'un siècle: à ce moment, en effet, les villes de l'empire amenées peu à peu à prendre à leur compte la plupart des obligations de l'État, y compris les charges militaires, et qui venaient notamment de renouveler leurs vieilles fortifications conformément aux progrès de l'art de la guerre, entraînées, en outre, à tenir tête au pouvoir central qui commençait à se reconstituer, épuisaient leurs dernières ressources sans voir de terme à d'incessants sacrifices. Mais tel n'était pas l'état des choses au début du seizième siècle, et je crois que des raisons économiques peuvent, seules nous faire comprendre cette décadence signalée par Pirkheimer.
A leur origine, au douzième siècle, les communes ne devaient avoir guère d'autres capitaux que la terre, retenue par un petit nombre de familles et de communautés, et un certain nombre d'instruments de travail tout à fait élémentaires. C'était à chacun à en tirer le meilleur parti possible, et si la terre semblait constituer pour quelques-uns un monopole écrasant la supériorité du travail industriel, la haute valeur de ses produits rétablissaient l'équilibre entre les deux éléments de production. Aucun n'était assez puissant pour peser sur l'autre, et cette indépendance réciproque ne contribua pas peu à l'affranchissement politique des corps de métiers. Mais les aptitudes, la chance et la prévoyance étant inégales, les proportions primitives ne tardèrent pas à se troubler profondément. Le capital, sous toutes sesformes, se concentra de plus en plus entre les mains d'un petit nombre, au grand dommage du travail qui, réduit à ses seules forces, ne pouvait lutter contre ce monopole. Avec les restrictions que la loi civile et religieuse opposait au prêt à intérêt, le numéraire ne pouvait s'offrir librement au travail. C'est là ce qui avait créé d'abord en faveur des Juifs un privilège si onéreux pour la production.
Mais le numéraire n'avait point passé tout entier chez les enfants d'Israël, et quand les grandes constructions religieuses du moyen âge eurent cessé d'être pour les fidèles, le meilleur de tous les placements, le seul que la mort ne leur faisait point perdre et auquel elle donnait toute sa valeur, les anciennes rentes foncières suggérèrent l'idée des constitutions de rente sur les biens-fonds. Il pouvait en coûter aux Chrétiens de louer leur argent, mais il leur était loisible de l'engager dans la terre qui lui servait d'hypothèque, avec laquelle il se confondit, et qui se greva ainsi à perpétuité d'une rente plus ou moins lourde. En ne distinguant pas le produit de son travail de celui de l'immeuble, le premier emprunteur, commerçant ou artisan, pouvait peut-être, sans s'obérer personnellement, contracter à ces conditions, mais la charge qu'il s'imposait n'était pas rachetable et, s'ajoutant à d'autres que s'imposaient ses successeurs, elle finit par surcharger la propriété, et spécialement la propriété bâtie, de redevances qui n'étaient plus en. rapport avec le produit. De là toutes ces sentences éparses dans nos archives, qui adjugent au propriétaire de la rente, communauté ou particulier, le bien-fonds qui ne peut plus s'acquitter. Pour s'affranchir on en vint à ne plus entretenir les maisons sujettes à des rentes trop lourdes, et c'est ainsi que, le 6 novembre 1516, la ville de Colmar se fit accorder par l'empereur Maximilien 1er le droit de se mettre en possession de toutes celles qui, tombant, en ruine, ne seraient pas rebâties dans le délai d'un an. Peu après, dans la pensée de retirer la terre de son asservissement, elle obtint du même empereur un second diplôme, daté du 6 décembre 1615, qui autorisait les bourgeois de Colmar à racheter les rentes dont leurs propriétés étaient grevées.
Mulhouse possède un mandement en tout semblable, qui remonte à 1498, et je ne doute pas qu'on ne trouve ailleurs des actes de méme nature appliqués comme remèdes à des situations pareilles.
La croisade contre les Juifs avait un but analogue. Sans doute comme bailleurs de fonds ils n'avaient plus leur importance primitive ; la meilleure preuve, c'est que dans le règlement que nous venons de voir il n'est plus question que de sommes minimes et de prêts à la semaine; mais encore était-ce rendre service aux besogneux de ne pas les priver de cette ressource, sans compter que sous d'autres rapports le rôle des Juifs avait son utilité et qu'une foule d'objets ne devaient leur valeur qu'à leur intervention. Au lieu de s'en prendre à eux, mieux aurait valu recourir à l'admirable institution des monts de piété, qui remonte à cette époque et qui était la meilleure garantie contre des usures par trop criantes.
Mais à cette époque on préférait attaquer les abus de front. Dès l’année 1478, obligée de soutenir un procès à la cour de Frédéric IV, la ville avait chargé son député, le stettmestre Jean Hutter, le même qu'elle envoya en 1481 à la diète des villes à Esslingen, de présenter de nouveau ses doléances à l'empereur sur les inconvénients qui résultaient pour elle de l'obligation d'avoir des Juifs résidents, et de demander qu'après avoir été autorisée à ne plus accorder le domicile qu'à deux familles, elle pût se débarrasser complètement des Juifs. Mais Frédéric IV ne tenait pas à renverser ce qu'il avait établi dix ans auparavant, et parmi plusieurs autres demandes, celle-ci fut pour ainsi dire la seule qui resta comme non avenue.
Le moment n'était pas favorable à l'oubli et à l'apaisement. Martin Schongauer, le maître de Colmar, gravait alors sa Passion et faisait peindre dans son atelier, non sans y mettre l'empreinte de son génie, les stations destinées à l'église des Dominicains, conservées aujourd'hui au Musée de la ville. L'artiste n'exprimait que les sentiments de ses contemporains en peuplant ces scènes pieuses de Juifs grimaçants, dont les physionomies outrées rappelaient certainement aux fidèles des types familiers. A une époque de foi des grotesques pareils étaient bien de nature à exciter les imaginations, à éveiller les rancunes, à fomenter les haines. Plus d'un débiteur à qui ses créanciers faisaient parcourir à leur manière les stations du Golgotha, pouvait se représenter la chrétienté entière sous la destinée de Jésus. Ce n'est pas trop dire que d'avancer que lespeintures de Schongauer n'ont pas été sans influence sur l'implacable acharnement de la ville contre les Juifs et sur la guerre sans trêve qu'elle leur fit jusqu'à la Révolution. Combien était différente la conduite qu'elle avait tenue peu d'années auparavant, dans les premiers temps du règne du même Frédéric 1V, quand elle prit avec chaleur le parti d'un Juif à qui l’on réclamait, au nom de l'Empire, l'impôt du denier d'or qu'il avait déjà payé au bailli provincial ! Elle alla jusqu'à rendre l'empereur même juge du peu de fondement de la réclamation.
Ce que Frédéric IV avait refusé, on voulut l'obtenir de son successeur. Au mois de décembre 1507, on envoya un message à l'empereur Maximilien 1er pour lui demander l'autorisation d'expulser les Juifs, ainsi que d'autres villes de la grande préfecture de Haguenau l'avaient déjà fait. Maximilien prit la demande en considération et donna commission à Rodolphe de Blumeneck de se rendre à Colmar pour étudier la question.
L'enquête qu'il fit donna un résultat conforme aux voeux de la ville. Malgré cela la solution se faisait attendre. Le magistrat, impatienté de ce retard, écrivit, le 11 avril 1508, au chancelier Cyprien de Sernlein pour se recommander à lui. On le pria de ne pas taxer l'expédition du mandement impérial à plus de cinquante florins, vu le mauvais état des finances municipales, mais en même temps on lui promit cent florins, si tout se passait au gré de la ville.
Malgré cela l'affaire traîna jusqu'en 1510 ; le 22 janvier de, cetteannée, Maximilien 1er signa un mandement qui autorisa la ville à expulser les Juifs dans un bref délai.
Quand leurs affaires les obligeront à venir à Colmar, ils devront porter une rouelle jaune sur leurs habits, et payer le péage spécial dont le produit sera applicable aux fortifications. Un second mandement du 25 avril de la même année, adressé directement aux Juifs, leur confirma celui du 22 janvier, en leur fixant jusqu'à la Toussaint pour quitter la ville.
Mais l'exécution des ordres impériaux éprouva des lenteurs et des difficultés qui donnent une triste idée du respect que leur portaient même les agents chargés d'y veiller.
Le 24 octobre, Guillaume de Ribaupierre, bailli provincial des possessions autrichiennes en Alsace, fit défense au magistrat de Colmar de mettre la main sur le cimetière des Juifs, parce qu'il était à l'usage non seulement de ceux de la ville, mais encore de tous ceux des domaines autrichiens, et qu'il allait en référer à l'empereur.
D'un autre côté, Maximilien 1er avait déjà fait don de ce cimetière, ainsi que de deux maisons servant de synagogue, à son secrétaire Jacques Spiegel, de Sélestadt, et le 7 octobre il avait même chargé Michel Rewtner, son bailli forestier à Fribourg, d'assurer l'exécution de ses ordres.
En recevant la défense de Guillaume de Ribaupierre, l'embarras de la ville fut grand. C'était une preuve certaine que les Juifs agissaient de leur côté, et qu'ils avaient gagné à leur cause de puissants protecteurs. Cependant elle apprit de bonne source que l'empereur, saisi dela prétention des Juifs, avait exprimé l'intention de trancher la question par lui-même. Le fait est que le bourgmestre et le conseil d'une part, la communauté juive de l'autre, furent invités, le 10 janvier 1511, à comparaître à Fribourg, où Maximilien voulait les entendre contradictoirement.
Cette audience paraît avoir tourné conformément aux voeux des Colmariens. La ville acheta de Jacques Spiegel l'enclos qu'il tenait de la munificence de son maître, et supprima le cimetière. Les Juifs, outrés de ne pas obtenir justice de l'empereur, essayèrent de porter leurs doléances en cour de Rome. On déterra une bulle du pape Grégoire X (1271-76) - soit dit en passant, elle manque dans le grand Bullaire romain - qui menaçait des peines ecclésiastiques les violateurs des sépultures juives. Les Juifs s'entendirent avec quelques prélats réunis à Fribourg et se firent délivrer un vidimus de la bulle. Les choses en vinrent au point que Henry Gessler, notaire du juge apostolique à Fribourg, fit engager officieusement la ville, le 7 avril 1511, à constituer des procureurs à Rome pour éviter de plus grands frais.
Mais les Juifs, satisfaits d'avoir gagné du temps, ne donnèrent pas suite à ce projet. De délais en délais ils étaient arrivés à retarder leur expulsion jusqu'à la Saint-George 1512, l'empereur voulant leur laisser le temps de faire rentrer leurs créances.
La ville se croyait sûre de son coup. Mais elle comptait d'une part sans l'inexpérience des affaires, sans les entraînements de l'habitude, sansles nécessités qui obligent d'accepter les plus dures conditions; de l'autre, elle comptait sans la puissance que donne même à un capital modique une grande activité et une merveilleuse aptitude à le faire valoir. Les Juifs, postés dans les villages les plus rapprochés de Colmar, conservèrent toutes leurs relations avec leurs clients. N'ayant plus à se préoccuper des règlements qui les avaient liés, ils firent le commerce, pratiquèrent l'usure, prêtèrent sur gage et sur hypothèque avec plus de liberté qu'avant leur expulsion. Colmar prit encore son recours auprès du chef de l'Empire, et sur la plainte que le bourguemestre et le conseil lui présentèrent contre les Juifs qui, nonobstant la défense à eux faite de demeurer dans la ville, ne continuaient pas moins à la fréquenter, et qui en profitaient pour réduire à la mendicité ceux des habitants qui avaient le malheur de s'adresser à eux, Charles-Quint ordonna, le 29 juillet 1530, à Augsbourg, qu'à l'avenir les Juifs ne pourront prêter aux bourgeois que sur gage mobilier et non sur hypothèque ou sur cédules.
Cela ne suffit pas encore. Le 22 février 1534, le magistrat fit défendre aux bourgeois de donner asile aux Juifs ou de leur permettre d'entreposer leurs marchandises chez eux.
Les Juifs ne devront avoir de rapports qu'avec les hôteliers pour se procurer les aliments dont ils ont besoin.
C'était exiger beaucoup plus qu'on ne pouvait tenir. Dès le 22 février 1537, le magistrat dut renouveler cette défense, en y ajoutant celle de s'adresser aux Juifs pour le change des monnaies. On sait combien le change avait d'importance à une époque de confusion monétaire, où le droit de battre monnaie avait cessé d'être une attribution suprême de l'État, et où chacun à l'envi altérait lui-même les espèces qu'il frappait. Colmar, qui avait son atelier particulier, avait en même temps son changeur.
 |
Il serait curieux de savoir le nombre de ces malheureux que la ville traquait et pourchassait avec tant d'acharnement. On se souvient qu'avant leur expulsion il n'y avait plus à Colmar que deux familles. En 1540, la régence d'Ensisheim, obligeant par une mesure générale tous les Juifs de sa dépendance à renouveler les sauf-conduits périmés par suite de la mort du gouverneur qui les avait délivrés, eut occasion de faire le recensement des Juifs de presque toute l'Alsace supérieure et n'y trouva que cinquante-deux chefs de famille ressortissants des domaines autrichiens, savoir :
Un à Ensisheim, dix-sept à Oberbergheim, y compris un rabbin, huit à Réguisheim, un à Isenheim, un à Batenheim, un à Rixheim, un à Münchhausen, trois à Habsheim, un à Pfastadt, trois à Morschwihr, trois à Wintzenheim, six à Türkheim, quatre à Kiensheim, un à Ammerschwihr, un à Orschwihr.
L'impuissance que lq ville se sentait contre l'obstination de cette poignée d'hommes devait l'exaspérer. Et ce n'était pas seulement contre la force des choses qu'elle avait à lutter, mais encore contre une résistance formelle qui prenait son point d'appui auprès de l'empereur, de même que la persécution dont ils étaient l'objet de la part de la ville. On peut même dire qu'à chacun des coups qu'elle leur portait, les Juifs lui opposaient une parade appropriée. Ainsi quand elle obtint, le 29 juillet 1530, le mandement impérial qui leur défendait de prêter à ses bourgeois sur hypothèque ou sur cédules, ses adversaires se faisaient confirmer par Charles-Quint, le 12 août suivant, un privilége de l'empereur Sigismond portant :
- Que les engagements écrits ou verbaux contractés envers les Juifs seront reçus en justice ;
- Que faute d'être remboursés dans l'année, ils pourront vendre les gages sur lesquels ils auront fait des avances ;
- Que toutes les routes leur seront ouvertes, et qu'ils y jouiront de la même protection que les Chrétiens ;
- Qu'on ne pourra les soumettre à d'autres péages qu'à ceux qu'ils payaient anciennement ;
- Qu'on ne doit pas leur imposer le baptême ;
- Que nulle seigneurie ne pourra se les attribuer, attendu qu’ils relèvent uniquement de la chambre impériale ; seront libres d'aller d'une ville dans une autre ;
- Qu’on ne pourra les assigner que devant le tribunal de la ville ou ils résident ;
- Que le serment que les Juifs prêteront sur les livres de Moïse ne portera que ces mots : "Puisse Dieu me venir en aide par l'alliance qu'il a contractée sur la Montagne de Sinaï" ;
- Que nul témoignage ne sera reçu contre les Juifs si ce n'est celui de personnes dignes de foi et sans inimitié contre eux ;
- Que l'empereur s'interdit le droit d'aliéner les Juifs.
De même lorsque, le 11 avril 1541, Colmar obtint contre les Juifs la défense de se rendre dans la ville à moins d'une permission de l'obristmestre, le 24 mai suivant, l'empereur confirma en général tous les privilèges qui protégeaient les Juifs dans leurs personnes et dans leurs biens, et défendait de les expulser des lieux où ils faisaient leur résidence, ou de leur interdire l'entrée des villes, des bourgs et des villages où ils avaient besoin de se rendre.
Ce n'étaient point les seules garanties que les Juifs pouvaient invoquer. Colmar se plaignait surtout de leurs usures. Ils répondirent en produisant un extrait d'une constitution impériale non datée qui, en considération de l'inégalité des charges qui pèsent sur les uns et sur les autres, et de l'impossibilité où les Juifs se trouvent de posséder des terres et d'exercer des emplois ou des professions chez les Chrétiens, autorisait les Juifs à prêter à un taux plus élevé que l'intérêt légal.
A ce moment les Juifs d'Alsace reconnaissaient pour chef (Befehlshaber) Rabbi Jésell ou Jeslé, de Rosheim. Il est facile de comprendre que dans une société comme celle du moyen âge, formée d'agrégations diverses assez distinctes les unes des autres, les Juifs aient dû se constituer à peu près de la même manière que ces groupes, avec des juges et une juridiction particulière. Ils s'adressèrent pour faire juger les difficultés qui survenaient entre eux à des coréligionnaires distingués par leurs vertus, par leur piété, par leur science ou leur caractère. Ces hommes, dont l'autorité morale s'étendait souvent au loin, à qui il était défendu de se faire donner le titre de roi, mais qui prirent en quelques endroits les noms d'évêques et même de papes des Juifs, devinrent les représentants et les défenseurs des intérêts juifs dans leurs rapports avec l'empire, avec les princes, avec les cités. Tel était Rabbi Jésell, à qui Colmar s'était déjà adressé, en 1534, pour se plaindre des Juifs qui faisaient le change à Colmar. Ce fut encore à lui que la ville s'adressa, le 16 août 1541, pour signifier aux Juifs, après le rescrit du 11 avril précédent, qu'aucun d'eux ne sera plus admis à Colmar sans une autorisation spéciale.
Fort du droit que le diplôme impérial, du 24 mai de la même année, leur confirmait, Jésell ne se pressa point de répondre. Ce ne fut que le 1er juin de l'année suivante qu'il offrit de venir en personne s'entendre avec le magistrat devant le conseil réuni. Il rappela qu'il s'était appliqué de tout temps à aplanir les difficultés entre Juifs et Chrétiens, qu'il y était souvent parvenu avec l'aide de Dieu et des hommes de bonne volonté, et il espérait qu'il ne serait pas moins heureux à Colmar.
On lui répondit, le 3 juin, qu'on était prêt à recevoir ses observations écrites, mais il ne paraît pas qu'on ait consenti à s'entendre avec lui de vive voix.
En dépit de tout, les relations d'affaires des Juifs avec les habitants continuaient presque sur le même pied qu'autrefois, avec cette seule différence que lorsque les premiers avaient à faire une réclamation contre un bourgeois, ce n'était plus au magistrat de Colmar qu'ils portaient leur plainte. Cependant les privilèges les plus positifs établissaient en première instance la juridiction de la ville dans toutes les causes où l'un de ses justiciables avait à sc défendre, sauf à porter les appels successivement devant le tribunal aulique de Rothweil et devant la chambre impériale de Spire. Depuis 1516 la ville tenait même de l'empereur Maximilien 1er le droit de juger sans appel toutes les affaires dont l'importance ne dépassait pas cinquante florins. Mais quand les Juifs ne purent plus faire reconnaître à Colmar la validité de leurs titres les mieux fondés, ils franchirent le degré inférieur et actionnèrent leurs débiteurs de Colmar directement à Rothweil. C'est ce qui arriva, notamment en 1544. Le magistat eut beau intervenir, faire valoir son privilége de non citando, le tribunal aulique retint l'affaire et passa outre. La ville ne voulut pas que ce précédent pût être invoqué contre elle et fit formellement ses réserves, mais en même temps elle rendit un décret pour défendre à ses bourgeois de rien emprunter des Juifs, de leur vendre ou d'acheter quoi que ce soit, de rompre tous les engagements anciennement contractés, afin d'éviter qu'en cas de contestation ils eussent lieu de s'adresser à Rothweil.
| Page suivante |