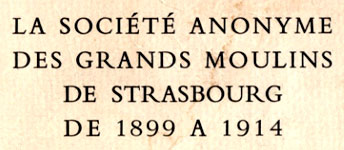 |
qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte."
Epître aux Romains XI.
Mon père, Nathan Baumann, est né en mai 1831 à Fegersheim.
Voici quelques souvenirs qu'il évoquait souvent et que je vous transcris
:
 |
"J'étais l'aîné de quatre enfants et j'ai perdu
mon père quand j'avais six ans. Pour aider ma mère à
subvenir aux besoins de la famille, je dus, dès mon jeune âge,
travailler comme journalier, entre autres chez les frères Meyer, marchands
de grains.
Plus tard, je travaillais à l'Usine de Graffenstaden. J'y allais tous
les matins à pied à 5 heures avec les autres, emportant mon
repas de midi dans ma petite gamelle.
J'ai quitté l'usine pour le motif suivant :
Un soir, en rentrant avec les autres ouvriers de Fegersheim, c'était
un jour de paye, j'eus l'imprudence de me vanter auprès de mes compagnons
de route de la forte somme que j'avais gagnée dans la semaine ou dans
le mois par mon travail à la tâche.
Deux jours après, mon chef d'atelier me faisait venir pour m dire que
mon tarif allait être diminué parce que je gagnais plus que les
ouvriers adultes.
je n'acceptai pas ce nouveau tarif et je cherchai une autre occupation.
Nous avions des parents à Colmar
et à Belfort.
J'y allai et avant de partir ma mère me demanda l'engagement formel
de n'accepter d'argent d'aucun de ces parents et de vivre uniquement du produit
de mon travail.
Le parent de Colmar était marchand de chevaux, celui de Belfort avait
un magasin. Je ne fus pas longtemps absent de Fegersheim. Je rentrai pour
aider ma mère. J'avais réalisé quelques centaines de
francs d'économies qui me servirent à faire le commerce avec
les paysans de Geispolsheim, Plobsheim et Eschau.
Vers 1850 je m'établissai à Illkirch sur la Place du Puits Communal.
La maison, c'est le n°3, existe encore telle qu'elle était à
cette époque. J'y vendais des sons et de la farine en détail.
La farine se trouvait en vrac dans une caisse et quand je rentrais le soir
à Fegersheim, et que la pièce où se trouvait la farine
n'était pas fermée, j'aplatissais le contenu de la caisse et
je la marquais en y inscrivant mon nom en hébreu.
Néanmoins, j'ai dû constater qu'on me volait, bien que je trouvasse
les mêmes caractères hébreux en haut de la farine dans
les caisses. C'était la propriétaire, la femme Beckechangel,
qui me volait en marquant ensuite la farine à ma façon.
J'étais secondé à cette époque par mon frère
Wolf, que notre mère avait destiné à devenir rabbin,
parce qu'il était chétif.
Je pus bientôt acheter un mulet et une petite voiture pour ramasser
le froment chez les paysans, et pour le conduire ensuite à Strasbourg
chez les négociants en gros, auxquels je le vendais. C'était
surtout la maison Seltz et Barotte qui m'achetait le froment, mais aussi les
boulangers de Strasbourg, auxquels je vendais du blé de la région
sud de Strasbourg. Je livrais de l'orge aux brasseurs Hatt-Ansen et à
M. Schutzenberger, qui avait une petite brasserie à la Krutenau et
qui, les dimanches de bal, tenait lui-même la corde pour encaisser les
deux sous d'entrée dans son estaminet.
Plus tard, comme j'avais un peu plus d'argent et que nous voulions éviter
à notre mère le trajet quotidien à pied entre Fegersheim
et Graffenstaden, nous nous fixâmes à Graffenstaden dans la maison
actuellement, route de Lyon n° 243. Une grange y attenait, elle nous servit
de magasin. Une petite épicerie y fut installée. Tout ce commerce
de détail avec la maison fut donné en dot à ma sœur
Zipper, dite Pauline au moment de son mariage avec Meyer-Meyer qui en continua
l'exploitation, au début de 1869.
Ma tante Pauline, qui était une femme remarquable par sa bonté
de cœur, son zèle au travail et par son attachement fervent à
la religion, est morte en 1888 après une longue maladie, laissant une
fille Fany, enfant unique, mariée plus tard avec le frère de
la seconde femme de son père, Kahn de Rheinbischofsheim, où
elle habite encore maintenant."
Je reprends le récit de mon père :
"Après avoir fait moudre jusque-là à Plobsheim
et ailleurs, vers 1855 je pris en location un petit moulin à Erstein,
et je l'exploitai tant bien que mal avec l'aide de mon frère durant
quelques années. Nous continuions à habiter Graffenstaden. C'est
à pied toujours qu'on faisait la navette entre les deux endroits, et
à Erstein on dormait dans le moulin même, sur les sacs de son.
Tandis que j'étais exempt du service militaire en ma qualité
de fils aîné de veuve, mon frère Wolf était appelé
pour tirer au sort, et la malchance nous obligea à lui acheter un remplaçant,
ce qui nous coûta la plus grande partie de nos économies, qui
formaient notre fonds de roulement. C'étaient 3.000 francs".
J'ignore combien d'années mon père eut en bail le moulin d'Erstein,
je suppose que c'est jusque vers 1860. Deux ouvriers meuniers qu'il avait
à Erstein travaillèrent plus tard dans notre moulin à
Illkirch. Je me souviens très bien d'eux.
Le moulin d'Erstein devait être très vieux et dans un état
pitoyable, car il fut dévasté par une crue de l'Ill. Je me suis
fait montrer bien plus tard, en 1910, par l'oncle Wolf, l'endroit où
il avait été situé. Mon oncle était bien ému
de ce pèlerinage.
Deux épisodes me sont restés en mémoire que notre père
nous racontait de cette époque.
Ils avaient comme client un marchand de farine à Mulhouse, si ma mémoire
est fidèle, il s'appelait Goldschmidt. Ce client les chicanait beaucoup.
La farine lui était envoyée par chemin de fer et elle était
payable contre récépissé.
Un jour, mon père devait lui en expédier 100 sacs et quand il
arriva à la gare d'Erstein avec cette farine, le wagon disposé
à cet effet n'était pas prêt. Pour rendre service à
mon père, le chef de gare l'autorisa à déposer la farine
dans le hangar de la gare, d'où elle devait être chargée
le lendemain dans le wagon, et il lui délivra le récépissé
d'avance. Mon père l'envoya le jour même à son acheteur
en le priant de lui faire parvenir la contrevaleur de la facture.
Deux jours après, au lieu de recevoir des fonds, il eut la surprise
d'une lettre recommandée, lui refusant la farine pour défaut
de qualité. Il se rendit à la gare d'Erstein, où il constata
à son grand étonnement que la farine se trouvait encore dans
le hangar. Il pria le chef de gare d'en remettre l'expédition, déclarant
qu'il y avait eu erreur au moulin. Il la remplaça par 100 sacs d'autre
farine de qualité bien inférieure. Il se rendit à Mulhouse
chez son client, avec lequel il s'arrangea moyennant un rabais de 100 francs
sur la facture qui lui fut réglée alors sur le champ.
Quand, deux jours après, le wagon de farine arriva à Mulhouse
et que le client chicaneur se rendit compte de ce qu'il avait eu réellement,
il jeta des hauts cris. L'affaire arriva finalement devant le tribunal de
commerce de Belfort où le client fut débouté du fait
que mon père pouvait présenter au tribunal l'accord par écrit
intervenu au sujet de ces 100 sacs entre son client et lui. Trente ans après,
il en riait encore.
L'autre épisode était le suivant :
"C'était au mois d'août. Il faisait très chaud. J'avais
ramassé chez les paysans de Geispolsheim un chargement d'orge. Je l'avais
conduit à Graffenstaden dans la cour de notre magasin. Je l'avais déchargé
et versé le contenu des sacs sur le tas d'orge qui se trouvait sur
le plancher.
Pendant ce temps, ma mère était occupée dans la maison.
Mon travail accompli, j'allai à l'auberge avoisinante, chez le père
Fels André "A la Carpe" où je commandai un quart de vin. Il
y avait du monde dans l'auberge. Ma mère m'ayant vu sortir me suivit,
rentra dans l'auberge, elle saisit mon verre encore plein, et devant tout
le monde elle le versa dans la salle. "Quand on a soif, on prend de l'eau",
me dit-elle. Sans dire un mot, je me levai et je la suivis à la maison".
Plus tard, à mon avis vers 1862, mon père s'est établi
à Strasbourg au Fossé des Tanneurs n° 22. Sa sœur Mathilde
était avec lui pour l'aider. Il firmait alors "N. Baumann, Commerce
de Grains et de Farines". Il se faisait une gentille et fidèle clientèle
parmi les boulangers de Strasbourg. Son grand appui était Monsieur
Louis Albrecht, meunier de Sand près de Benfeld. Il lui vendait du
blé et plaçait pour lui la farine à la commission dans
les boulangeries de Strasbourg.
En 1862, l'été avait été humide, la récolte
médiocre en quantité et en qualité, Monsieur Albrecht
vint un jour chez mon père au magasin se plaindre de la situation et
du manque de blé panifiable dans la région. "Ne voudrez-vous
pas me rendre le service d'aller pour moi en Lorraine, où, parait-il,
la récolte est un peu meilleure, pour m'y acheter du blé ?"
Mon père, qui était au courant de la question et qui savait
par les journaux que la Hongrie avait eu une récolte exceptionnelle,
lui dit : "En Lorraine, non - en Hongrie, oui".
C'était à cette époque un projet sortant tout à
fait de l'ordinaire. Jamais quelqu'un n'aurait osé y songer. Le seul
qui, comme il le constata plus tard, eut la même idée, était
un marchand de grains de Sierenz, Léopold Dreyfus, qui, avec son père
Louis, exploitait un commerce de grains et qui avait sa clientèle dans
la Suisse voisine.
C'était le fondateur et le futur grand chef de la maison "Louis Dreyfus
& Cie à Paris".
Monsieur Albrecht, qui estimait beaucoup mon père et qui avait en lui
une confiance absolue et bien justifiée, n'aborda le projet d'un voyage
en Hongrie qu'avec beaucoup de réserve. Il fit valoir que sa trésorerie
n'était pas suffisamment à l'aise pour des immobilisations relativement
importantes.
Mon père l'introduisit alors à la Banque Gloxin, dont l'un des
chefs était Monsieur Charles Staehling. Celui-ci se rendant compte
de la portée de l'entreprise, mis au courant de la situation financière
aisée de Monsieur Albrecht et appréciant beaucoup les qualités
commerciales de mon père, n'hésita pas à mettre à
la disposition de Monsieur Albrecht le crédit nécessaire pour
pouvoir importer, le cas échéant, des blés de Hongrie.
Ils partirent alors ensemble pour Vienne et ensuite pour Budapest. Ils se
rendirent vite compte que l'idée de mon père était excellente,
que la récolte en Hongrie était parfaite, tant en qualité
qu'en quantité, et que les prix pratiqués laissaient un rendement
exceptionnel pour l'Alsace.
Monsieur Albrecht rentra après un court séjour, tandis que mon
père restait dans le pays pendant plusieurs mois. Avant tout, il approvisionnait
le moulin Albrecht dans les meilleures conditions possibles, pour s'occuper
ensuite de ses propres affaires. Son frère, aidé par sa sœur
Mathilde, le remplaça très consciencieusement à Strasbourg.
Il vendit des blés de Hongrie tant aux boulangers de Strasbourg, qu'aux
meuniers de la région, dans les Vosges, et jusqu'à Lunéville
et Nancy. Il en vendait aux Intendances militaires. La banque accordait un
crédit considérable à la jeune firme et les bénéfices
réalisés, tant sur les importations de blé que ceux sur
les graines oléagineuses du Danube, dépassaient toute espérance.
Deux ans après, mon père retournait en Hongrie, où il
était alors très bien vu, surtout dans les grands domaines agricoles
(Herrschaftsgüter) du Banat, de la Theiss, Temeswar, Szegedin, etc. Ses
grandes qualités de commerçant, son zèle et sa nationalité
de Français l'aidaient beaucoup.
A Strasbourg, on avait pu prendre un bureau, 8, Quai St.-Jean, on engagea
un jeune employé, Joseph Niedermeyer, qui bientôt, par son travail
assidu et son esprit d'ordre et d'exactitude devint un précieux collaborateur.
Les affaires s'étendaient rapidement et provoquaient la jalousie des
autres maisons de la place.
Quand mon père partit en 1866 pour la Hongrie, il était fiancé.
Ses succès et sa situation lui avaient permis de solliciter la main
de celle qui est devenue son épouse fin 1866 ou commencement 1867.
Elle était réputée comme étant la plus belle jeune
fille israélite de la région. Elle était fille, petite-fille
et arrière-petite-fille de rabbin. Son père était devenu
par son mariage associé dans la firme Hemmerdinger & Cie, marchands
de chanvre à Fegersheim. Il comptait parmi les notables. Elle avait
trois frères, Henry, Meyer et Achille et une sœur Henriette, celle-ci
déjà mariée à Osthoffen
avec Monsieur Dreyfus. Son frère aîné Henry, futur père
du Dr. Maurice Lévy, médecin d'arrondissement à Illkirch,
était marié à une cousine de Monsieur Dreyfus.
Le protecteur et ami de mon père, Monsieur Louis Albrecht à
Sand, était mort sans enfants et laissait son moulin à son neveu
de Sélestat, Monsieur Alfred Albrecht. Ce dernier, comme cela arrive
souvent, crut bien faire en négligeant les relations d'affaires de
son oncle et prédécesseur. Il espaça d'abord les rapports
avec mon père et mon oncle, pour rompre un beau jour brutalement. Il
leur déclara : "Je ne vous achèterai plus rien". Cette rupture
décida mon père à se faire meunier lui-même.
Il hésitait entre le moulin de Fegersheim "Erlenmühle" et celui
d'Illkirch. Les deux étaient à vendre depuis longtemps. Mon
père penchait plutôt alors pour la Erlenmühle, car il voulait
en imposer à la famille de sa fiancée et aux autres coreligionnaires
de Fegersheim, et il fallut la persuasion de son frère, qui comprenait
le grand avantage de l'acquisition de celui d'Illkirch, pour le décider
à acheter les immeubles des futurs moulins d'Illkirch.
Jusqu'au moment de ses fiançailles, mon père travailla avec
son frère sous la raison "N. Baumann". Tout le capital, qui était
alors de 360.000 francs, lui appartenait. Sa mère faisait dépendre
son consentement au mariage de la régularisation fraternelle de la
situation de ses deux fils. Ceci fut fait. Mon oncle fut l'associé
de mon père. La firme fut changée en "Baumann frères"
et mon père céda à son frère un tiers de sa fortune
d'alors, c'est-à-dire 120.000 francs.
L'inventaire d'entrée pour la nouvelle raison sociale, établi
par le seul comptable, Monsieur Niedermeyer, et qui porte la date du 1er août
1866 porte les comptes : Nathan Baumann avec 240.000 francs
Jacques Baumann avec 120.000 francs. La lettre circulaire, par laquelle
les personnes avec lesquelles on était en relations d'affaires furent
mises au courant du changement de la raison sociale, est datée du 1er
août 1866 également.
La propriété à Illkirch fut achetée aux époux
Johann Kolb et Marie-Madeleine Kolb née Mürsch, tous deux habitant
Illkirch, suivant acte notarié établi devant le notaire Wurmser
à Illkirch le 3 novembre 1868. Il comprenait outre le bâtiment
pour le moulin proprement dit, un grand magasin ayant servi de tannerie à
Monsieur Knoderer, la grande maison d'habitation construite pendant la période
de propriété de l'Etat, époque à laquelle, comme
il a été dit plus haut, le moulin avait servi à la fabrication
de tabac à priser.
Cette maison d'habitation construite en moellons comprenait quatre logements.
Elle était destinée aux familles des douaniers-chefs et du délégué
de la Régie française du tabac. Deux des logements étaient
au rez-de-chaussée. On y entrait de plain-pied sans marche aucune.
Ils étaient bien humides. Ils servirent plus tard de salle à
manger ; pour les garçons meuniers, de chambres à coucher, parce
que jusqu'en 1885 à peu près, le personnel du moulin, tant qu'il
était célibataire, était logé et nourri par le
patron. Les autres parties du rez-de-chaussée furent employées
comme boutique pour un ou deux menuisiers, nécessaires à l'entretien
du moulin, boutique de forgeron et sellerie. Une pièce servit à
garder un ou deux fûts d'huile, dans une autre fut installé,
bien plus tard, un petit bureau, mais la principale partie du rez-de-chaussée
servit de débarras pour la vieille ferraille, poulies, transmissions,
coussinets, courroies, etc. Tout s'y trouvait pêle-mêle.
Il y avait aussi une cave peu profonde et peu spacieuse. On y mettait le vin
pour les ouvriers, celui pour le ménage et les pommes de terre. Il
y avait aussi une presse à raisin. Tout cela sont des souvenirs personnels
déjà. Je constate que j'ai devancé les événements.
Je reviens donc à 1867. Mon père, en se mariant, prenait un logement à Strasbourg au Vieux-Marché-aux-Vins, dans la maison portant maintenant le n° 23. Comme aujourd'hui, il s'y trouvait déjà une pâtisserie. L'aîné des enfants, mon frère Lucien, y naquit le 25 décembre 1867. L'année suivante le déménagement à Illkirch eut lieu. Une partie du premier étage de la maison d'habitation fut aménagée, une autre partie restait vide, et deux pièces servaient de logement à la vieille cuisinière Gale et à son mari Jekof, qui était cordonnier. Gale avait été au service de ma grand'-mère maternelle qui la céda à sa fille Julie, quand celle-ci alla habiter Illkirch. Son mari faisait fonction de surveillant et de portier, la propriété à Illkirch étant constamment fermée, tant au nord vers Strasbourg, qu'au sud vers le village, par deux énormes portes d'entrée. Ce portier était un homme maussade, toujours de mauvaise humeur et qui avait l'oreille dure.
La commande pour l'installation du nouveau moulin et celle de deux turbines
Jonval fut confiée à la maison Brault-Bézouard &
Cie de Chartres, qui s'acquitta très consciencieusement de ce mandat.
Le moulin avec ses douze paires de meules commandées directement par
les turbines, était parfait. Je suppose qu'il tournait vers la fin
de 1868.
Le chef-monteur chargé par la maison de Chartres du montage du nouveau
moulin, Monsieur Philippot, s'est décidé à la suite de
son séjour en Alsace à rester à Strasbourg et à
s'y établir pour son compte, rue des Bonnes Gens. C'est l'origine de
la maison Philippot, Schneider & Jacquet, par la suite Schneider, Jacquet
& Cie à Koenigshoffen.
L'entreprise de minoterie à Illkirch donnait entière satisfaction
à ses propriétaires. Versés, comme ils l'étaient,
dans la sélection des blés, et ayant à leur disposition
un moulin tout neuf et de bons rhabilleurs de meules, ils livraient à
la boulangerie de Strasbourg et de ses faubourgs des farines qui, par leur
qualité, leur assurèrent vite une très bonne réputation.
Mon père s'occupait de la partie industrielle, tandis que son frère
se chargeait de la partie commerciale, ayant à sa disposition le seul
comptable, Monsieur Niedermeyer. Le bureau se trouvait Quai St. Jean. La vente
de la farine chez les boulangers était faite uniquement par les deux
frères. Le commerce des céréales ne fut pas négligé
non plus. Les fournitures de blé à l'armée allaient en
augmentant. Les deux frères rencontraient la plus grande bienveillance,
surtout à l'Intendance militaire à Strasbourg, ce qui leur facilitait
beaucoup les affaires.
Les immobilisations à Illkirch avaient résorbé leurs
économies financières, mais la Banque Ch. Staehling mettait
ses fonds entièrement à leur disposition.
Tout allait donc pour le mieux. Un deuxième et puis un troisième enfant étaient nés à mes parents à Illkirch en mars 1869 et en avril 1870. C'était moi et puis ma sœur Régine, dite plus tard Lina. Toute la famille, tant du côté paternel que du côté maternel était heureuse, pleine d'activité. L'harmonie était parfaite. Les nombreuses lettres de famille et d'affaires de cette époque en sont la preuve. Les deux sœurs de mon père étaient mariées ; l'aînée Mathilde à Monsieur Gustave Meyer, fabricant de chandelles et vigneron à Ribeauvillé, l'autre, Zipper dite Pauline, à Meyer-Meyer de Westhoffen, lequel fut établi par les deux frères de sa femme comme marchand de farine et d'issues de moulins et comme épicier à Graffenstaden.
Tout allait au mieux quand la guerre de 1870 éclata. Les temps devenaient
très durs. Pendant le siège de Strasbourg, des troupes badoises
étaient cantonnées dans la propriété à
Illkirch. Mon père, faute de personnel, était obligé
de conduire lui-même la farine chez les boulangers. Il eut son chapeau
traversé par une balle un jour qu'il conduisait un chargement chez
la veuve Augst à Neudorf. Un autre jour, où il avait dû
se rendre dans la ville assiégée pour y chercher au bureau les
livres de la comptabilité et l'argent qui se trouvait en caisse, il
fut arrêté dès sa rentrée par les Allemands, qui
le soupçonnaient d'avoir extrait de la forteresse une partie du trésor
de guerre. Il fut enfermé dans sa maison jusqu'à ce qu'il puisse
prouver par sa comptabilité que l'argent amené de Strasbourg
était bien sa propriété.
Par la suite, il continua à refuser de travailler pour les troupes
ennemies. Il faut dire qu'on ne lui en tenait pas rancune.
A la capitulation de Strasbourg, l'Intendant Général, au moment
d'abandonner son poste, pria mon père, par une lettre très amicale,
de s'occuper de son mobilier et de ses intérêts. Mon père
nous racontait souvent ce fait comme une preuve de la confiance que lui avait
donnée l'Intendance française. Il ajoutait alors régulièrement,
que s'il n'avait pas eu le moulin à Illkirch, il aurait opté
pour la France.
L'issue tragique de la guerre et la séparation de l'Alsace de la France,
fut extrêmement pénible, tant à mon père qu'à
mon oncle. Ils ne s'en remirent pas. Ils s'efforçaient de maintenir
les relations d'affaires avec leurs amis de l'autre côté de la
nouvelle frontière. A la longue, cela n'allait pas et l'idée
de devoir se tourner vers le commerce d'outre Rhin leur devint si pénible,
qu'ils y renoncèrent.
Le moulin donnait des résultats satisfaisants, mais le département
des céréales dut rester en veilleuse pendant plusieurs années.
A la suite de l'importation des blés de l'Amérique du Nord,
les affaires reprirent dans ce département. Mon père et mon
oncle furent des premiers qui allèrent à Anvers pour les achats
de blé, qu'ils acheminaient alors par le Rhin sur Ludwigshafen ou Mannheim.
En 1876 mon oncle se rendit pour la première fois d'Anvers à
Londres, où il se créa des relations d'affaires de premier ordre.
Il y retourna souvent, surtout pour les affaires en voiliers de Californie,
de Walla-Walla et plus tard d'Australie. La Hongrie avait perdu en intérêt
et c'est en 1878 que mon père, qui aimait beaucoup ce pays et ses habitants,
s'y rendit pour la dernière fois pour affaires.
Il y resta plusieurs semaines et il nous rapporta des vêtements et des
accessoires de gymnastique, anneaux, trapèze, balançoires, etc.
qui, du reste, ne furent jamais montés faute de portique. Il avait
alors 45 ans, ma mère en avait 34. Un sixième enfant leur était
né en juillet 1878, c'était Irma. Elle n'avait pas 4 ans, quand
notre mère est morte. Elle avait encore donné la vie à
trois enfants, le dernier, un garçon, n'avait plus la force de vivre;
ma mère mourut en lui donnant le jour et l'enfant la suivit trois semaines
après.
Je constate avoir de nouveau devancé dans mes souvenirs. Comme je
l'ai dit plus haut, ma grand' mère paternelle avait destiné
son plus jeune fils à la carrière de rabbin. A cet effet, il
fut envoyé à l'école de Fegersheim et plus tard à
Strasbourg. Il avait une bourse et il prenait son repas de midi chez des amis.
On appelait cela "avoir des jours". Vu les progrès que fit son frère
aîné dans les affaires, il fut très tôt retiré
de l'école, peut-être à 14 ans, mais il avait quand même
eu les bases d'une culture générale. Il écrivait par
exemple le français et l'allemand sans faute. Son style et la forme
de ses lettres devinrent par la suite fort appréciables. Il était
et il resta entièrement sous la domination de mon père qui lui
choisit sa femme peu après la guerre. Il la perdit très jeune,
après dix ans de mariage, restant veuf avec quatre enfants. Un cinquième
étant mort dans sa deuxième ou troisième année.
Mon père avait un grand esprit de famille et tant que notre mère
vivait, l'existence dans notre vieille maison à Illkirch était
vraiment idéale.
Les aînés des enfants, après être allés
à l'école à Illkirch jusqu'à l'âge de neuf
ans, allaient en classe à Strasbourg. On prenait les repas et parfois
on logeait aussi chez l'oncle qui habitait alors dans la maison rue du Faubourg
de Saverne n° 25, que mon père avait achetée vers 1876 pour
son propre compte.
Le bureau y fut transféré du Quai St. Jean et le magasin qui
faisait partie de l'immeuble et qui avait une sortie sur la rue du Feu, rendait
de bons services. On y occupait deux ouvriers, tandis qu'au bureau il y avait
une place pour l'oncle, un pupitre avec deux places pour Monsieur Niedermeyer
et un aide-comptable, Monsieur Birckel, la caisse avec un guichet et un petit
coffre-fort. Un autre, plus grand que celui-ci, et que j'ai encore dans ma
maison à Illkirch, était logé dans un caveau voûté
et muni d'une porte de sûreté.
La vente des farines en boulangerie était faite principalement par
mon oncle et, chez une partie de la clientèle, par mon père.
Le tram n'existait pas encore, le trajet en omnibus étant considéré
comme trop coûteux, nous rentrions à Illkirch soit à pied,
soit avec notre père en phaéton qu'il conduisait lui-même,
après que l'un de ses fils l'ait attelé.
Une partie des enfants était alors assise à côté
de lui, les autres étaient sur le siège arrière derrière
le soufflet. En route pour Illkirch, c'était mon père qui entonnait
des Volkslieder que lui-même connaissait et que nous apprenions
à l'école. C'était vraiment beau ! A la maison, notre
mère nous attendait entourée des plus jeunes enfants. L'atmosphère
qui régnait était enchanteresse. Mes parents étaient
très "pratiquants", ma mère était même très
pieuse. Elle nous élevait dans ses principes et je me souviendrai toujours
des beaux vendredi soir et du seder.
Les jours de grandes fêtes, par contre, m'ont laissé des souvenirs
moins agréables, surtout à cause du long trajet à faire
à pied pour le service synagogal tenu à Graffenstaden, d'abord
dans une des chambres de tante Pauline, et plus tard dans deux chambres, l'une
pour les hommes, l'autre pour les femmes dans la maison de Messieurs Weil,
bouchers à Graffenstaden.
Le service de ministre officiant était fait par l'un ou l'autre des
émigrés polonais qui s'étaient établis peu à
peu à Illkirch et à Graffenstaden, du fait que ma mère,
très bonne pour tout pauvre, les avait accueillis avec beaucoup de
compassion et leur avait facilité le séjour en Alsace. Du reste,
ma mère a toujours ouvert sa main à l'indigent, elle étendait
ses bontés vers le pauvre et ne récolta que très rarement
la reconnaissance de ses obligés. Il y avait surtout une famille Aron
de Tauroggen qui lui causa de grosses désillusions.
Les rites et les jours de jeûne étaient strictement observés
dans la maison. C'étaient alors des journées extrêmement
longues pour nous autres.
A en juger par les inventaires de cette époque, on était satisfait
de la marche des affaires. La trésorerie était large, elle dépassait
les besoins de l'entreprise, malgré l'acquisition de l'immeuble au
Faubourg de Saverne, qui était revenu à environ 200.000 francs.
Je me souviens de l'hiver extrêmement dur et long de 1879, au cours
duquel nous suivions, mon frère Lucien et moi, les cours de solfège
au conservatoire à Strasbourg sous la direction de Monsieur Stockhausen.
Nous avions alors comme maîtresse de piano Madame Veuve Venin, sœur
du chef des pompiers de Strasbourg, Monsieur Wachter. C'était une dame
tout à fait charmante, qui venait souvent en été à
Illkirch, pour nous donner des leçons et elle faisait alors de la musique
à mon père et à ma mère avec sa fille Lucie.
Le médecin de famille, qui ne venait que très rarement et plutôt
en ami, était le Docteur Meyer de Fegersheim. Il était accompagné
parfois par son fils, le Docteur Paul Meyer, qui s'était acquis très
jeune encore une grande réputation d'habileté à Strasbourg.
La seule ombre, qui planait sur la maison, c'était la brouille entre
mon père et les frères de ma mère, brouille complète
due au partage de la succession de nos grands-parents maternels, morts en
1874 et 1875.
J'étais à la main de mon père, je m'en souviens. Il marchait
en ville avec son beau-frère Meyer. Je n'écoutais pas, ou je
ne comprenais pas leur conversation, quand sur l'ancien Pont du Corbeau, je
constatais que mon père élevait sa voix et qu'il disait à
mon oncle : "C'est fini entre nous et dorénavant quand vous marcherez
sur ce trottoir, moi je prendrai celui de l'autre côté de la
rue et vous en ferez autant". J'entendis mon oncle qui répondit : "D'accord".
Ma mère souffrait énormément de cette rupture, mais elle
n'en voulait pas à son mari et n'en parlait jamais, car elle avait
toutes les qualités de l'âme et toutes les délicatesses
du cœur.
Quelques semaines avant la mort de notre maman, mon père, mis au courant
du très grave danger dans lequel elle se trouvait du fait qu'elle attendait
son dixième enfant et qu'elle était extrêmement faible,
s'était décidé à reprendre les relations avec
ses beaux-frères, et pour en faire la surprise à notre mère,
il lui amena un jour son frère aîné Henry. J'étais
juste dans le long corridor de la maison paternelle, quand la porte du fond
de ce corridor s'ouvrit et je vis arriver mon père avec l'oncle Henry.
Ma mère sortait de la chambre à coucher et cette scène
de revoir avec son frère me restera en mémoire tant que je vivrai.
Elle pleurait à chaudes larmes, son frère également.
Le lendemain ses deux autres frères vinrent également rendre
visite à leur sœur, qui certainement se rendait compte de sa situation.
La dernière fois que ma mère sortit, c'était pour assister
au service religieux de mon initiation à Graffenstaden. Le chemin d'aller
et retour à pied lui était extrêmement pénible.
"Mon fils ne me pardonnerait pas, disait-elle à tante Pauline,
si je n'étais pas avec lui à cette cérémonie".
C'était en mars 1882. Quelques semaines après, le 4 mai 1882,
elle rendit l'âme ayant à son chevet les deux docteurs Meyer.
Elle avait dû garder connaissance jusqu'au dernier souffle. "Oh ! mon
pauvre mari, oh ! mes pauvres enfants" furent ses dernières paroles.
Elle avait supplié les médecins de ne pas la laisser mourir.
Elle avait 38 ans.
Elle avait été une mère parfaite, pleine de bonté
pour chacun, nous admirions ses belles qualités et nous l'adorions
tous. Telle la femme forte de nos saints livres, elle fut dans sa maison une
vigne fertile, ses enfants furent autour d'elle comme de jeunes plants d'olivier.
Sa mort fut pour notre père et pour ses enfants une perte irréparable.
C'est la première et la seule fois que j'ai vu pleurer mon père.
Ma mère était morte le jeudi matin. Son enterrement devait avoir
lieu le lendemain déjà à Fegersheim. Mon père
était en désaccord avec la communauté israélite
de cette commune. Il s'y rendit pour s'arranger avec le président au
sujet de la somme à verser, pour que notre mère puisse dormir
le sommeil éternel près de ses parents. Il revint exaspéré
et sans avoir pu obtenir l'autorisation de faire l'inhumation au cimetière
israélite de Fegersheim, le président ayant essayé d'en
faire une affaire lucrative pour sa communauté.
Il s'adressa donc le même jour à la communauté israélite
de Strasbourg, où on l'accueillit sans la moindre difficulté.
De ce fait, elle repose au cimetière
israélite de Koenigshoffen, où douze ans plus tard, notre
père devait la rejoindre.
Quand je retournai en classe, en Quarta au Gymnase protestant de Strasbourg
et en vêtements de deuil, notre Ordinarius Dr. Schnackenberg me serra
la main en me disant : "Armer Kerl [pauvre homme]". Ce souvenir m'est
resté.
Le vide laissé par la chère défunte fut énorme.
Un ménage avec huit enfants et au moins 25 ouvriers du moulin à
nourrir et à loger tous les jours, et quels ouvriers parfois ! Lucien,
à cette époque, après avoir été retiré
du gymnase protestant de Strasbourg, était interne à l'école
professionnelle à Mulhouse. Ma sœur Lina avait 12 ans et notre
père exigea qu'elle prenne la charge du ménage et les soins
des tout petits enfants. Avec cela un changement permanent dans le personnel,
tant dans le moulin que dans le ménage, mon père étant
de caractère très vif et très impulsif. Tout était
en souffrance : le ménage, l'éducation des enfants et le moulin.
Le caractère de notre père s'assombrit avec l'âge et à
la suite de la perte de son épouse. Il devenait d'une sévérité
extrême pour les cinq aînés de ses enfants, mais pour les
trois petits, Irma, Lucie et Marcel, il était d'une douceur vraiment
touchante. Il cherchait à leur remplacer, tant qu'il le pouvait, la
mère absente. Il était admirablement secondé dans sa
tâche par sa fille aînée Lina, mais n'avait pour elle ni
reconnaissance ni tendresse.
A la suite d'un coup de tête, Lucien quitta l'école à
Mulhouse sans en avoir demandé l'autorisation à son père.
Faute d'argent, il était rentré à pied en longeant le
canal et en passant les nuits dans les péniches de charbon. Mon père
le mit dans le moulin. C'était un rude apprentissage. Le service au
moulin, auquel il avait à se soumettre comme tout autre, commençait
à cinq heures du matin et durait jusqu'à sept heures du soir
avec trente minutes d'interruption pour le déjeuner et une heure à
midi pour le dîner.
Alternativement, les garçons meuniers travaillaient une semaine dans
la journée, et la semaine suivante pendant la nuit, de sorte que tous
les quinze jours ils faisaient 24 heures de travail consécutif.
Gare à celui qui était pris, quand il se reposait sur le plancher
ou sur les sacs à farine. C'est mon père qui faisait la ronde
et le contrôle. Le renvoi immédiat était certain.
Avec cela, l'éclairage du moulin se faisait avec des lampes à
l'huile. On ne voyait pas à deux pas. Ce n'est que bien plus tard que
les assurances consentirent l'éclairage au pétrole.
Le personnel du moulin, y compris les voituriers, se recrutait de partout.
En premier lieu, c'était la région de Benfeld, de Sand, celle
de Mertzwiller, Ueberach, Rittershoffen, de Saverne, etc. c'est-à-dire
des régions où se trouvaient des moulins qui fournissaient le
meilleur contingent, ensuite il y avait des ouvriers bavarois, des Badois,
des Hesses, des Suisses, des gens du Palatinat, quelquefois aussi, mais rarement,
des Français, qui étaient traités, sans exception, de
"Welsches".
Les places chez mon père, à cette époque, n'étaient
pas très recherchées par les ouvriers, au contraire. Les inscriptions
au crayon qui couvraient les murs à l'intérieur du moulin, obscènes
en grande partie, le prouvaient. De celles qu'on peut citer, j'ai plusieurs
en mémoire :
| "Wen Gott will strafen für seine Stinden, Den lâsst er beim Baumann Arbeit finden." | Celui que Dieu punira pour ses péchés, Il lui permet de trouver du travail chez Baumann. |
|
| "Sechs Tage sollst du arbeiten, Am siebten das Geschirr schmieren |
Tu dois trvailler six jours, Au septième, lubrifie les outils. |
|
| "Bist du wer du bist, Jude oder Christ, Eines, Bruder, sag ich dir, Lange bleibst du auch nicht hier." |
Qui que tu sois, Juif ou chrétien Une chose, mon frère, je te le dis Toi non plus, tu ne resteras pas ici longtemps. etc. [traduction de la Rédaction du Site] |
Du vivant de ma mère, mon père ou plutôt la firme fit
l'acquisition d'un des trois moulins de Strasbourg "la Spitzmühle" mis
en liquidation forcée et exploité en dernier lieu par le meunier
Boersch. Il l'obtint, si je ne me trompe pas, pour 240.000 marks. C'était
un immense immeuble, mais en très mauvais état, avec quatre
roues hydrauliques, en pitoyable état également. Comme machine
de meunerie, il n'y avait plus rien, le propriétaire ayant successivement
réalisé tout ce qui était réalisable. Par contre,
il s'y trouvait un moulin à tan, dans lequel on travaillait à
façon pour les tanneurs, ainsi que des marteaux à battre le
cuir (je crois qu'il y en avait quatre) et des meules à aiguiser, sur
lesquelles on travaillait pour les bouchers de la ville. Ce n'était
certainement pas la dixième partie de ou des immeubles qui était
occupée, le reste était vide et servait à loger des écorces
de chênes.
Le travail à façon pour les nombreuses et importantes tanneries,
qui existaient à cette époque à Strasbourg, était
facile et lucratif. Il n'exigeait pas de capitaux de roulement, et peu de
travail. Cette nouvelle partie de l'affaire paternelle devenait particulièrement
intéressante avec des clients comme la maison Adler & Oppenheimer,
alors en plein essor.
Les rapports d'affaires avec cette firme allaient toujours en progression,
quand un beau jour mon père se brouilla avec l'un des associés
sans cause raisonnable. A l'occasion de la fête du nouvel an israélite,
Monsieur Adler ou Monsieur Ferdinand Oppenheimer, à la sortie de la
Synagogue, vinrent souhaiter la bonne année. Mon père, toujours
de mauvaise humeur les jours de fête, lui répondit : "Et moi
je souhaite d'être débarrassé de votre maison comme cliente".
C'est à la suite de cet incident que Messieurs Adler et Oppenheimer
achetèrent la propriété Schumann à Lingolsheim
pour y ériger leur fabrique.
Je me souviens que mon oncle regrettait beaucoup cette affaire. Monsieur Niedermeyer
en était outré. Mon père n'en parlait plus. A partir
de 1885 à peu près, mon père se désintéressa
de plus en plus des affaires. Il s'occupait plutôt d'agriculture et
surtout de la mise en état de ses prés. Il était fier
de pouvoir rentrer le foin en quantité suffisante pour les chevaux.
Il défrichait avec l'aide de journaliers de Eschau et de Plobsheim,
spécialistes en cette matière, les parties des prés qui
portaient des arbres et des ronces, il consolidait les rives de l'Ill le long
de la propriété. Il prenait aussi en location des champs incultes
appartenant à la commune et situés dans le Obereck. Il y plantait
de l'avoine et des pommes de terre, mais jamais de blé, sans doute
parce qu'il en avait vu assez dans sa vie.
Il se passionnait aussi pour la culture des fraises dans le jardin et, ne
voulant pas engager la main d'œuvre nécessaire, il faisait appel,
et cela très énergiquement, aux jeunes forces de ses quatre
fils, qui étaient en âge de travailler.
Le gravier d'une partie du canal de fuite du moulin avait été
déposé sur les prés longeant ce bras de l'Ill, et c'est
sur cette colline de gravier, mêlé de terre et de vase, qu'il
s'était mis en tête de planter de la vigne. Les résultats
en furent et restèrent déplorables, malgré l'énorme
travail qu'en occasionnait l'entretien.
Il n'allait plus que rarement en ville et au bureau, laissant le soin de la
vente et des achats à son frère, qui s'en acquitta bien et consciencieusement.
Nous avancions en âge. Mon frère Lucien partit le 1er octobre
1885 pour Deutz, afin d'y accomplir dans le 8ème Régiment de
cuirassiers son année de service militaire. En même temps, je
fus retiré de l'école de Strasbourg où je devais passer
en Obersekunda. Pendant l'absence de mon frère aîné, je
le remplaçai dans le moulin.
La production était alors de 3.000 sacs de blé en moyenne par
mois. Elle était supérieure pendant les mois de bonnes eaux,
c'est-à-dire en automne et au printemps, pour devenir très mauvaise
en été et parfois aussi en hiver, où il y avait des hautes
eaux ou de la glace.
Par l'influence tout à fait exceptionnelle, qu'avait su exercer sur
mon père le chef meunier allemand Weinhold, qui avait pu se maintenir
à son poste plus d'un an, ce qui était encore plus exceptionnel,
le régime du personnel du moulin d'abord et des voituriers ensuite,
fut enfin modifié et régularisé.
Tandis que jusqu'alors, c'est-à-dire en 1884, les hommes étaient
payés à l'année et au mois, et recevaient généralement
les vêtements (bottes pour les voituriers, souliers pour les autres),
étant de plus nourris et logés (mais dans quels dortoirs !).
Monsieur Weinhold obtint que les salaires soient fixés par catégories
et par heure sans paiements en nature.
A partir de ce moment, les hommes eurent à se loger et à se
nourrir dans le village. Les salaires étaient alors de 20 à
40 pfennigs l'heure et on travaillait onze heures par jour. Ce fut aussi Weinhold
qui décida mon père à faire l'acquisition de deux Wegmannstühle
avec des cylindres en porcelaine. C'étaient d'excellentes machines
pour l'époque. Weinhold avait trouvé le moulin en très
mauvais état. Le nettoyage était inexistant, pour ainsi dire,
mon père partant de l'idée que tout ce qu'on sortait du blé
était perte.
Les meules ont été remplacées successivement par des
cylindres. Il y en avait de toutes les marques, mais pas de sasseurs modernes,
etc.
Heureusement les autres moulins de commerce en Alsace, tant ceux situés
sur l'Ill, que ceux sur la Bruche, la Zorn, la Moder et la Sauer n'étaient
pas mieux outillés. Et ceux qui travaillaient à façon
pour les marchands de farine, tels que la Dunzenmühle, la Zommühle
à Strasbourg, les moulins de Wolfisheim, Eckbolsheim, de la Ganzau,
de Wibolsheim, Plobsheim, etc. étaient encore plus primitifs et ils
avaient la réputation plus ou moins fondée, de considérer
un peu comme leur appartenant le blé confié par la clientèle
de paysans, boulangers et marchands de farine. On appelait cela "molzern".
Mon père nous racontait souvent un épisode de sa jeunesse, où l'usage de la balance décimale était encore chose inconnue chez les paysans. Un jour il revenait à pied de Plobsheim. La voiture du moulin de Plobsheim chargée de sacs de farine pour les paysans de Fegersheim, passait juste. Il faisait chaud, et sur sa demande, le meunier lui permit de prendre place sur l'arrière de la voiture. Comme il était fatigué, il s'allongea sur les sacs pleins et il s'endormit. Arrivé à Fegersheim, le meunier constata avec frayeur que, par le poids du jeune homme, les sacs qui auparavant avaient l'air d'être bien remplis de farine, avaient l'aspect d'être à moitié vides, et au lieu de les conduire chez les cultivateurs, il dut se décider à retourner directement au moulin pour y transvider la farine dans d'autres sacs. On se servait alors encore de ces longs sacs en chanvre très lourds et très durs, et pour les rendre bien raides, on les aspergeait d'eau. La farine y était mise très doucement à l'aide de la pelle pour éviter qu'elle se tasse.
Mais revenons à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire,
la seconde moitié de la décade 1880 à 1890.
Mon frère aîné n'avait pas 18 ans quand il entra au Régiment
à Deutz. Il était très long de jambes et ayant eu l'habitude
des chevaux depuis son enfance, il devint vite très bon cavalier, mais
néanmoins, il eut beaucoup à souffrir de la part de ses subordonnés
et des autres Einjährige de par ses origines alsacienne et israélite.
Aussi, il n'eut pas d'avancement, et quand un jour il riposta à un
sous-officier, qui l'avait traité de Einjähriger Itzig,
par un coup de poing dans la figure lui cassant la mâchoire, il fut
condamné à un mois d'arrêt.
Heureusement pour lui, l'incident ne s'était pas produit en service
et en présence de la troupe. A sa sortie de l'arrêt, les Alsaciens
servant dans le régiment, le portèrent en triomphe pour le féliciter
de son courage.
A son retour du service militaire, en octobre 1886, il reprit son poste au moulin d'Illkirch, tandis que j'eus mon champ d'action au bureau de Strasbourg, où j'aidais mon oncle dans les ventes en boulangerie, dans les travaux au magasin du Faubourg de Saverne, de l'ancienne Gare, au Metzgertor-Gare et à la Spitzmühle et aussi au bureau. Monsieur Niedermeyer, qui avait alors deux aides, s'efforçait de m'enseigner la comptabilité. C'étaient d'excellents mentors, tant l'oncle que Monsieur Niedermeyer et je dois beaucoup de reconnaissance à leur mémoire.
Mon oncle s'était beaucoup attaché à moi, il me considérait comme son propre fils, mon père par contre, avait une franche préférence pour Lucien, auquel, par exemple, il fit venir d'Angleterre un des premiers bicycles avec une énorme roue de devant. Moi, je n'eus ma première bicyclette qu'après mon service militaire que j'accomplis dans le bataillon du Train à Strasbourg, auquel je donnais la préférence après les expériences faites par mon frère à Deutz. Je servis de novembre 1887 à octobre 1888. Dans ce régiment, nous n'étions que des Alsaciens et Lorrains comme volontaires. J'avais à peine 17 ans. Le service fut très dur, car nous avions des chefs impitoyables. Je me rappelle qu'un jour à Haguenau, où nous étions détachés en partie, un major du bataillon d'infanterie nous réunit et nous fit d'amers reproches du fait que les jeunes alsaciens rentraient de préférence dans le Train. Je répondis, que c'était parce que l'uniforme de ce corps nous plaisait particulièrement. Il riposta que c'était un mensonge et que le vrai motif était qu'en cas de guerre nous n'aurions pas à tirer sur nos amis les Français.
C'était l'époque de l'affaire
Schnaebelé et on s'attendait à tout moment à un ordre
de mobilisation. Dans la seule année de mon service militaire, nous
dûmes prêter serment à trois empereurs : Guillaume 1er,
mort en mars 1888, Frédéric III, mort en juin 1888 et finalement
au jeune Guillaume II.
A mon retour du service militaire, nous nous efforçâmes, Lucien
et moi, de développer l'affaire paternelle. Nous nous étions
rendus compte que nous pourrions y arriver :
1. en assurant au moulin une force motrice plus puissante et plus régulière,
2. en transformant complètement le moulin,
3. en élargissant notre champ d'action par rapport à la clientèle.
En dehors de la concurrence des moulins de la région et des marchands
de farine faisant moudre à façon, nous avions de plus en plus
à lutter contre les farines allemandes. Les moulins de Willstaett,
de Bühlerthal, de Constance, de Mühlacker, de Bissingen et autres
qui, livraient en grande partie directement en boulangerie, puis les grands
moulins qui s'étaient établis peu à peu le long du Rhin
à Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg et puis Weinheim et en cas de
bonnes récoltes, les moulins du nord de l'Allemagne, qui avaient tous
leurs représentants à Strasbourg et qui inondaient le pays de
leurs farines à des prix qui rendaient toute concurrence impossible.
Partout, tant dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin, s'établirent
des marchands de farines qui s'approvisionnaient en Allemagne et qui nous
faisaient une rude concurrence. Nos aînés, mon père et
l'oncle, étaient restés sur la défensive. Ils avaient
conservé les anciens principes du temps français, c'est-à-dire
qu'ils ne cherchaient à avoir des clients que dans les régions
proches du moulin : Strasbourg, Neudorf, Schiltigheim et Bischheim. Les voitures
ramenaient alors du blé des magasins à Strasbourg. On respectait
aussi par tradition la clientèle et la région des moulins concurrents.
Toutes les livraisons se faisaient par les voitures. Par-là déjà,
on était limité.
On se contentait de gagner par l'exploitation des moulins ce qu'il fallait
pour vivre et pour pouvoir mettre chaque année quelque chose de côté.
Les nouveaux principes, dits depuis capitalistes, et qui ne reconnaissaient
pas de limite d'expansion, déroutaient complètement les hommes
d'affaires de la génération qui précédait la nôtre.
A cela s'ajoutait le sentiment d'aversion et de peur de tout ce qui venait
d'Allemagne pour la génération qui était déjà
dans les affaires avant la guerre de 1870, et qui regrettait le passé
sans pouvoir s'adapter aux conditions créées par la séparation
de la France et le rattachement à l'Allemagne. Faisant partie d'une
nouvelle génération, les sentiments commerciaux de mon frère
et les miens étaient forcément autres. Nous avions le feu sacré
de la jeunesse et l'avenir ne nous faisait pas peur, au contraire !
Ce fut la troisième partie de notre programme qui offrit la moindre
résistance de la part de notre père et de notre oncle. Grâce
à la bicyclette, le nouveau moyen de locomotion, dont nous fûmes
pendant plusieurs années les seuls à nous servir, nous parcourions
la région pour créer au moulin une nouvelle clientèle.
Lucien particulièrement dans la vallée de la Bruche où,
par son énorme bicycle, il était bientôt connu de toute
la population. Pour moi, je m'occupai en-dehors de la ville, dans ses environs,
du Ried et du reste de l'arrondissement d'Erstein et plus tard de Kehl et
environs.
Nous étions étonnés au début, de constater combien
notre moulin était peu connu des boulangers de la campagne. Nous obtenions
des succès, nos farines étant supérieures à celles
des autres moulins.
La capacité du moulin ne suffisant plus aux besoins, on achetait de
la farine allemande, parfois aussi française, pour la mélanger
à celle du moulin. Mon père reprenait courage, il avait de nouveau
plaisir à l'affaire et nous pouvions discuter dans ces moments les
points 1 et 2 de notre programme.
Mon oncle, par contre, n'était pas accessible aux idées de nouvelles
immobilisations financières. Il était trop content de pouvoir
acheter aux banques avec l'excédent de la trésorerie des effets
au Privatdiskont.
Mon père, chef incontesté et de caractère autoritaire,
ne se souciait pas beaucoup de l'opposition de l'oncle et vers 1890, grâce
à la ténacité de Lucien, il était gagné
à l'idée d'entreprendre l'agrandissement et la modernisation
du moulin. Par contre, il restait intraitable sur la question de l'acquisition
d'une machine à vapeur. Il ne voulait absolument rien savoir, cependant,
il décida le remplacement des anciennes turbines par deux nouvelles.
Malheureusement aussi, il ne consentait pas à ce qu'on s'adressât
aux maisons ayant fait leurs preuves pour traiter de la construction de l'immeuble,
de l'installation du moulin, des travaux d'eau nécessaires. Il n'accepta
même pas l'idée de s'assurer le concours d'ingénieurs
spécialisés dans la matière, ni celui d'un architecte
compétent.
Il tenait à diriger tous ces travaux lui-même avec l'aide de
chefs d'équipe ou de tout petits entrepreneurs et voulait engager lui-même
les maçons, les journaliers, etc. achetant directement toutes les matières
de construction. Les meilleurs ouvriers maçons c'étaient les
Italiens.
Un jour on manquait de briques, une autre fois de chaux, une troisième
fois de ciment, alors c'était la course à bicyclette chez les
fournisseurs à Achenheim, Hangenbieten, Hoehnheim, Brumath, Hochfelden,
Dettwiller, etc.
Mon père avait pris le principe de procéder par paliers, c'est-à-dire
qu'il ne préparait pas la tranche avant que la précédente
fut terminée. Rien d'étonnant que la transformation, qui aurait
pu se faire en six mois, demanda plus de deux ans.
Pendant ce temps, nous faisions moudre à façon chez tous les
petits meuniers des environs. Il y en avait au moins vingt qui travaillaient
pour nous. C'était un travail énorme, que la distribution du
blé pour chacun, étant donné qu'il fallait avoir soin
du mélange, de la répartition des farines, et faire un contrôle
sévère, etc. Mais on s'en tira sans perte et on parvint à
conserver la clientèle.
Enfin, le moulin agrandi et transformé, fut mis en marche, c'était
en 1892. A cette époque, les blés venant de l'Argentine, commençaient
par peser sur le marché et de 1892 à 1894 le prix mondial baissa
sans s'arrêter pour aller de 184 marks la tonne caf Anvers ou Rotterdam
à 90 marks. C'était un très mauvais début. Mon
père surtout en souffrait moralement et c'est probablement ce qui aggrava
son état de santé. Mais jamais il n'aurait consulté un
médecin. Il ne se plaignait jamais, car il avait de tout temps été
très dur pour lui-même et pour les autres. Pendant l'été
de 1894 il dut s'aliter, et c'est avec beaucoup de peine que nous obtînmes
l'autorisation de faire venir le médecin. Il était atteint des
reins, les médecins nous disaient plus tard que c'était la maladie
"Bright". Il ne s'en releva plus. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1894 il mourut.
Il avait à peine atteint l'âge de 63 ans.
Au cours de la dernière année de sa vie, il avait encore marié
notre sœur aînée Lina avec Max Roos, mais il n'eut pas le
bonheur de voir son petit-fils, venu au monde quelques mois après sa
mort.
Mon père a certainement été une des personnalités
les plus marquantes dans sa branche. Sorti d'un milieu des plus modestes et
parti de rien, il était arrivé à créer et à
laisser à sa mort une affaire industrielle relativement importante,
avec une trésorerie tout à fait à l'aise. Il est mort
comme il a vécu, vaillamment sans se plaindre, sans avoir témoigné
la moindre concession à sa position de chef de famille et de chef d'une
importante affaire.
Il n'accepta guère ou très difficilement que ses amis vinssent
lui faire visite, tant qu'il serait couché. A l'oncle Jacques, qui
lui avait fait annoncer sa visite probable, il fit téléphoner
qu'il viendrait lui-même le voir à Strasbourg.
De sa chambre et de son lit de malade, qui étaient dans la partie de
la maison la plus proche du moulin même, il contrôlait le déchargement
des voitures d'après le rythme du monte-charge qui grinçait.
Il demanda à Lucien de congédier immédiatement l'homme
qui, selon ses constatations, ne travaillait pas assez vite.
Il n'a jamais dû songer à la possibilité de sa mort prématurée,
en tous les cas, il ne nous en parlait jamais. Toutefois, dans le cours de
sa maladie, il manifesta son intention de s'entendre avec son frère
et associé pour que celui-ci se retire des affaires. Il nous prendrait
alors, Lucien et moi, comme associés.
Mon père, n'ayant jamais accordé une grande importance à
la préparation commerciale par les écoles et aux études
de ses fils, Léonce seul termina ses classes à Strasbourg et
fut envoyé ensuite à l'école de meunerie de Worms.
On peut dire qu'il ne s'était jamais fait de programme au sujet des
carrières de ses trois plus jeunes fils. En tous les cas, chaque fois
que nous essayions d'aborder avec lui cette question, nous nous heurtions
à sa résistance de la discuter ou de l'examiner avec nous.
Il n'avait pas grande confiance dans la sincérité, ni dans l'honnêteté
des hommes en général. Ce sentiment de méfiance avait
augmenté avec l'âge.
Après le décès de mon père et en vertu de l'acte
de société portant la signature de mon père et de son
frère, le survivant avait le droit de garder l'affaire pour lui seul
et de rembourser les héritiers du défunt sur la base de l'inventaire
qui précédait le décès de son associé.
Mon oncle ne pensa pas un instant à faire usage de ce droit. Il proposa
immédiatement et sans hésiter de me prendre comme associé.
Par contre, il témoignait des hésitations très fortes
au sujet de Lucien, chez lequel il critiquait un manque d'esprit commercial,
de la naïveté vis-à-vis du client, il lui trouvait l'esprit
d'un guerrier fougueux, l'âme toujours tendue vers de trop grandes et
confuses perspectives. Il objectait que ses désirs passionnés
ne lui permettaient pas de se rendre compte de l'espace entre la réalité
et le but qu'il voulait atteindre. Bref, il lui reprochait la démesure
dans tout ce qu'il entreprenait.
Tout en me solidarisant avec mon frère aîné, en ce qui
concernait la question de la succession de notre père dans l'affaire,
je ne fis point part à Lucien des craintes et des motifs de l'hésitation
de l'oncle, d'abord, pour ne pas lui faire de la peine, ensuite parce que
je voulais éviter un coup de tête de sa part, et finalement parce
que j'étais persuadé que tout s'arrangerait. C'est ce qui eut
lieu. J'arrivai à donner à l'oncle les apaisements nécessaires
à ses hésitations et après quelques mois, le nouvel acte
de société entre l'oncle, Lucien et moi put être signé
devant le notaire. Il porte la date du 1er novembre 1894.
L'affaire continuait comme par le passé. L'oncle fut considéré
et respecté par ses jeunes associés comme chef de la maison.
Les rapports entre lui et moi étaient des plus cordiaux, ce qui n'était
pas toujours identique entre lui et Lucien.
Je rentrais tous les soirs à Illkirch à bicyclette pour être
avec mes frères et sœurs à la maison paternelle. Dans l'intérêt
des jeunes membres de la famille, je tenais à ce que le ménage
y soit maintenu comme par le passé. Lucien, tout en n'étant
pas toujours d'accord avec moi sur cette question, finissait quand-même
toujours par s'y rallier.
Les bilans pour 1895, 1896 et 1897 étaient très favorables et
dans le partage des bénéfices, l'oncle se montrait très
large. Il aurait eu droit à une part plus élevée que
nous deux, tant que nous étions célibataires, mais sans hésiter
et de son propre chef, il donna ordre à Monsieur Niedermeyer de créditer
chacun des comptes des trois associés, du tiers du bénéfice.
En 1898, les rapports entre l'oncle et moi, si cordiaux jusque-là,
se gâtèrent très sérieusement par mon mariage.
J'avais fait la connaissance, déjà du vivant de mon père,
de mon futur beau-frère Henry Lévy. Quoique nous fussions concurrents,
et tout en imposant la réserve et la discrétion nécessaires
au sujet des affaires, nous nous voyions souvent. Nous prenions nos repas
de midi dans le même restaurant israélite à Strasbourg.
J'appris à le connaître davantage. Je l'appréciai beaucoup
et j'avais pour lui des sentiments de franche et sincère amitié.
Sa sœur était allée en pension avec mes plus jeunes sœurs.
Près d'elles à Illkirch je la rencontrai de temps en temps et
finalement, d'accord avec mes frères et sœurs, je nie décidai
à la demander en mariage.
Mon oncle fut bouleversé quand je lui annonçai mon intention.
Il fit tous ses efforts pour me faire revenir sur ma décision. Il n'y
réussit pas et à partir de ce moment, il se détacha beaucoup
de moi. Lui, qui depuis quinze ans avait travaillé si intimement avec
moi, qui, en ma présence était habitué à penser
à haute voix, sachant que jamais je ne le mettrais dans l'embarras,
vis-à-vis de mon père d'abord, de mon frère aîné
ensuite, il me retira sa confiance du jour au lendemain ne me parlant que
pour le strict nécessaire. Ce me fut très pénible.
Par contre, je constatai un rapprochement très net entre lui et Lucien.
Ce dernier n'était venu au bureau à Strasbourg que très
rarement jusqu'alors (il n'y avait pas de fauteuil et de place à lui
réservée), maintenant il y venait assez régulièrement,
et nos situations dans les rapports avec mon oncle furent renversés.
Mon frère était doué d'une capacité et d'un besoin
de travail très grands. Non seulement depuis la mort de notre père,
il s'occupait de la partie technique du moulin, mais il visitait en même
temps la clientèle avec beaucoup de succès, et il trouvait encore
du temps pour entrer en rapports avec les représentants de l'administration
allemande, négligés jusqu'alors, et à tort pour le moulin.
Par ces fonctionnaires Messieurs Althaus, Fecht, Willgeroth et autres, il
obtint des améliorations appréciables dans l'adduction de l'eau
dans l'Ill. Il fut également mis au courant du plan d'un canal devant
amener l'eau du Rhin dans l'Ill près de Strasbourg.
Par de nombreuses démarches tant à la Mairie de Strasbourg que
dans les Ministères, il arriva à une modification du projet
en notre faveur, en faisant intervenir la fabrique de Graffenstaden et notre
firme pour une participation aux frais du nouveau canal. Cette participation
fut modeste, 50.000 marks pour chacune des deux entreprises avec versements
échelonnés sur cinq ans. C'est le canal de Gerstheim qui fut
le résultat de ses fructueuses négociations. Il était
encore en état de construction en 1898. Le mérite en revient
à Lucien.
La question de la force motrice et les énormes difficultés
en résultant pour le développement de notre affaire, nous préoccupaient
constamment, mon frère et moi. D'autre part, l'attitude de notre oncle
et associé restait inébranlablement négative. Il ne voulait
rien savoir du projet d'acquisition d'une machine à vapeur.
Dans ces conditions, nous décidâmes, Lucien et moi, de commander
malgré lui et en notre nom une locomobile de 100 PS à la maison
Lanz à Mannheim. Au moment de passer la commande, nous étions
déjà décidés, mon frère et moi, à
transformer notre affaire familiale en société anonyme, car
l'attitude de mon oncle dans la question de la force motrice, et ses continuelles
menaces de sortir de l'affaire sans nous y laisser un sou de son capital,
danger qui s'était particulièrement aggravé depuis que
je m'étais marié en avril 1898, nous inquiétait beaucoup.
Le jour de mon mariage à la place des bons vœux, il me déclara
que si je partais en voyage de noce, je trouverais le bureau fermé
à mon retour et l'affaire en liquidation.
Ce fut Lucien qui se chargea d'amener l'oncle à donner son consentement
pour la transformation de l'affaire en société anonyme. Ce fut
lui également, qui mena les négociations avec la maison Veuve
Lévy et ses fils, en particulier avec mon beau-frère Henry Lévy,
au sujet de la fusion avec la nouvelle société anonyme en perspective.
Les négociations tant avec l'oncle, handicapé à ce moment-là
par les erreurs commises dans les premiers mois de 1898 lors du Boom Leither,
qu'avec ma nouvelle famille de Duttlenheim furent menées à bonne
fin.
L'accord fut établi entre tous les intéressés. Les statuts
furent établis par Maitre Ritleng aîné. Lucien et moi
étions nommés directeurs avec des appointements modestes, mais
avec une respectable participation dans les futurs bénéfices.
Pour la maison Veuve Lévy et ses fils une place devait être réservée
dans le conseil et une place dans la direction. Elle s'engagea à participer
avec 200.000 marks dans le capital social qui fut fixé à 1.600.000
marks. L'oncle y resterait le plus fort actionnaire et serait nommé
Président du Conseil de Surveillance. La société firmerait
"Illkircher Mühlenwerke A.G. vorm. Baumann frères".
Comme pour toute nouvelle société anonyme, les souscriptions
arrivaient péniblement. Notre banquier Ch. Staehling, L. Valentin &
Cie., prêta son concours en souscrivant 100 actions de 1.000 marks.
L'assemblée générale constitutive de la nouvelle société
eut lieu le 16 novembre 1898. Le capital entier de 1.600.000 marks était
présent, savoir :
| Jacques Baumann | . . . . . . . . . . . . | marks 370.000 | Leopold Heidingsfeld | . . . . . . . . . . . . | marks 5.000 | |
| Lucien Baumann | . . . . . . . . . . . . | . . . . 340.000 | Jacques Hirschler | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 12.000 | |
| Achille Baumann | . . . . . . . . . . . . | . . . . 340.000 | Albert Meyer | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 20.000 | |
| Montant des apports : marks 1.050.000 | Eugène Rieffel | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 23.000 | |||
| Lucien Baumann | . . . . . . . . . . . . | marks 85.000 | Camille Schlauffler | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 10.000 | |
| Achille Baumann | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 10.000 | Adolf Altorffer | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 2.000 | |
| Gustave Borrach | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 5.000 | Banque Ch. Staehling, L. Valentin & Cie. (y compris les 200.000 marks de Veuve Lévy et ses fils) |
|||
| Fritz Brauer | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 54.000 | . . . . 300.000 | |||
| Karl Fellhauer | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 10.000 | H. Walter, Barr | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 2.000 | |
| Ernest Hampele | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 3.000 | André Walter, Barr | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 4.000 | |
| Isidore Weill | . . . . . . . . . . . . | . . . . . 5.000 | ||||
| à reporter : marks 1.217.000 | marks 1.600.000 | |||||
Comme membres du Conseil de Surveillance furent nommés par l'assemblée générale : MM. Jacques Baumann, Eugène Rieffel, Charles Schott, Banquier, Ad. Mülberger, Rentier et puis furent nommés par la même assemblée générale comme directeurs : MM. Lucien Baumann et Achille Baumann L'entrée en fonction de la société anonyme fut fixée au 1er janvier 1899.
 A la pensée de mon
père j'avais le cœur gros en signant pour la dernière fois
la raison sociale de notre affaire paternelle.
A la pensée de mon
père j'avais le cœur gros en signant pour la dernière fois
la raison sociale de notre affaire paternelle.
Nous étions arrivés mon frère et moi, avec l'aide de
dévoués collaborateurs, à porter la production du moulin
d'Illkirch, et son débouché, de 100 sacs par jour à 400.
Ce n'était que la malheureuse question de la force motrice qui nous
avait empêché d'arriver à un développement plus
considérable.
Tout en rendant hommage à notre oncle et associé pour sa loyauté
à notre égard et pour ses qualités de commerçant
nous avions dû nous rendre compte qu'il n'avait pas celles d'un chef
d'entreprise indispensables toujours pour assurer le fonctionnement paisible
et régulier de son administration et par là l'existence et la
progression de l'entreprise.
C'est principalement cette constatation qui me rallia à l'idée
de Lucien, de la transformation de notre affaire en société
anonyme.
C'est par là que je termine.
Mon séjour à Marienbad duquel j'ai profité pour mettre
à jour ces souvenirs, touche à sa fin. Peut-être me déciderai-je
plus tard à reprendre ce bloc-notes pour faire l'historique des 25
premières années de la société anonyme, au bout
desquelles, pour des raisons d'ordre personnel, je me retirai de la direction
des Grands Moulins de Strasbourg, S.A.
Sinon, celui qui voudra le faire, en trouvera les éléments dans
les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration et
des assemblées générales et dans les rapports annuels
de la société.
A. BAUMANN
Ces notes ont été écrites sous l'impression profonde
de la mort de mon frère Lucien, survenue à Paris le 4 juillet
1936.
Dans le magnifique essor que l'affaire a pris depuis sa transformation en
société anonyme, mon beau-frère Henry Lévy, actuellement
Président du Conseil de la Société, a eu le plus grand
mérite.
Je tiens à lui en rendre un hommage sincère et ému.
Son œuvre a été toute de clairvoyance de jugement sûr
et par ses puissantes qualités il s'est placé à la hauteur
des plus grands chefs d'industrie.
Si j'ai tenu à mettre sur le papier les souvenirs qu'évoquait
en moi la disparition de mon frère aîné, c'est dans le
but de faire sentir à nos enfants aussi bien qu'à leur descendance
la valeur de la tâche qui sera la leur dans le maintien de l'œuvre
édifiée par leurs anciens.
