Faits relevés sur des actes originaux et figurant sur la Chronique abrégée de Herlisheim (Kurze Herlisheimer Chronik) établie et publiée par Monsieur Auguste KOCHER y demeurant en 1908.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Communauté israélite de Herrlisheim
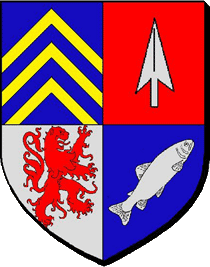 Installé dans la plaine du Rhin au nord de Strasbourg, à peine à deux kilomètres, en ligne droite, des berges du fleuve, le village avait environ 2 100 habitants principalement de culte catholique à l'exception de deux familles protestantes et d'environ 35 à 40 foyers israélites abritant à peu près 170 personnes.
Installé dans la plaine du Rhin au nord de Strasbourg, à peine à deux kilomètres, en ligne droite, des berges du fleuve, le village avait environ 2 100 habitants principalement de culte catholique à l'exception de deux familles protestantes et d'environ 35 à 40 foyers israélites abritant à peu près 170 personnes.
La disposition des fermes, le long de la grande route stratégique, et l'aménagement de celles-ci en rectangles avec un potager/verger derrière les bâtiments d'exploitation, de même que la majorité des noms patronymiques, témoignaient d'une colonisation germanique d'origine militaire, c'est à dire attribution des terres à des soldats sédentarisés à la suite d'une guerre d'invasion à but colonisateur. Donc contemporaine des guerres de religion et probablement à l'envahissement de l'Alsace par les Souabes (d'où le nom de "Schwowe", expression qui par la suite a pris un sens péjoratif à l'encontre des Allemands en général, peut-être aussi par suite de l'opposition entre les libertés acquises sous la Révolution française et l'autoritarisme germanique et surtout prussien).
Le pays était plat, d'une configuration peu attrayante, pratiquement sans vallonnements ni boqueteaux, par contre fertile, surtout dans sa partie de terres lourdes gagnées sur les marécages le long du Rhin, terres qui formaient une bande cultivable large d'environ deux kilomètres entre le village et les approches du Rhin, d'un bon rendement et probablement pour cette raison appelées la "Gütlach", c'est à dire la "bonne mare".
Les fermes étaient nombreuses et les terres de chacune, éparpillées dans toutes les directions, souvent à deux ou trois kilomètres du centre du bourg, étaient des bandes étroites de faibles superficies, ne dépassant guère une étendue de dix hectares pour les fermes les plus pourvues. Aussi les déplacements se faisant encore avant la guerre de 1914, à pied ou au pas lent d'une ou de deux vaches, les pertes de temps étaient considérables et même énormes par rapport à aujourd'hui. Par contre on pratiquait une culture intense à laquelle s'astreignaient même les femmes qui travaillaient activement dans les champs aux moments opportuns. Malgré ces façons culturelles intenses, il s'agissait dans la majorité des cas, plutôt de cultures de subsistance, seules les plantations de houblon, de tabac et de betteraves sucrière s’étant à considérer comme de véritables produits de commercialisation. Les autres produits récoltés, tels que le blé, le maïsou les pommes de terre servant généralement à la subsistance et à la nourriture du bétail, porcs ou bovins, vendus sur place aux bouchers ou cédés aux marchands de bestiaux, commerce qui était l'apanage des juifs, qui, dans le village et pour les villages environnante se chargeaient de leur commercialisation sur les marchés de Strasbourg ou de Saverne ou procuraient une vache laitière contre une vache grasse et se chargeaient de la vente des veaux.
Les paysans avaient à cette époque peu de relations commerciales extérieures, ni d'ailleurs le temps, en raison de leur façon de travailler, considérée aujourd'hui comme archaïque, de s'occuper encore de la commercialisation. Ils ne fréquentaient pas personnellement les marchés aux bestiaux comme cela se pratique à l'intérieur de la France, laissant ce soin à leur marchand de bestiaux attitré, qui en l'occurrence était leur homme de confiance et les déchargeait des risques commerciaux et des fluctuations du marché, transactions dont par ailleurs ils ne désiraient pas s'occuper.
A cette époque, cette organisation répondait à un besoin et fonctionnait à la satisfaction réciproque des deux parties. Le houblon était cédé aux courtiers en houblon, travaillant généralement pour le compte des négociants en relation avec les brasseurs alsaciens et même allemands, à travers le marché au houblon se tenant en saison tous les quinze jours à Haguenau, marché qui fonctionnait donc principalement durant l'arrière-saison hivernale, la cueillette du houblon ne se faisant que fin août, c'est à dire entre la récolte du blé et l'arrachage des pommes de terre et des betteraves sucrières ou de fourrage. Le tabac, cultivé surtout après la fin de la guerre de 1918, était pris en charge par la Régie nationale des Tabacs qui s'occupait en outre de la surveillance des cultures de ce produit.
S'agissant des exploitations paysannes, des marchands de bestiaux ou autres intermédiaires, c’étaient en l'occurrence de part et d'autre des "gagne-petit". Mais de ce temps les exigences n'étaient pas les mêmes et la vie s'écoulait au rythme mesuré des saisons, des dimanches et des jours de fêtes. La "Maïstub" c'est-à-dire la visite des voisins ou amis durant les soirées hivernales, où l'on papotait de choses et d’autres, en mettant le maïs en bottes qui ensuite décoraient si joliment les auvents des maisons, ou quand il avait fini de sécher, que l'on s'entraidait à égrener, faisait office de cinéma et de télévision.
J'en viens à présent au sujet de ce mémoire.
D'où venait cette communauté israélite installée dans ce village ?
Il est à présumer qu'il s’agissait, entre autres apports des villages plus éloignés, principalement de descendants des familles israélites qui s'étaient groupées en une communauté dans un village spécifiquement juif, créé à la lisière de la forêt de Haguenau, dénommé Schirrhoffen, à l'écart du village de Schirrhein, village catholique où probablement à l’origine, les juifs n'étaient guère tolérés. A cette époque les grandes villes ou bourgs enjoignaient aux juifs l'obligation d'avoir à quitter leurs murs d'enceinte à 16 heures ou au plus tard avant la tombée de la nuit.
Schirrhoffen, situé hors de la circulation routière, était donc pour ainsi dire un village-ghetto où s'étaient réfugiées quelques familles juives pour former une commune et une communauté religieuse à l'écart des autres communes plus ou moins hostiles à leur présence. Les exactions et les quolibets auxquels ils étaient exposés, les incitaient à se rassembler entre eux dans leur propre village pour éviter les vexations et les contraintes (rue réservée aux juifs : "die Judengasse") et aussi pour leur permettre la stricte et plus facile observance des lois et prescriptions religieuses, qui étaient leur raison de vivre dans l'espoir de rentrer un jour dans leur pays, espoir qu'ils exprimaient tous les ans en célébrant leur jour de l'an "Roschhaschana" en ajoutant à leurs vœux de bonne année, en guise de salut, le souhait, rempli non seulement d'espoir mais aussi de certitude : "ewers Johr en Jeruscholaïm" - "l'année prochaine à Jérusalem" ! La certitude que Dieu, après des épreuves imposées durant des siècles, les fera revenir un jour en terre sainte, en "Eretz Israël" ne les quittait jamais.
Sans droits civiques, ni état civil, ni même de patronyme autre que par exemple "David ben …" c'est-à-dire "David fils de…" selon le prénom du père, la possession de terres leur étant interdite, n'étant admis dans aucune corporation de métiers, il ne leur restait que la possibilité de rendre de menus services pour gagner une vie misérable par le colportage de maison en maison , de petits articles d'usage courant, généralement des tissus ou des articles de mercerie utiles aux paysans des villages qu'ils traversaient souvent au long de toute une semaine, dormant dans les granges ou chez un coreligionnaire, se nourrissant de pain, de fromage, d'œufs durs ou de quelques morceaux de sucre, (d'où le quolibet de"Zuckermännele"), pour revenir en fin de semaine à leur domicile en vue d'y fêter le "sabath", dont les prières devaient normalement être dites en présence d'une réunion de dix adultes. C'était aussi le moment d'une élévation spirituelle au sein de la famille, accompagnée généralement autant que possible, d'une table plus ou moins garnie.
Emancipés par la Révolution française, ayant acquis la citoyenneté à part entière et obtenus enfin sous Napoléon 1er, un état civil et des patronymes, ils s'aventuraient à travers le pays, hors de leurs villages-ghettos ou de leur "Judengasse", pour essaimer aux alentours, par leurs descendants, qui s'établissaient dans d'autres villages où ils formèrent de nouvelles communautés.
Ils avaient donc des patronymes et figuraient à l'état civil, tenu auparavant par le clergé, qui bien entendu n'y inscrivait que les paroissiens à l'occasion de leur baptême. Jusque-là on ne les désignait, même dans les actes officiels, que sous "le juif untel…" par exemple "le juif Isaac fils de…" (prénom du père soit David, Mosché, Jacob etc.).
Ils purent donc s'établir ailleurs, mais n'ayant ni terres, ni métiers, ils n'avaient d'autres possibilités que d'exercer des professions commerciales ou de servir d'intermédiaires.
Je vais à présent tenter de décrire succinctement la vie, les mœurs et les traditions de ma communauté telles qu'un dernier témoin de son ultime existence, que je suis, les a connues.
 |
Une vaste cour, clôturée d'une grille, entourait la synagogue, cour dans laquelle s'élevait, outre une petite maison communautaire réservée aux assemblées d'administration réunissant les seuls membres masculins de la communauté, aussi un bâtiment adjacent avec installation de chauffage et de bain, dit le "mekfé" et qui servait aux dames à prendre le bain rituel de purification après chaque période mensuelle. Avec l'arrivée des moyens d'hygiène à domicile, ce bâtiment était, de mon temps, tombé en désuétude et devenu pratiquement sans utilisation.
De même que tous les catholiques, sans exception, allaient le dimanche matin à la messe, tous les membres masculins sans exception et certaines femmes sans obligations ménagères, fréquentaient la synagogue pour le service religieux du "sabath" débutant le vendredi soir et se poursuivant le samedi matin de 9 à 11 heures, suivi d'une courte prière dans l'après-midi vers 4 heures ("mincha") ainsi que d'une réunion de prière le soir à la tombée de la nuit pour l'issue du sabath ("maarif"). A la sortie de ce service, et de retour au foyer, le chef de famille allumait une petite bougie tressée et récitait une action de grâce (ce qui s'appelait, faire "wuch" , "fin du sabath" - afdaulé).
C'étaient là les principales obligations de prières auxquelles aucun homme n'aurait voulu se soustraire. Les autres jours de la semaine, chacun récitait à domicile les prières du matin et du soir. A table le chef de famille ouvrait le repas par la bénédiction du pain, en distribuant un morceau de pain trempé dans le sel (mautzé) à chacun des convives. A la fin des repas il récitait à haute voix l'action de grâce (bensché).
Le vendredi soir, l'entrée du sabath était célébrée par une magnifique liturgie proclamant l'accueil du sabath à l'instar de l'accueil d'une fiancée resplendissante de beauté. On venait bien entendu à la synagogue en habit de fêtes, mais pour plus de solennité, les administrateurs de la communauté avaient-décrété que tous les hommes mariés, donc chef de foyer (barnausim) devaient se présenter à la synagogue, le vendredi soir et le samedi matin, la tête couverte de leur chapeau haut de forme. Comme l'on ne se découvrait pas durant le service religieux, l'assistance avait une allure réellement cérémonieuse. Le ministre officiant (chasen) récitait les prières à haute voix et appelait chaque samedi matin un membre, par ordre successif, sur l'estrade pour l'assister lors de la lecture des versets hebdomadaires de la Torah. L’appelé pouvait, en réponse à cet honneur verser un don à la caisse de la communauté, et/ou à une œuvre de bienfaisance, telle que l'Orphelinat israélite, l'Ecole de travail, le Foyer des jeunes filles, ou la Maison de retraite des vieillards, institutions qui avaient été créées par le Consistoire central dès ou avant le début du vingtième siècle. Par la même occasion l'appelé avait la faculté de demander à l'officiant de recommander à haute voix à la grâce de Dieu sa femme, ses enfants, sa famille ou nommément un de ses amis ou toute sa famille, tous ses amis et toute la communauté (Ve ess kol mischbachto, ve ess kol chafroussoh, ve ess kolle kaal).
Personne n'aurait voulu à cette occasion se soustraire à cette faculté de faire un don modeste ou fastueux, selon les occasions de fêtes ou d'un événement heureux tel qu'une naissance, des fiançailles, ou un mariage. De mon temps cela pouvait aller d'un mark ou d'un franc jusqu'à cinq francs et même vingt francs ce qui était généralement un maximum. Celui qui avait reçu d'un tiers, parent ou ami, l'honneur d'assister le ministre officiant dans la lecture de la Torah, se présentait en descendant de l'autel devant son donateur pour le remercier d'un chaleureux "mischkor" signifiant "que le Seigneur t'accorde sa grâce" .
Au moment des grandes fêtes, ces honneurs étaient auparavant mis aux enchères, généralement le vendredi soir avant l'office du sabath. Je m'amusais énormément à ces enchères épiques, car qui désirait rendre un honneur (metzfé) au fiancé de sa fille (chosen) ou à un gendre invité pour la fête, ou à un fils ou un parent venu de Paris, tenait à se voir adjugé l'un de ces honneurs.
On commençait généralement à 50 Pfennigs ou centimes jusqu'à un maximum de 3 ou 4 marks ou francs. Je parle de l'époque immédiatement avant ou après la guerre de 1914-18. Ces empoignades étaient plus un jeu poussant aux enchères qu'une lutte de préséance, car finalement on abandonnait l'honneur convoité à celui qui attendait un invité ou quelqu'un auquel il désirait témoigner une marque de considération ou de sympathie.
Le service religieux était attentivement suivi par tous les assistants et si par hasard le ministre officiant récitait un verset non prévu ce samedi dans le rituel "aschkénes", il y avait toujours l'un ou l'autre de stricte obédience pour lui rappeler à haute voix que ce verset n'était pas à réciter ce jour, ne figurant pas dans le rituel du rabbinat de Francfort-sur-le-Main qui servait de référence. Comme si le bon Dieu pouvait s'offusquer en lui adressant un verset supplémentaire… ! Mais si certains étaient plus ou moins pragmatiques, d'autres, et la majorité parmi les plus vieux, étaient d'obédience strictement orthodoxe et pratiquaient les moindres prescriptions qui étaient nombreuses.
Il y avait dans la communauté une autre obligation par ordre successif à laquelle aucun membre masculin n'aurait songé à se soustraire. Il s'agit de l'anniversaire du décès d'un père ou d'une mère d'un des membres qui donnait lieu à une réunion de prière commune en présence d'au moins dix adultes (minyenne) pour permettre au fils (ou aux fils) du défunt de réciter à la fin de la réunion, la prière (kadisch) en souvenir de l'ascendant décédé. Aucun descendant ne se serait abstenu de remplir ce devoir envers ses parents, ni d'allumer à son domicile une petite lampe à huile rappelant l'âme du défunt.
Or la plupart des membres de la communauté étaient marchands de bestiaux. Ils prenaient souvent le train de six heures du matin afin de pouvoir rencontrer leurs clients d'un village voisin avant le départ de ceux-ci aux champs. Cette réunion de prière était alors fixée, été comme hiver, à 5 heures du matin. A ce sujet je voudrais ajouter qu'ayant atteint ma majorité religieuse, je proposais souvent à mon père de le remplacer à cette heure matinale. Jamais, même près de ses derniers jours, il ne m'aurait autorisé à me substituer à sa présence personnelle, se serait-il agi en l'occurrence d'un membre avec lequel il était en parfaite mésentente. C'était une obligation d'honneur qu'aucun "balbos" (chef de foyer) n'aurait omis de remplir, quelqu'ait été l'heure ou le temps, fut-ce par verglas.
Pourtant il ne manquait pas mal d'inimitiés entre certaines familles, la plupart du temps pour des peccadilles, une offense à un lointain ascendant, à un père ou à une mère, ou des histoires d'héritage sans grande importance ni valeur. Mais il est vrai que dans les temps où les fortunes étaient des plus maigres, tout pouvait prendre de la valeur.
Tous les membres de la communauté, comme moi-même, avaient appris et savaient lire, écrire et peu ou prou traduire l'hébreu. La langue de communication entre les gens des communautés juives était le "yidisch-daïtsch" (judéo-alsacien) qui était un dialecte alsacien spécial aux juifs, mélangé d'expressions hébraïques déformées.
 |
Comme déjà mentionné, la plupart des membres de la communauté étaient des marchands de bestiaux, d'autres tels mon père et aussi son frère étaient marchands de tissus, encore d'autres quincaillers ou commerçants en fourrages et produits de la terre. Aucun n'attendait les clients à domicile, mais selon la coutume ancestrale, tous allaient les visiter à demeure dans le village même ou dans les villages voisins. Ne travaillant pas le samedi, ils sortaient aussi souvent le dimanche, sûrs de rencontrer ce jour-là les clients qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer dans la semaine. Les marchands de bestiaux recevaient souvent le dimanche la visite d'un client venu voir une vache et en discuter le prix. Ils s'occupaient non seulement de leur commerce, mais servaient aussi d'intermédiaires dans les transactions immobilières. Les paysans qui n'aimaient pas la discussion et n'avaient pas la parole facile, ni l'entregent commercial, laissaient à leur ami juif (em jud) le soin de mettre les affaires au point, se contentant en fin de transaction, de paraître chez le notaire pour la signature des actes. Une commission convenue d'avance rémunérait l'intermédiaire de ses services toujours appréciés.
Comme toutes les religions, la religion juive ne manquait pas de prescriptions, de rites et de traditions symboliques.
La première des prescriptions, respectée dans tous les foyers était celle de la séparation de l'alimentation à base de lait d'avec l’alimentation carnée, "Tu ne feras pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère" ! Et dans toutes les maisons, il n'y avait pas seulement deux services de cuisine et de table, l'un pour le lait et l'autre pour la viande, mais encore un troisième qui ne servait qu'une fois par an pendant les huit jours de la Pâque juive (Pesach), fête commémorant la sortie d'Egypte et la libération de l'esclavage des Pharaons, pendant lesquels tout pain levé et salé était banni des tables et de la maison et remplacé par des pains azymes (matzos)
Revenons à leurs occupations.
Comme déjà dit, dans la majorité ils étaient marchands de bestiaux c'est à dire de vaches, veaux et taureaux. Deux s'occupaient exclusivement de chevaux qu'ils fournissaient généralement outre aux paysans, aussi aux mariniers d'un village voisin dont beaucoup assuraient, avec leurs péniches, le trafic sur le canal de la Marne au Rhin, en faisant haler celles-ci à l'aide de chevaux comme c'était la coutume en ce temps. Les brasseurs de Strasbourg étaient aussi leurs clients, le transport de la bière se faisant à l'époque sur de larges voitures à plate-forme attelées d'une paire de magnifiques chevaux ardennais ou percherons qui faisaient toujours l'admiration des gens des villages.
Les paysans achetaient de jeunes vaches souvent prêtes à vêler et revendaient les veaux de quelques semaines pour s'assurer le lait nécessaire à leur subsistance, faisant le beurre manuellement à la baratte et se servant du petit lait pour engraisser leurs cochons. Les vaches devenues peu productives étaient engraissées et revendues soit à la boucherie ou au marchand de bestiaux contre une vache laitière. Tout ce commerce passait par le marchand de bestiaux, plus ou moins homme de confiance de ses clients.
Les marchands de bestiaux partant tôt le matin étaient en général de retour vers 14 heures, pour s'occuper dans l'après-midi des bêtes en étable, de la traite et aussi de curer le fumier des étables. En cas de présence de nombreuses bêtes, ils se faisaient aider par un valet, petit paysan du voisinage. Celui-ci, avec l'assistance d'un aide, était également chargé, en partant souvent à 2 heures du matin, d'amener les bêtes jusqu'au marché-abattoir de Strasbourg à une vingtaine de kilomètres. Ce n'est que plus tard que l'on s'est avisé d’utiliser les wagons à bestiaux du chemin de fer. Souvent on procédait auparavant à la toilette des vieilles vaches ce qui consistait à les rajeunir en leur faisant de belles cornes à l'aide d'une râpe et d'un grattoir (yetsche). Cela n'empêchait pas de voir revenir ces marchands de bestiaux sans grand bénéfice dans leurs poches quand le marché avait été trop bien fourni. Aucun ne s'occupait bien entendu de la vente ou de l'achat de cochons et pour cause, ces bêtes étant impures pour un juif.
Ceux qui s'occupaient de tissus ou de quincaillerie et qui possédaient en général un petit magasin-dépôt dans les communes voisines avaient d'autres coutumes. Ils partaient dans la matinée avec une voiture aménagée, attelée d'un cheval et ne revenaient pas avant le soir à la tombée de la nuit. Leur commerce s'adressait plus aux maîtresses de maison. Pour déjeuner, ils entraient chez leur aubergiste attitré, après avoir acheté un morceau de fromage chez l'épicier, se faisaient préparer deux œufs durs ou à la rigueur deux œufs sur le plat dans une poêle que l'aubergiste avait acheté spécialement à leur intention et qui ne servait que pour les clients juifs. I1 n'était pas question de manger au dehors des mets non strictement "cachères" et l'aubergiste lui-même, respectueux de leurs croyances et coutumes, se serait reproché comme un péché de les transgresser ou d'abuser de leur confiance.
A part d'aider à rentrer le foin pour les vaches ou les chevaux de leur commerce ou de leur attelage, les juifs ne s'adonnait pas aux travaux des champs. Privés de terre depuis des siècles, ils n'en avaient par ailleurs aucune expérience. Ils possédaient quelques arpents de prés, ainsi que quelques autres terres venant de la propriété communale et qui étaient attribuées par la commune, après extinction d'un foyer, par ordre de mariage, à un autre chef de foyer, ce que l'on appelait les terres alimentaires (alimente) dont la traduction approximative peut être : "terre de subsistance".
Traditions et fêtes
 |
"Adonaï élauheïnou, Adonaï échotte" -"L'Éternel est notre Dieu, l'Eternel est unique", le credo de tous les juifs.
Les enfants recevaient en même temps que leur prénom d'état civil, leur nom hébraïque, et de tradition un prénom à l'initiale d'un des grands parents par exemple le grand père s'étant appelé "Aron", le petit fils pouvait s'appeler "André" et porter le nom hébraïque "Aron ben Mosché" si le prénom de son père était par exemple Moïse. Ce nom était inscrit en grosses lettres hébraïques sur une bande de tissu fin d'environ vingt-cinq centimètres de largeur (la mappe) qui servait à entourer les rouleaux de la Torah et que les garçons devaient apporter à la synagogue dès l'âge de trois ans. Les parrains et marraines offraient aux filles une médaille en or, "le Schadaï" et aux garçons une "mesoussa", un petit étui rond en or contenant sur un petit rouleau, les dix commandements (1). C'étaient les cadeaux rituels que les enfants portaient à leur cou suspendu à une chaînette aussi en or.
Quand il s'agissait d'un fils premier né, le père devait publiquement racheter son fils aîné par un don à une œuvre de bienfaisance.
Il me reste à décrire succinctement le déroulement des principales fêtes religieuses qui étaient "Roschhaschana", le jour de l'an lunaire, "Pesach", la fête de la libération et de la sortie d'Egypte, "Yom Kippour", le jour du grand pardon, "Soukoth", la fête de la récolte, et "Pourim" en souvenir d'Esther évitant le premier génocide du peuple juif.
A "Roschhaschana" on échangeait les vœux de bonne année habituels sans omettre d'ajouter "l'année prochaine à Jérusalem".
"Pesach" était une fête plus somptueuse qui commençait le premier soir, après le service religieux, par un dîner généralement fastueux, précédé par le récit de la "Hagadah" c'est à dire le récit des malheurs du peuple juif durant l'esclavage sous les pharaons, les exploits de Moïse accompagné de son frère Aaron, demandant au pharaon la libération de son peuple, l'énumération des dix plaies imposées par Dieu aux Egyptiens, la traversée de la Mer rouge et l'anéantissement des armées égyptiennes poursuivantes dans cette même mer, qui s'était ouverte devant le peuple juif et avait englouti les poursuivants, l'errance à travers le désert et l'arrivée au pays de "Canaan" où coulait le lait et le miel.
C'était une longue litanie et le repas se terminait souvent tard dans la nuit. Sur la table se trouvaient des herbes amères et des herbes douces, symboles des années passées en esclavage et de la nouvelle vie dans le pays de "Canaan" ou Palestine. Les juifs dans leur hâte de quitter l'Egypte n'avaient pu emporter que de la pâte non salée et non fermentée et en souvenir, on ne mangeait pendant toute la semaine que durait la fête, que des pains azymes "matzos". La semaine débutait par deux jours de grande fête et finissait par deux jours de grande fête. Les autres jours intermédiaires étant considérés comme des demi-fêtes.
A l'approche de "Soukoth", chaque chef de famille se procurait un "lulaf", branche de palmier venant de Palestine que l'on agitait à la ronde durant cette fête et pendant certaines prières en signe de joie et de paix. Ce "lulaf" était toujours accompagné d'un "essrig" sorte de citron (2), probablement en souvenir des jours amers.
"Soukoth" était à la fin de l'été, la fête des récoltes et à cette occasion, certains élevaient dans leur cour une hutte carrée faite de claies et de branchages richement garnies de fleurs et des fruits les plus divers suspendus au plafond et surtout d'oranges censées venir de Palestine, hutte qui servait alors durant les beaux jours, de salle à manger.
"Pourim" était un jour de jeûne pendant lequel on récitait la "Méghila Esther", récit qui conte les exploits d'Esther, fille de Mordechaï (3) qui avait obtenu de son mari Assuérus la grâce pour le peuple juif, dont elle était issue, condamné par le ministre Amane au génocide. "Pourim" était l'occasion de faire des beignets "Pourimkischle" dont ma mère faisait plusieurs dizaines, tout un grand panier à linge, car la coutume voulait d'en apporter une demi-douzaine à chaque veuf ou veuve ou autres personnes seules de la communauté, ce dont j'étais généralement chargé.
"Yom Kippour" était le jour du grand pardon, jour de contrition et de jeûne complet de la veille à la tombée de la nuit jusqu'au lendemain soir. Les chefs de famille (balbausim) ne quittaient pas la synagogue de toute la journée et suivaient l'office du matin au soir habillés de leur "sargheness" c'est à dire de leur "linceul" , un habit en forme de longue robe blanche confectionnée dans une fine toile de lin, signe de leur soumission à la volonté divine : "Dieu a donné (la vie), Dieu reprendra la vie, loué soit-Il" sera la dernière parole en accompagnant un défunt à sa tombe. En entrant chez un agonisant, le salut rituel était "Thoré Mausche émes" - "la parole de Moïse est vérité" et le visiteur récitait souvent avec le malade, le "dachless" dernière prière pour un mourant.
Je voudrais encore rappeler ici le service d'honneur qui était imparti à tour de rôle aux membres adultes de la communauté qui se réunissaient à trois ou quatre pour assurer la toilette d'un défunt et sa mise en bière, bière faite uniformément de quatre planches de bois blanc. Ce même service était également assumé par les femmes adultes à l'égard d'une défunte. Personne ne songeait à se soustraire à une telle obligation d'honneur. Les enterrements s'effectuaient dans l'ordre successif des décès, personne ne pouvait se réserver une place à l'avance ou faire établir un caveau. Le cercueil était descendu à même la terre, tourné vers l'est, vers Jérusalem. Avant la fermeture définitive de la bière, les enfants étaient réunis autour du cercueil, imposaient leurs mains sur celui-ci et demandaient pardon à leur père ou à leur mère de toutes les offenses qu'ils auraient (mechilé pralé) pu leur avoir faites de leur vivant. Cette cérémonie était de toute évidence toujours fort poignante. Avant la fermeture du cercueil, un petit coussin rempli de terre était glissé sous la tête du défunt, symbole de la parole "tu viens de la poussière et à la poussière tu retourneras".
Les fêtes ci-dessus mentionnées étaient les principales des autres jours de fête ou de souvenir de moindre importance, mais qui étaient nombreuses. Je ne citerai que "Chevouoth" et "Hanoukah", la fête des lumières qui durait sept jours pendant lesquels on allumait dans chaque foyer, tous les jours une lumière de plus, soit jusqu'à sept petites bougies, coutume qui a donné naissance au chandelier à sept branches devenu un emblème.
Que puis-je ajouter à ce tableau de la vie et des mœurs des juifs au début du vingtième siècle dans un village d'Alsace ?
Qu'en était-il de l'antisémitisme ?
Que les garçons catholiques apportaient à l'école communale des queues de cochon pour nous narguer en nous les passant sous le nez, qu'en cas de bagarre entre un garçon juif et un garçon catholique, ce dernier était encouragé par ses camarades aux cris de "vas-y c'est un juif" - "Drouf s'esdh e joud", c’étaient là des manifestations qui s'arrêtaient en général avec l'âge adulte pour faire place à une certaine compréhension.
Les juifs étaient autres, voilà tout. A force de contacts humains, les juifs n'étaient plus considérés comme des réprouvés promis aux affres de l'enfer. On respectait leur croyance, sans pour autant y adhérer le moins du monde. Il ne s'agissait plus d'un antisémitisme virulent, mais tout en les acceptant comme des citoyens et des êtres humains, fils d'un même Dieu, on les considérait comme des hérétiques, au même titre d'ailleurs que les protestants, mais avec en plus l'opprobre d'être des déicides et de n'avoir pas reconnu Jésus le Messie, enseignement que l'Eglise prodiguait encore avec constance et acharnement. Si certains prenaient cela pour parole d'évangile, d'autres n'y attachaient pas une grande croyance et en entendait souvent "Si Dieu est Dieu, il est Dieu de tous les hommes" ! Il a malheureusement fallu l'holocauste de six millions de juifs pourque l'Église admette et proclame enfin cette simple vérité évidente.
Si les relations n'étaient pas étroites entre les familles de religion différente, les contacts étaient néanmoins devenus normaux et fréquents et aussi bienveillants. Il arrivait couramment de voir un enterrement d'un ami ou voisin catholique, suivi par ses amis juifs et il en était de même dans le cas contraire. Une certaine estime avait fini par s'établir.
Dans cet environnement plus libéral, les communautés ne restèrent pas figées. Alors que l'aîné des garçons restait généralement auprès du père pour reprendre la clientèle et continuer le commerce, et en cas de décès du père, prendre la place de chef de famille avec toutes les obligations que cela impliquait et en premier lieu assurer si possible une dot et un mari convenable à ses sœurs célibataires, les autres garçons allaient apprendre un métier, surtout depuis la création par le Consistoire, d'une Ecole de travail d'où sortirent de nombreux bijoutiers-joaillers, des horlogers, des pâtissiers, des charcutiers-bouchers, des serruriers, des peintres en bâtiment etc. Munis de ce bagage, beaucoup de ces garçons partirent, surtout après l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne, vers l'intérieur de la France pour se soustraire à l'armée allemande. Un certain nombre émigrait vers les Etats-Unis ou l'Amérique du Sud, surtout vers l'Argentine et le Brésil, et souvent en revenaient pour emmener une épouse choisie parmi les filles restées au pays.
De nouvelles communautés se créèrent ainsi à travers le monde. La plupart du temps, ces émigrés maintenaient d'une façon ou d'une autre des attaches avec leur pays natal.
Une partie des enfants de la communauté, dont les ascendants, un siècle auparavant, étaient tenus à l'écart de la population environnante, s'émancipait et évoluait normalement vers d'autres horizons en acquérant un nouveau savoir et en se créant ainsi de nouvelles possibilités d'existence.
La situation qui vient d'être décrite était donc celle au début du vingtième siècle jusqu'après la seconde guerre mondiale et avant le déferlement de la barbarie hitlérienne.
D'autres ont rapporté les souffrances et les horreurs qui ont suivi, sur lesquelles il est donc inutile de revenir ici. Nombreux furent les membres de la communauté, hommes, femmes et enfants qui furent déportés vers les camps d'extermination et n'en revinrent pas. Une stèle érigée au cimetière israélite de la commune a perpétué leur souvenir.
La guerre terminée et la barbarie vaincue, seules deux familles revinrent au village, soit une dizaine de personnes sur environ 160 auparavant. En dehors de ceux qui par malheur furent déportés, une partie avait disparu dans la tourmente, certains de mort naturelle due au chagrin et à la misère morale, malgré l'accueil compréhensif et souvent chaleureux de la population de l'intérieur de la France. les survivants préférèrent se fondre dans la population urbaine, leurs attaches étant rompues, certains n'ayant plus retrouvé leur maison, détruite au cours des derniers combats lors de l'ultime attaque des armées hitlériennes.
Il n'y reste à présent que deux veuves qui veillent sur le cimetière et la synagogue, témoins du passé d'une communauté israélite villageoise fort active et vivante avant la guerre, communauté qui a disparu pour ne plus jamais renaître.
Avril 1982
- L'auteur commet ici une erreur : en rélité, la Mézouza contient deux passages de la Bible (Deutéronome 6:4-9 et 11:13-21), qui sont inclus dans la récitation "Chema Israël".
- Chéma affirme le principe de l'unité de D.ieu et rappelle notre devoir éternel et sacré de ne servir nul autre que Lui.
- Véhaya exprime la promesse de D.ieu de nous récompenser parce que nous aurons respecté les préceptes de la Torah, et de nous rétribuer selon nos actes si nous leur avons désobéi. - Le essrig [ethrog] est en réalité un cédrat.
- Esther n'est pas la fille de Mordechaï [Mardochée], mais sa nière et sa pupille.
| Synagogue précédente |
Synagogue suivante |
 |
