 |
Depuis les transactions entre les chefs des deux familles, qui préludent à tout projet de mariage, jusqu'au Shabath de la Hamfierung (en allemand : Heimführung) qui suit la célébration, lorsque le mari ramène son épouse à la maison commune et invite toute la communauté, nombreuses sont les cérémonies qui jalonnent la formation d'un couple: il y a d'abord "l'entrevue" (Pchau), suivie des fiançailles (Knasmol, en allemand : Knas-Mahl) ; un an après, a lieu, à la veille du mariage, l'échange de cadeaux (chiflaunes), l'invitation à la communauté lors du Shabath qui précède le mariage (Shabes Spinholtz), et enfin le mariage proprement dit. Chacune de ces cérémonies est définie par un code précis, en même temps qu'elle s'accompagne de rites complexes qui sont nécessaires pour valider ce passage à une condition nouvelle.
Ce qui caractérise le mariage juif en Alsace dans la deuxième moitié du 19ème siècle c'est la présence de traits apparemment opposés qui paraissent devoir s'exclure, et qui cependant se combinent en une structure originale. Le mariage est en effet une affaire, que les partenaires concluent avec une certaine âpreté, mais d'où le sens du don et de la gratuité n'est pas absent. Ses différentes manifestations sont marquées par une joie profonde, par le plaisir de la fête, de la danse et de la bonne chère, mais aussi par une certaine austérité, par le sentiment de la gravité de l'aventure humaine et de la précarité de la condition juive. Enfin, comme pour toute tradition authentique, les rites du mariage sont empruntés autant à la religiosité populaire qu'aux prescriptions des gardiens de la Loi. Les rabbins, après avoir lutté en vain, pour déraciner des coutumes issues de l'entourage non-juif, là encore les ont bien souvent avalisées, mais en leur faisant subir une profonde mutation de sens.
Ce qui singularise, en premier lieu, le mariage juif au 19ème siècle, c'est le mélange d'une certaine âpreté au gain et d'une générosité qui fait de la maison juive une demeure ouverte. Dans la campagne alsacienne en général, et chez les Juifs en particulier, la dot qu'apporte la jeune fille (Nedejne, de l'hébreu Nedunya) joue un rôle important dans la conclusion d'un mariage. Cela s'explique par les conditions de vie précaires et souvent la misère d'un judaïsme, qui cherche, par tous les moyens, à échapper à la pauvreté, pour accéder, sinon à la respectabilité et et à l'aisance bourgeoise, du moins à une certaine sécurité et à plus de bien-être.
Aussi, les jeunes filles pauvres quittaient-elles l'école à treize ans pour se mettre au service de coreligionnaires plus riches dans les principales villes d'Alsace, ou bien à Paris, à Elbeuf et dans d'autres grandes cités dans lesquelles s'étaient installés des Juifs d'Alsace après l'annexion de 1870. Elles travaillaient comme Bilzel, "servantes", dans des familles de hauts fonctionnaires, d'industriels et de commerçants enrichis, qui bien souvent les exploitaient : mais elles tenaient bon car il leur fallait gagner, sou par sou, leur nedejne. Elles ne pouvaient pas, comme les jeunes filles de milieu aisé, parfaire leur éducation bourgeoise au pensionnat à Nancy, ni attendre à la maison un prétendant en brodant leur trousseau.
Le frère aîné se devait de travailler pour la dot de ses sœurs jusqu'à ce qu'elles fussent toutes mariées, ou bien il lui fallait émigrer aux Amériques et tenter d'y faire fortune afin de les aider. Quand ni les parents ni les frères ne pouvaient doter la jeune fille (Madle ausgewe), elle était "laissée pour compte comme une pauvre de rien du tout" (sie ech setse geblewe wie e armer Tropf). Il ne lui restait qu'à émigrer elle-même ou encore à épouser un veuf, un Juif étranger, polonais ou russe. Rares, cependant, étaient celles qui épousaient un non-juif, car alors les familles les désavouaient et prenaient le deuil.
Quoi qu'il en soit, l'âge moyen au mariage était de trente ou trente-deux ans pour le jeune homme et de vingt-cinq ans pour la jeune fille. Il existait encore, au milieu du 19ème siècle, des Hevroth (confréries) pour doter les jeunes filles pauvres, mais elles n'eurent pas une grande extension en Alsace. Le 9 tishri 5547 (1786), Cerf Berr, l'un des "syndics généraux de la Nation juive en Alsace" avait constitué une fondation. Voici le début de la déclaration qu'il fit devant le notaire, en présence de témoins et de membres de sa famille réunis à Bischheim :
"Puisque les docteurs recommandent avec insistance de soutenir ceux qui s'occupent de l'étude de la Loi, de marier les jeunes filles pauvres et de donner l'aumône aux pauvres, et puisque Dieu lui a accordé richesse et honneur, il a destiné une somme de 175 000 livres en argent français pour être employée à ce triple but, à savoir : Talmud Torah (étude), Hakhnasath kala (dotation de jeunes filles pauvres), Zedaqa (aumône)." (1)
En Alsace, ces Hevroth disparurent à la fin du 19ème siècle, et on eut recours davantage à une autre disposition. Lorsque le père de la jeune fille était trop pauvre, le rabbin et les parnassim (chefs de la communauté) pouvaient contraindre par un jugement ayant force de loi un riche parent, qui jusque là s'était récusé, à constituer la dot de la jeune fille. En cas d'échec, il n'était pas rare en Alsace que l'on conclue un "double mariage" (dobelt Chedich) : le frère et la sœur épousaient une sœur et son frère tout aussi démunis, de sorte que les dots dues réciproquement s'annulaient. Parlois aussi, le frère et la sœur vieillissaient ensemble, s'épaulant mutuellement, après s'être résignés à demeurer célibataires.
C'est un entremetteur itinérant, le chadchen exerçant une activité mal définie entre la mendicité et le colportage, qui mettait en relation deux chefs de famille appartenant sensiblement au même milieu social. Il leur faisait miroiter les qualités physiques et morales du conjoint proposé, ainsi que les solides avantages pécuniaires qui ne manqueraient pas de résulter d'un tel "parti".
Le chadchen a certes ses lettres de noblesse puisque au 15ème siècle Rabbi Jacob ben Moses Mölln de Mayence, qui jouissait d'une autorité incontestée en Alsace, s'employait à arranger des mariages. Ses efforts étaient d'ailleurs amplement récompensés puisque l'argent qu'il touchait ainsi lui permettait de subvenir à l'entretien de sa famille, de sorte qu'il utilisait les émoluments que lui versait sa communauté uniquement pour entretenir une école talmudique et aider les élèves nécessiteux.
Le salaire du chadchen était défini avec une certaine précision ; c'est ainsi qu'au milieu du 19ème siècle, si le jeune homme et la jeune fille habitaient la même localité, les honoraires étaient fixés à environ deux pour cent de la dot de la jeune fille ; ils pouvaient s'élever jusqu'à un maximum de quatre pour cent suivant la distance qui séparait les deux domiciles.
Les périodes de 'hol hamo'ed Pessa'h, et Soukoth constituaient l'apogée de l'activité du marieur, car, durant ces "demi-fêtes de Pâque" et des "Cabanes", on n'aimait guère s'adonner aux tâches profanes; c'est à cette époque qu'avaient lieu la plupart des "entrevues" . Le chadchen et le prétendant rendaient visite - une simple visite bien sûr, parce qu'ils étaient juste de passage - aux parents de la jeune fille. Alors s'engageait une conversation banale, à propos de tout et de rien, des menus incidents de la vie communautaire. d'événements survenus à des connaissances communes : mais comme on s'observe à la dérobée, chacun s'efforce de faire bonne impression.
Daniel Stauben nous donne, dans ses Scènes de la vie Juive en Alsace, une fidèle description de cette "entrevue" :
"On causa affaires, nouvelles, fêtes. Débora prêtait l'oreille, et Schémelé, tout en causant la regardait. Débora, par deux fois, avait pris part à la conversation, et Schémelé trouva qu'elle causait bien... Quelques instants après, les deux femmes sortirent et revinrent aussitôt avec des assiettes chargées de sucreries de toutes sortes. La mère versa de la liqueur dans de petits verres. Débora faisait les honneurs.L'heureuse nouvelle se répand alors et peu de jours après, parfois le lendemain même de l'entrevue, on célébrait les fiançailles. Une jeune fille qui s'était fiancée dans de pareilles circonstances s'appelait une Halemod Kalle, une "fiancée de la demi-fête".
- Combien de temps comptez-vous rester à Hegenheim? demanda Nadel à Schémelé.
- Je me trouve si bien ici que je n'ai plus envie de m'en aller, répondit Schémelé.
Et le père Nadel, après avoir, des yeux, pris l'avis de sa femme et de sa fille:
- Plus longtemps vous nous resterez, M. Schémelé, plus vous nous ferez plaisir.
Pour qui savait comprendre, tout cela voulait dire que de part et d'autre on s'était convenu." (2)
Le Knasmahl est une institution qui remonte au moyen âge germanique. qui avait prévu une cérémonie au cours de laquelle les clauses du mariage (tenayim) étaient définitivement fixées; et où l'on décidait du dédommagement financier (kenass) qui serait exigé en cas de dédit. Dans les gravures datant du 18ème siècle, figurant dans les ouvrages de P.C. Kirchner (3) et de J.C.G. Bodenschatz (4), on voit un homme qui tient une cruche dans sa main et s'apprête à la jeter à terre car "de même que ce pot brisé ne saurait être reconstitué, de même cet agrément ne pourra être rompu".
Les invités sont reçus dans la plus belle pièce de la maison des parents de la jeune fille et ils se pressent autour des fiancés, du rabbin. du chantre, du chamess (le "bedeau") et de l'instituteur. Le rabbin ou le chantre rédige alors, au milieu d'un silence solennel. les tenayim, le contrat qui constate que les deux jeunes gens se sont promis mariage. Dans ce contrat se trouvent consignés le montant de la dot et l'énumération des cadeaux que l'on compte se faire réciproquement; il stipule, en outre, que dans le cas où l'un des futurs en viendrait à rompre cet engagement. une indemnité serait versée à la famille ainsi lésée. Le rabbin, ou encore un vieillard érudit, trace alors à la craie un cercle au milieu de la salle. Il dessine au centre du cercle les lettres hébraïques mêm et têt, pour mazal tov, "bonne chance". Les fiancés prennent place dans le cercle et se font face, pendant qu'autour d'eux se pressent tous les invités. Le rabbin lit le contrat rédigé en hébreu et contresigné par les deux pères, le fiancé et deux témoins.
Voici comment D. Stauben (5) décrit la suite de la cérémonie :
Rebb Lippmann tira de l'immense poche de son gilet un morceau de craie. Avec cette craie, il traça un rond au milieu de la salle. Sur ce rond, il fit placer toutes les personnes présentes. Schémelé était en face de Débora. Rebb Lippmann, placé au centre du cercle. présenta à tous les témoins de cette scène un pan de sa redingote que chacun toucha à tour de rôle. Il se dirigea ensuite vers la commode. prit une tasse qui était posée là tout exprès. se replaça au milieu de l'assistance toujours rangée en cercle. éleva le bras sans doute pour augmenter la force d'impulsion, laissa tomber la tasse qui se brisa en mille morceaux et cria à haute voix : Masel tof ! Tout le monde répéta en chœur : Masel tof ! Et chacun ramassa pour l'emporter un débris de la tasse. Les fiançailles étaient consommées.
Parfois. c'est le fiancé lui-même qui prenait le pan d'habit de chaque témoin, les réunissait, et promettait devant l'assemblée d'accomplir fidèlement les devoirs imposés par ce contrat. Le rabbin allait auprès de chaque assistant recueillir dans une tasse l'argent pour les pauvres, avant que de la briser. A l'origine, ce cercle de craie devait probablement protéger le couple contre les esprits maléfiques mais - tout comme les cercles décrits autour de la couche du nouveau-né et de sa mère - l'explication la plus répandue au 19ème siècle affirmait que désormais le fiancé et la fiancée ne devaient plus dévier de la ligne dans laquelle ils s'étaient engagés. Le pan d'habit touché par le fiancé ou l'assistance signifie, en droit talmudique (inspiré, en l'occurrence, par le droit romain), l'assentiment dans toute espèce de contrat.
Les participants se félicitent mutuellement par la formule hébraïque mazal tov qui signifie ainsi que nous l'avons souligné précédemment : "que tout soit pour le mieux". D'autre part. tout de suite après la cérémonie, le chadchen recevait son dû :
"Peu d'instants après la cérémonie, le père Nadel et le père Salomon firent entrer Ephraim dans une pièce voisine. A travers la porte, on entendit retentir un son métallique. Selon la coutume, on réglait immédiatement les honoraires du chadchen. Conformément au tarif en usage, Ephraim Schwab reçut 4 pour 100 de la dot. Il entra rayonnant." (6)
Une année après le Knasmahl, parfois après une période plus brève, on célébrait le mariage. La veille du jour prévu s'appelait en Alsace Chiflaunes Nacht, la "nuit des cadeaux. L'origine du mot sivlones, qui signifie à la fois les cadeaux échangés par les fiancés à la veille de leur mariage et les festivités qui accompagnent cette cérémonie, est fort controversée : le terme sivlonoth désigne dans le Talmud (Qidushin 50 a, Bava Batra 146 a) les présents envoyés par le fiancé à sa future épouse ; certains font dériver ce terme du mot grec qui en latin devient symbola, dona sponsalitia, alors que Maimonide le rattache à l'hébreu savol, "porter".
La coutume d'échanger des cadeaux entre le fiancé et la fiancée remonte au moyen âge germanique. On offrait des ceintures ouvragées avec des fermetures en or ou en argent, ainsi que des livres de prières magnifiquement reliés. Au milieu du 19ème siècle, lors de la Chiflaunes Nacht, les fiancés se faisaient mutuellement cadeau d'une pièce d'argent à laquelle était attaché un ruban. Le rabbin le présentait sur une assiette, en disant : "Voici ce que le fiancé (ou la fiancée) vous envoie comme chiflaunes" . L'un des convives attachait le ruban à la taille des jeunes gens qui le gardaient toute la journée du mariage. Jusqu'au début du 20ème siècle en Alsace, le fiancé revêtait alors la ceinture de son habit mortuaire, le Sarjeness Gertel, et apportait lui-même à sa fiancée les recueils de prières pour les fêtes (ma'hzorim) et une tféle (hébreu : tefila), c'est-à-dire le recueil des prières journalières et du Shabath.
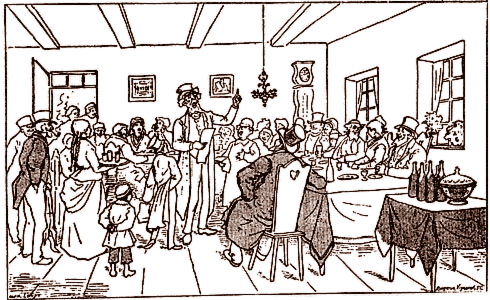 |
Le Shabath qui précédait le mariage était appelé Shabbes Spinholz. Selon A. Tendlau (7), l'origine du mot Spinholz est difficile à préciser; certains y voient une déformation de l'hébreu she-ben aliz, "lorsque le fils se réjouit " ; d'autres affirment que le fiancé remettait à cette occasion un rouet (allem. : Spinnrad) à sa fiancée, symbolisant ainsi l'ardeur dont celle-ci fera preuve dans ses tâches ménagères.
Dans le traité talmudique Yoma 66 b, Rabbi Eliezer affirme que seule une femme qui file la quenouille fait preuve de sagesse, et il cite ce verset d'Exode 35:25 : "Toutes les femmes au cœur sage filèrent de leurs mains". De même, selon les Proverbes 31:19, la femme vaillante "met la main à la quenouille, et ses mains saisissent le fuseau". A la naissance d'une fille le père la bénissait en ces termes : "Que ta volonté soit faite, Dieu éternel, afin que j'apprenne à ma fille à filer, à tisser, à coudre et à faire le bien". L. Zunz fait dériver ce terme de l'italien spinalzare qui, dans la langue commune, signifie "jouer" et "se réjouir".
En Alsace lors du Shabbes Spinholz, le fiancé est "appelé à la Torah" (aufgerufen), car nombreux sont ceux qui se pressent pour lui acheter une metswe, c'est-à-dire l'honneur d'assurer la sortie et la rentrée des rouleaux de la Loi, ainsi que de suivre sa lecture sur l'estrade aux côtés du rabbin. Puis, à la fin de l'office, la communauté tout entière est invitée à une réception où l'on offre des gâteaux, notamment des biscuits appelés Beliwetart. Les hommes dégustent a charfer, une eau de vie forte, de la quetsch, de la mirabelle ou du kirsch, tandis que les femmes boivent a séser, une liqueur douce (8).
Au retour de la synagogue, après la cérémonie nuptiale qui avait lieu l'après-midi, on allumait des chandelles devant le rabbin et on lui apportait la dot déposée jusque-là en mains sûres. Il la comptait avec soin et la remettait au fiancé en déclarant, selon une formule consacrée, que "l'honneur était satisfait". Voici comment se déroulait cette opération, vers 1850, lorsque le parnass de Wintzenheim (Haut-Rhin), commerçant aisé grâce à son commerce de lie de vin et de peaux de chevreaux et de lapins, maria sa fille aînée en lui accordant une dot de trois mille livres en beaux deniers comptants et un trousseau en sus :
"Dans un coin de la salle, une petite table, sur laquelle brûlaient six chandelles en plein jour, portait deux petits sacs dont les panses rebondies trahissaient la présence du numéraire.
Deux personnes, qui ne devaient être ni parents ni alliés de la maison, décachetèrent chacune un de ces sacs et additionnèrent le contenu à la lueur des chandelles. Au bout de quelques minutes, trente piles de cent francs, composant la dot, s'étalèrent aux yeux des spectateurs en belles pièces de cent sous et l'honneur fut déclaré satisfait" (9).
La plupart du temps on prélevait la dîme avant même que de remettre la dot au fiancé, tout de suite après en avoir vérifié le montant. On distribuait déjà une partie de la dîme aux mendiants le matin au retour de l'office.
Quand je revins à la maison Marem, la cour était pleine et tumultueuse. Il y bourdonnait une foule confuse et bruyante qui se pressait impatiente autour d'une table placée au milieu. Sur cette table étaient étalées des piles de gros sous et de pièces d'argent, formant à peu près une somme de cinquante écus. Un homme - apparemment un ami de la maison - était là, faisant décliner leurs noms et qualités à tous ceux qui s'approchaient. C'était une véritable Babel de costumes, de langages et de cris. Aujourd'hui toute cette population vagabonde était réunie sur un seul point, attirée, comme de juste, par la noce. Ils venaient selon l'antique usage, toucher leur obole de la dîme; généreuse coutume qui s'est maintenue parmi nous à travers les siècles et qu'observent surtout les Juifs de la campagne ! Là, le plus humble des Israélites ne recevrait-il en dot que cinq fois la somme de cent francs, soyez certain que le dixième de ce modeste patrimoine passera entre les mains des frères nécessiteux" (10).
C'est le père de la fiancée qui procède à la distribution de la dîme aux nombreux pauvres accourus de toutes parts. Alors que Georges Stenne (11) remarque que, si cet usage est toujours largement en vigueur en 1877, le montant des aumônes distribuées ne correspond plus exactement au dixième de la dot, Daniel Stauben, encore peu d'années auparavant, avait pu affirmer que cette obligation était scrupuleusement respectée.
Après la distribution de la dîme aux pauvres, on procède à l'énumération et à la présentation fort détaillées des différents cadeaux de noce que l'on place avec beaucoup de soin sur deux lignes parallèles, affectées l'une à la famille du mari, l'autre à celle de la jeune femme. Offrir un cadeau aux mariés se dit einwerfen, züm Einwurf gewe en judéo-alsacien, ce qui signifie littéralement "jeter" des présents dans la "corbeille de mariage" . Parmi les cadeaux traditionnels, les parents et amis offraient la lampe à becs pour le Shabath, la fontaine murale appelée Gisef (all. Giess-Fass), et aussi deux places à la synagogue.
A l'extrémité opposée, devant une table carrée, était gravement assis, une plume à la main, un registre devant lui, le 'hazan (le chantre) du village. Quiconque avait à faire un cadeau de noce au jeune ménage se dirigeait vers cette table; le 'hazan l'inscrivait en énonçant chaque fois, à haute et intelligible voix, l'objet donné et le nom du donateur. A chaque objet présenté, c'étaient des cris de surprise et d'admiration. Déjà j'avais entendu annoncer une lampe à sept becs en cuivre rouge, une fontaine à bassin avec double robinet, quatre douzaines d'assiettes en étain, une paire de chandeliers avec mouchettes, quarante aunes de toile, un rouet, un huilier, six paires de draps et un recueil complet de livres de prières pour toutes les fêtes (édition Soultzbach), quand la voix du chantre fut couverte par les sons d'une clarinette qui préludait : c'était le signal de la danse" (12).
Les pauvres et les mendiants avaient leur place à la table de noces, où ils étaient traités comme les autres invités. Au fur et à mesure que les Juifs d'Alsace s'embourgeoisèrent, la coutume d'admettre au repas de noces des mendiants demeura, mais on les relégua en bout de table. Albert A. Neher rapporte qu'au début de sa carrière, Loewele Furth, un schnorrer ( mendiant) qui devait se tailler un grand renom en Alsace, s'était rendu dans son costume de tous les jours, rapiécé et délacé, à un banquet de noce que donnait un riche bourgeois de Soultzbach. Il fut relégué en bout de table et personne ne s'occupa de lui. Il mangea, but et rredingote. Il en fit de même du vin et du pain. Après un moment de surprise, le maître de maison demanda à son hôte quel était le motif de son étrange comportement. Loewele Furth sourit : "Mais, j'étais déjà là hier, en habits de tous les jours il est vrai, et personne, ni de vous, ni de vos hôtes, ne m'a gratifié de la moindre attention. Aujourd'hui, je viens en habits de Yontef (fête) et me voilà comblé de tous les honneurs. Je me dis, par conséquent : ce n'est pas à ma personne, mais à mon habit que je dois ce Mazel (bonne fortune). Il est donc équitable que mon habit en ait sa part" (13). Si cette histoire, probablement enjolivée, est devenue célèbre et si on lui a accordé un tel crédit, c'est qu'elle témoigne de la sécheresse de cœur et du mépris grandissant à l'égard de la pauvreté de la part de certains Juifs qui s'embourgeoisent à la fin du 19ème siècle. A une époque plus récente la générosité se manifeste encore lors du repas de noce puisqu'on y dérobe le soulier de la mariée pour le vendre aux enchères au profit des "bonnes œuvres". Il en va de même pour l'honneur de réciter à voix haute la prière de grâces après le repas (s'Benche versteige). La somme ainsi récoltée est destinée à secourir les nécessiteux.
| Page suivante |  |
 |