par le Grand Rabbin Simon FUKS (suite)
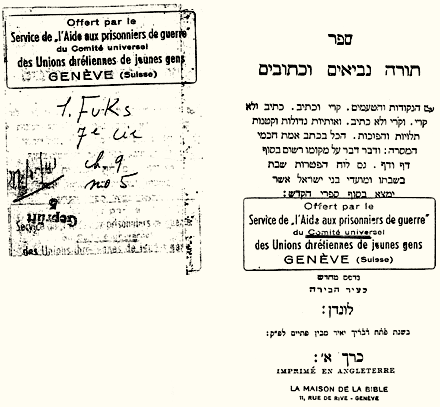 Puis, fin janvier 1941, j'appris que j'allais faire partie d'un groupe de libérés.
Ce n'est qu'avant mon départ, qu'on me remit la Bible que m'avait envoyée
de Genève l'Union Chrétienne des Jeunes Gens (YMCA). On ne pouvait
pas me la donner auparavant. puisque c'était le texte hébreu,
et que, sans doute, personne au camp, parmi les Allemands, ne pouvait dire s'il
s'agissait d'un ouvrage à contenu séditieux ou non. Ce ne fut
qu'au dernier moment qu'on se résigna à le déclarer "Geprüft",
c'est à dire examiné, censuré, comme en témoigne
la première page de la photocopie que je joins en annexe à mon
récit (voir ci-contre).
Puis, fin janvier 1941, j'appris que j'allais faire partie d'un groupe de libérés.
Ce n'est qu'avant mon départ, qu'on me remit la Bible que m'avait envoyée
de Genève l'Union Chrétienne des Jeunes Gens (YMCA). On ne pouvait
pas me la donner auparavant. puisque c'était le texte hébreu,
et que, sans doute, personne au camp, parmi les Allemands, ne pouvait dire s'il
s'agissait d'un ouvrage à contenu séditieux ou non. Ce ne fut
qu'au dernier moment qu'on se résigna à le déclarer "Geprüft",
c'est à dire examiné, censuré, comme en témoigne
la première page de la photocopie que je joins en annexe à mon
récit (voir ci-contre). Notre dernière étape en terre allemande fut Constance. On nous y offrit un concert consacré à Beethoven. L'officier allemand qui présidait cette manifestation fit un discours, déclarant qu'il était possible, même à des adversaires, de communier dans l'amour de la musique. Je ne sais s'il incluait également les Juifs dans cette "communion", car pour se rendre à la salle où devait avoir lieu le concert, il fallait traverser un petit parc où l'on pouvait voir fichées au sol des plaques portant la mention : "Interdit aux chiens et aux Juifs". Tel est le dernier souvenir que j'ai gardé de l'Allemagne.
C'est par la Suisse que nous arrivâmes en France. Nous fûmes dirigés sur le camp de Sathonay où devait avoir lieu notre démobilisation. Le colonel qui s'en occupait nous fit un discours dont l'essentiel se résumait dans ces mots : "Suivons le Chef, on les aura !". Il est évident que de telles paroles n'allaient pas diminuer, pour l'heure, mon état d'esprit pétainiste. Savais-je alors que, comme le rappelle Marc Ferro dans son Pétain : "Lorsque fut élaboré le premier Statut des juifs, le 3 octobre 1940, ce fut justement Pétain qui se montra un des plus sévères contre eux" ? Mais qu'ait pu exister une telle attitude à l'égard des Juifs, et ceci au début, même chez certains résistants, a de quoi stupéfier. En tous cas, c'est notamment ce qu'a affirmé Claude Lévy dans un article paru dans le numéro de juillet 1992 de l'Information juive", à savoir, que l'Organisation Civile et Militaire (OCM), l'une des plus importantes organisations de la Résistance, avait prévu dans ses premiers objectifs, de maintenir après la Libération le Statut des Juifs ! Elle y renonça rapidement. par suite de certaines pressions. Il n'est pas inutile de préciser, je crois, qu'il s'agissait là d'un organisme de résistance de l'Armée. Comment s'étonner. dès lors, du comportement qu'auront en Afrique du Nord Weygand, Noguès, et surtout l'amiral Abrial dont l'antisémitisme présentait parfois un caractère délirant, sans parler de l'attitude dépourvue d'ambiguïté du général Giraud à l'égard des Juifs, alors même que l'Algérie était libérée. (Voir à ce sujet: Claude Paillat : Les dossiers secrets de la France contemporaine, tome VII, p 208 et suivantes).
C'est de Bains-les-Bains (Vosges), où elle habitait depuis les premiers temps de la guerre, que ma femme vint me rejoindre à Lyon avec nos trois garçons. Nous étions, au début février 1941. Il nous fallut attendre trois mois, passés la plus grande partie à Nîmes, où s'était installé le grand rabbin Ernest Weill de Colmar pour que je reçoive enfin une affectation. Je fus chargé par le grand rabbin de France d'exercer mon activité à Agen et dans tout le Lot-et-Garonne. J'ignorais alors, la tournure qu'allait prendre cette activité par la suite.
Souvenirs de mai 1941 à mai 1943.
Ceci dit, les illusions que j'avais pu avoir sur le chef de L'Etat Français allaient bientôt se dissiper. Elles s'effilochèrent, avec l'aggravation d'une situation qui allait atteindre les sommets de la tragédie, avec les rafles à partir de la deuxième moitié de l'année 1942, suivies de la Déportation.
Mais nous n'en étions pas encore arrivés à ce stade, lorsque je suis arrivé à Agen.
Je voudrais dire, dès l'abord. que ma tâche aurait été impossible, surtout à partir de l'ère des plus grands dangers, sans la présence, à mes côtés, de mon épouse. Elle n'a pas ménagé sa peine, dès qu'il s'agissait de venir en aide à ceux qui faisaient appel à nous. Il est vrai que, lorsque j'avais fait sa connaissance à Paris quelques années auparavant, alors même que l'idée ne m'était pas venue encore à l'esprit de la demander en mariage, j'avais pu admirer son sens social développé qui se manifestait notamment en distribuant de la soupe aux chômeurs, rue Cujas, dans un local dont pouvaient disposer les étudiants, et en s'occupant, comme cheftaine des Eclaireuses Israélites, d'un groupe de filles dont les familles habitaient la rue Mouffetard, "la Mouffe", comme on disait, et dont la pauvreté sautait aux yeux. Cette rue ne s'était pas encore transformée, du moins dans sa partie haute, en restaurants exotiques, en cabarets et en studios modernes, comme c'est devenu le cas, depuis lors.
En quoi consistait normalement la tâche d'un rabbin ? Satisfaire aux besoins religieux des fidèles : offices réguliers, cours de Talmud Torah, s'occuper des jeunes en organisant différentes activités, visite des malades, assistance sociale. Parmi les malades que j'eus à voir à l'hôpital, il en est un, dont je me souviendrai toujours. Il s'appelait Dornhelm, était sans famille, si je ne me trompe. Son état était très grave. Aussi suis-je allé lui rendre visite le plus souvent possible. J'ignorais cependant que sa fin était si proche. Aussi ne fus-je pas près de lui lorsqu'il rendit le dernier soupir. Un voisin de lit me raconta que, peu avant qu'il n'expirât, la mère supérieure tenta avec insistance de le convertir, de lui faire abjurer le judaïsme. Mais, avec tout ce qui lui restait encore de force, il détourna la tête, et fit un signe de dénégation. On peut s'imaginer avec quelle tristesse je fis ses obsèques, le considérant d'une certaine manière comme un martyr d'Israël.
Je ne réussis pas à établir la she'hita (l'abattage rituel) à Agen, de sorte qu'il fallait faire venir de la viande de Périgueux où avait pu se former une importante communauté, dès le début des hostilités. A Agen, avant la guerre, il n'y en avait pas. Y résidaient tout juste quelques familles dont je ne sais même pas si elles avaient des rapports les unes avec les autres. Par contre, beaucoup de réfugiés étaient venus s'installer dans le Lot-et-Garonne, non seulement des familles venues de Belgique et de Hollande, mais aussi des Juifs d'Alsace, tout particulièrement du Haut-Rhin, dont la Préfecture avait d'ailleurs été évacuée à Agen même. C'est ainsi, que j'y ai retrouvé Max Lazare, président de la communauté de Mulhouse, et Armand Picard, qui avait assumé des responsabilités dans la Communauté de Colmar, et qui y jouera un rôle très important après la guerre. Je crois qu'on peut dire que ces deux messieurs ont contribué à la constitution d'une communauté à Agen. Avant ma venue, autant que je sache, c' est à eux qu'on s'adressait, en cas de besoin.
Il va de soi, qu'il fallait aussi se rendre, autant que possible, dans certaines localités du département où demeuraient, sans doute, déjà en résidence forcée, un certain nombre de Juifs étrangers, venus non seulement d'autres départements, de la Zone occupée, mais des pays comme la Belgique et de la Hollande, qui se trouvaient sous la coupe de l'envahisseur. Je pense notamment à Marmande, au Mas d'Agenais. à Castillonnès. En réalité, il y en avait partout, comme je m'en rendis compte, lors des rafles, et de mon "séjour" au Camp de Casseneuil. Castillonnès était très populaire chez nos enfants, car il leur arrivait parfois de crier à tue tête : "Castillonnès, résidence forcée !" De même, qu'en passant devant le marché couvert à Agen, l'un d'eux demanda : "C'est là le marché noir ?". Ce qui était moins drôle, et qui agaçait prodigieusement ma femme, c'est qu'un monsieur d'aspect respectable, un ancien professeur, je crois, déambulait tous les jours Place Carnot, où nous habitions, et criait à haute et intelligible voix : "Nieder mit den Juden. nieder mit dem Rabbiner !", c'est à dire. "A bas les Juifs, à bas le rabbin!". Sa voix portait jusqu'à notre appartement, situé au deuxième étage. Je n'étais pas encore sourd, à ce moment-là, mais je dois dire que son comportement me laissait indifférent. ce qui n'était pas le cas de ma femme... Un jour, n'y tenant plus, elle alla l'aborder : "Monsieur, puis-je vous poser une question?". Et lui, très poliment, très vieille France en quelque sorte, lui répondit : "Mais oui. Madame". "Pourquoi. lui demanda ma femme, prononcez-vous de telles paroles qui sont injurieuses pour nous ?" Furieux, il rompit l'entretien, et, bien entendu, recommença dès le lendemain.
Le Lot-et-Garonne a un sol d'une fertilité exceptionnelle. Comme me le dit l'évêque d'Agen. Mgr Rodier, lorsque je lui fis une visite de courtoisie : "Les gens d'ici sont de braves gens. Leur piété n'est pas excessive. Ce qu'ils demandent au Bon Dieu, c'est qu'il les laisse vivre le plus longtemps possible sur cette terre où ils se sentent si bien". Lorsque j'étais entré dans son bureau, j'avais croisé une personne qui en sortait. L'évêque me dit : "Ce monsieur est venu me voir pour être converti". J'avoue que je fus interloqué par ce manque de délicatesse à mon égard, de la part de Mgr Rodier.
Ce qui était stupéfiant, c'est que si, à Agen. nous étions réduits à une portion congrue, et n'obtenions les denrées alimentaires essentielles que contre remise de tickets, dans certaines localités il n'en n'était pas ainsi. A Castillonnès, par exemple, on pouvait avoir le pain librement, ce qui nous fut fort utile, car nous recevions ces tickets de pain inemployés là bas, et ils servaient au groupe de dames, que me femme réunissait régulièrement, pour confectionner des colis de nourriture pour des internes du camp de Gurs. Notre homme de confiance, là-bas, était le rabbin Léo Ansbacher, lui-même interné, qui nous fournissait une liste de gens qui avaient plus particulièrement besoin d'être secourus. Quelle ne fut pas notre surprise, il y a quelques années, de voir arriver chez notre fille où nous nous trouvions, à Petah Tikva, Léo Ansbacher, devenu rabbin dans un quartier de Tel Aviv ! Il avait appris notre présence par son neveu, libraire à Petah Tikva, chez qui je me fournissais en livres, et il avait tenu à nous rendre visite, pour nous remercier.
Il y avait donc abondance de denrées alimentaires dans le Lot-et-Garonne. Encore fallait-il avoir suffisamment d'argent pour se les procurer. Or la pauvreté était immense, tout particulièrement chez les étrangers. C'est pourquoi, peu après mon installation à Agen, j'écrivis au Comité d'Assistance aux Réfugiés (CAR), dont le centre était à Marseille, pour demander d'être son représentant pour le Lot-et-Garonne. On me répondit que c'était trop tard. "Comment trop tard ?", ai-je répondu, "est-ce ma faute si j'ai été prisonnier de guerre pendant plusieurs mois?" Mon argument fut considéré comme valable, et je reçus régulièrement de l'argent du CAR, afin de pouvoir distribuer des mensualités à des familles qui en avaient tant besoin. De plus, j'avais remarqué combien était grande, la misère physiologique de certains enfants. C'est après beaucoup d'insistance, que j'obtins que puisse s'en rendre compte avec moi, le docteur Elie Weill, inspecteur médical de l'OSE, frère du Docteur Joseph Weill, dont on sait le rôle éminent au sein de cette organisation. Qu'est-ce que j'obtins pour ces enfants ? Un peu de farine vitaminée.
Est-il nécessaire de dire que nous étions en rapport avec les éléments les plus variés de la population juive ? Quelle que soit l'idéologie des gens qui s'adressaient à nous, c'étaient pour nous des frères, et cela nous suffisait. J'ai eu, entre autres, des relations des plus cordiales avec deux tailleurs d'origine polonaise. Je ne sais plus s'ils étaient membres du parti communiste ou du Bund, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas des piliers de synagogue. Ils venaient me voir, pour que je les aide à envoyer de l'argent ou des colis à des camarades qui étaient internés dans un camp, au Sahara. Je répondais de façon positive à leur appel. Mais le Sahara était loin, tandis que Gurs était proche. J'appris, bien des années après la guerre, qu'en réalité il s'agissait là-bas d'un véritable bagne, et j'éprouverai toujours le remords de n'avoir pas aidé d'avantage ceux qui se démenaient en faveur de leurs camarades victimes du sadisme et de la bestialité humaine. Dans un camp du Sahara, l'adjudant, par exemple. s'arrangeait pour que le moment d'aller chercher, à une certaine distance, la soupe, coïncidât avec l'heure où avait lieu l'enterrement d'un interné... De sorte, que les camarades du mort, devaient choisir entre aller chercher la soupe, et dans ce cas ne pas assister à cet enterrement, ou bien prendre la décision inverse, et en subir les conséquences, à savoir, se priver de manger. Je suppose que cet adjudant inventa d'autres distractions pour les malheureux qui dépendaient de lui, puisqu'à la Libération, il fut condamné à mort, tandis que le colonel commandant le camp, lui, s'en tira avec une condamnation à la prison à perpétuité.
Mais revenons à la France métropolitaine.
En Zone occupée, la situation des Juifs se dégrada très
rapidement. On pourrait parler d'étapes, constituées par l'exclusion
de bon nombre de professions, d'expropriations, du port de l'étoile
jaune, de rafles et de l'ouverture de quelques camps. Et le comble de l'horreur
fut atteint par la rafle du Vel d'Hiv, le 16 juillet 1942, suivie de l'internement
à Drancy, pour aboutir à la déportation vers l'enfer
d'Auschwitz. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on avait
pu se bercer pendant quelque temps, de l'illusion, en zone provisoirement
non occupée, que le gouvernement de Vichy allait poursuivre une politique
antisémite plus mesurée. Après tout, la France avait
subi une immense défaite, et tout le monde en souffrait. S'il est vrai
que les Juifs en subissaient, plus que les autres, les conséquences
néfastes, ils s'imaginaient, qu'ils pouvaient compter, malgré
tout, de la part du pouvoir, sur quelque protection, d'avoir à tout
le moins la vie sauve, et ne pas être livrés à la barbarie
nazie. Il fallut bien vite déchanter.
Ce qui me semble avoir été déterminant dans le changement
de l'opinion de beaucoup de Juifs à l'égard de Vichy, ce fut
l'obligation de porter la mention "juif" sur la carte d'identité.
Et l'ordre donné à toutes les organisations juives, comme le
CAR, l'OSE,
l'ORT, les
EIF, de faire désormais partie d'un organisme créé
et contrôlé par l'Etat, à savoir l'UGJF, "l'Union
Générale des Juifs de France", ne put que détériorer
encore plus, l'idée qu'on pouvait se faire, du gouvernement de Vichy.
Je me souviens qu'on m'avait suggéré, à un certain moment,
de "prendre l'air" ailleurs, ne serait-ce que pour quelques jours.
J'avais suivi ce conseil "amical", et m'étais rendu à
Puy-Guillaume (Puy de Dôme) chez des cousins de ma femme. Et c'est là
qu'obéissant à la loi, je m'étais fait tamponner ma carte
d'identité de la mention "Juif". A peine rentré à
Agen, je fus convoqué à la police : "Vous n'avez pas fait
tamponner votre carte d'identité". "Pardon", ai-je répondu,
"la voici. vous voyez que tout y est. Montrez-moi le texte qui précise
que cette opération doit se faire au lieu d'habitation ! J'étais
en voyage, et vous pouvez constater que je suis en règle".
l'UGJF, Maurice Fourmann, Philippe de
Gunzbourg.
Mais comment parler de l'UGJF ? N'est-ce pas entrer dans des polémiques,
dont on peut se demander si elles finiront un jour ? N'est-ce pas aussi rouvrir
des plaies qui ne pourront jamais se cicatriser? Tout ce que je peux dire
à ce sujet n'a qu'une portée limitée, je tiens à
le préciser, puisque je ne suis resté à Agen que de mai
1941 à mars 1943. J'insiste sur le fait, que toutes les organisations
connues, officielles, furent obligées de faire partie de l'UGJF, mais
à ma connaissance, toutes, sinon la plupart, firent un travail clandestin.
C'est ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, que les Eclaireurs Israélites
créèrent la "Sixième", dont on ne dira jamais
assez, quel travail admirable elle accomplit.
Mon frère Moïse, décédé en 1991, était
assistant social au CAR ; il travaillait par conséquent dans le cadre
de l'UGJF. En quoi consistait sa tâche, lorsque je lui rendis visite
à Perpignan ? C'était de s'occuper à faire passer clandestinement
des Juifs en Espagne. Quant à moi, dont j'ai rappelé que j'étais
le responsable du CAR pour le Lot-et-Garonne, je reçus une lettre circulaire
du Grand Rabbin de France et qui était adressée à ceux
d'entre les rabbins qui pouvaient faire partie d'une des organisations obligatoirement
inféodées à l'UGJF, nous intimant l'ordre de donner notre
démission, en signe de protestation contre la création de l'UGJF
J'ai donc donné ma démission du CAR.
Mais l'assistance sociale devait-elle cesser, pouvait-elle cesser ? Qu'allaient
devenir de pauvres familles, pour qui notre aide, si minime qu'elle ait pu
être, constituait néanmoins un apport important ? Avaient-elles
la possibilité de se cacher, de se camoufler, d'entrer dans la clandestinité
? Le bureau du CAR continua donc à fonctionner et devint, bien malgré
lui, une émanation de l'UGJF. Mais le nouveau système devait
fonctionner autrement. Il fallait qu'il y ait un secrétaire, un trésorier,
et un secrétaire adjoint, tous les trois payés, cette fois,
en qualité de fonctionnaires. C'est à moi qu'il incomba de chercher
les personnes qui accepteraient d'occuper ces fonctions. Il me fut facile
de trouver un secrétaire adjoint parmi les réfugiés.
Je n'eus pas de difficulté non plus en ce qui concerne la charge de
trésorier. Ce fut M. Fourmann, de Paris. Un heureux hasard fit qu'il
passa à Colmar avec son épouse durant les vacances, en 1992.
Et c'est ainsi, alors que nous ne nous étions pas revus depuis 1943,
que nous avons eu l'immense plaisir de passer quelques heures ensemble, et
d'égrener des souvenirs qui dataient de 49 ans.
Par l'échange de lettres qui suivit cette rencontre inespérée,
j'appris que, jusqu'à la guerre, Maurice Fourmann avait été
cogérant, avec son père, d'une maroquinerie à Paris.
Replié à Agen, il y créa, en décembre 1940, une
filiale, sous la dénomination et l'anonymat de la Maroquinerie de Gascogne,
dans le but de regrouper, en zone Sud, les relations avec les collaborateurs
et clients qui ne pouvaient plus correspondre avec Paris. Maurice Fourmann
m'apprit qu'un jour, la Milice soupçonnant un propriétaire juif
derrière cette entreprise, qui délivrait à l'occasion
des certificats de complaisance, avait fait exploser une bombe contre son
local. Mais lorsque cet événement eut lieu, j'avais déjà
quitté Agen. Je tiens à souligner que s'il accéda à
ma demande de devenir le trésorier du bureau de l'UGJF, et ceci, sans
la moindre hésitation, c'est qu'il y fut poussé par son désir
de se rendre utile, par son sens du dévouement à l'égard
de la Communauté d'Israël.
Mais, qu'il me fut difficile de trouver une personne acceptant d'assurer les
fonctions de secrétaire! En désespoir de cause, je m'adressai
à Philippe de Gunzbourg, petit-fils du banquier et mécène
juif de Saint Pétersbourg, le baron Horace de Gunzbourg. Il fallut
que j'insiste beaucoup auprès de lui, pour qu'il finisse par accepter,
par amitié pour moi. Il va sans dire que Messieurs Fourmann et de Gunzbourg
me remirent leurs émoluments, pour alimenter ma caisse noire. Un jour
que je me rendis à la campagne pour y célébrer un mariage,
quelle ne fut pas ma surprise de voir, au fond de l'autocar que j'avais pris,
Philippe de Gunzbourg, en tenue sportive, muni d'un sac à dos ! Nous
nous regardâmes sans mot dire. Et tout devint clair pour moi. Dans une
de ses lettres, datée du 21.1.1945, voici d'ailleurs ce qu'il m'écrivit
:
"...lorsque nous nous sommes retrouvés, un jour, dans un car,
entre Nérac et Mezîn, vous aviez compris, je sentais votre regard
pénétrant. J'ai réussi, car après avoir travaillé
à Agen, dans le Gers, dans le Marmandais, j'ai mené la Dordogne
Sud au combat grâce à 2000 hommes. Cette région fut parmi
les quatre ou cinq qui ont le mieux réagi."
On comprend dès lors, pourquoi j'avais en du mal à lui faire
accepter une responsabilité au sein de l'UGJF, lorsqu'on apprend quelle
fut celle qu'il assumait déjà. En réalité, il
n'aurait pas dû accéder à ma demande. Et il y a quelques
années, au cours d'un de mes séjours à Petah Tikva, j'eus
l'occasion de lire le livre de Max Hastings : La Division SS "Das
Reich" et la France (éditions Pygmalion, 1983). Il y est
question de Philippe de Gunzbourg, pages 107 à 112, p.123. 224, 229.
344. Il y a même une photo de lui, avec sa bicyclette, avec laquelle
il parcourut des milliers de kilomètres. Etait-il un collaborateur,
Philippe de Gunzbourg, dont un journal anglais, à l'occasion de son
décès, a souligné les exploits avec la section française
des opérations spéciales ( the Special Operation Executive,
french section) et auquel le journal d'Agen Le Petit Bleu, a
également consacré un article nécrologique élogieux
? (Voir DOCUMENT n°3).
Etaient-ils des Collaborateurs, Maurice Fourmann et Philippe de Gunzbourg?
Ou bien, ne furent-ils pas dignes d'éloges pour avoir accepté
des responsabilités qui risquaient de ternir leur réputation
?
Et mon jeune frère Moïse, décédé en 1991,
qui fut assistant social du CAR, que faisait-il à Perpignan lorsque
je suis allé le voir, début octobre 1942 ? Son activité
consistait, comme je l'ai déjà mentionné, à faire
passer des gens en Espagne. Etait-ce, de sa part, faire acte de collaboration
? Fut-ce également le cas, lorsqu'il tenta de sortir d'un camp d'internement
un petit enfant, en le cachant dans un sac de pommes de terre ? Malheureusement,
ce stratagème fut découvert, parce l'enfant s'agita et fit du
bruit. Ce fut alors une chance pour l'auteur de cette ruse, de ne pas être
inquiété, comme il le sera à une autre occasion. Aussi
ne puis-je qu'approuver le jugement prudent et mesuré qu'a émis
le professeur André Kaspi à l'égard de l'UGJF dans son
ouvrage : Les Juifs pendant l'occupation, en attendant une étude
plus complète sur cette organisation, ainsi que la déclaration
d'Annette Wieworka, dans le numéro de Tribune Juive du 14.1.1993
: "l'UGJF n'a jamais été un Judenrat".
Certains ont déclaré que, dans tous les cas, l'UGJF aurait du
se saborder à partir de 1943. Mais que faire des vieillards, des enfants,
épargnés ne serait-ce que provisoirement par les rafles ? Et
des femmes enceintes, et des malades? A supposer même que tous les hommes
et femmes valides aient gagné les maquis ? Hélas, la France
entière n'était pas devenue un Chambon-sur-Lignon, où,
comme l'a écrit le pasteur Trocmé : "Ici, on a aimé
les Juifs", où l'accueil fait aux Juifs, où la protection
des Juifs ne peuvent susciter qu'un profond respect et une immense gratitude.
Mais sans doute en ai-je suffisamment dit, sur ce sujet brûlant et douloureux.
L'histoire allait accélérer son rythme.
La rafle du Vel d'Hiv sonna comme le glas d'une époque révolue,
même pour les Juifs de la Zone Sud. J'appris quelle était l'atmosphère
à Paris après cette action dont le mot "barbare" semble
trop faible pour le qualifier, par une jeune fille de 17 ans, qui avait pu
s'enfuir, traverser la ligne de démarcation et passer à Agen,
où elle sonna à notre porte. Elle me raconta que certains éléments
de la population parisienne manifestèrent de la sympathie envers les
Juifs à cette occasion. Or, voilà qui est étrange, alors
que nous étions en train de converser, j'entendis sonner à la
porte de la maison... Nous habitions au deuxième étage, de sorte
que, par la fenêtre, je m'enquis de la raison de cette sonnerie. C'était
un monsieur qui demandait à me parler. Comme j'ignorais de qui il s'agissait.
je me dis qu'il était peut-être prudent de faire partir cette
jeune fille, ne serait-ce que de la chambre où j'allais recevoir ce
monsieur. Notre appartement présentait cette particularité,
qu'il n'y avait pas de corridor, que l'on passait directement d'une chambre
à l'autre, qu'elles étaient disposées en demi-cercle,
si bien qu'il y avait deux portes de sortie qui se faisaient face et qui donnaient
directement sur le palier de l'escalier de la maison. Ce qui permettait, lorsqu'on
recevait une personne par une porte, d'en faire partir une autre par la seconde
porte, sans qu'il y ait rencontre entre les deux visiteurs. Je reçus
donc ce monsieur qui désirait me voir, et qui s'avéra être
un inspecteur de police. Il me demanda si je connaissais mademoiselle X..
Ainsi la police savait déjà que ma jeune parisienne se trouvait
à Agen. Je répondis à ce policier : "Pourquoi me
posez-vous cette question ?."
Il me dit : " Si vous la voyez, dites-lui de passer à la police.
nous avons besoin de la voir. "
Je rétorquais : " Vous savez, avec ce qui se passe. avec les bruits
qui courent, à supposer même qu'elle vienne me voir, ça
m'étonnerait qu'elle suive mes conseils. "
Il me di t: " Vous n'avez qu'à lui donner le numéro de
mon bureau, je la recevrai moi-même. Elle n'a rien à craindre."
.
"A votre bureau, je veux bien le croire", dis-je, "mais au
bureau d'à côté?"
De la chambre voisine, la jeune fille avait pu écouter, et avait compris
de quoi il s'agissait. Et tandis que se poursuivait cette conversation avec
le policier, je l'entendis sortir par l'autre porte, descendre à pas
feutrés les escaliers. Et c'est ainsi qu'elle disparut. Quelques jours
plus tard je reçus d'elle une carte de Lourdes : "Salutations
d'un pèlerinage bien accompli". On trouvera peut-être que
je donne trop d'importance à un tel fait, dans mon récit. Mais
il caractérise le sentiment de méfiance qui s'était emparé
de nous qui, pourtant, vivions dans
la Zone Sud.
Quelques jours avant la rafle du 26 août, de bruits inquiétants circulaient, mais rien de tout à fait précis. On se doutait que quelque chose allait se passer, mais quoi exactement ? Au Service Social des Etrangers où je me rendis, un jeune fonctionnaire me donna la liste des catégories d'étrangers qui n'avaient rien à craindre, mais sans me dire de quoi. Si bien, qu'à un membre de la Compagnie des Travailleurs Etrangers, cantonné au Château de Tombebouc, et détaché à Agen en qualité de menuisier, qui vint me trouver pour me dire, que lui et certains de ses camarades, détachés comme lui à Agen. avaient reçu l'ordre de retourner à la Compagnie, je fus incapable de donner le moindre conseil, à savoir, s'enfuir ou obéir. Et c'est ainsi, que ce jeune homme, Heinrich Fenster, dont la soeur Lia vivait avec nous et s'occupait de nos trois garçons, ayant pris la décision d'obéir, fut envoyé à Auschwitz. Il en revint D. merci, et ne m'en a pas voulu, car il s'est bien rendu compte que j'ignorais alors ce qui allait lui arriver. Il vit actuellement à Paris.
Les avertissements sur les dangers qui allaient survenir, parvinrent peu à peu de différents côtés, entre autres de la part du maire de Colmar, Richard, expulsé par les Allemands et que j'avais l'occasion de rencontrer. Ce n'était donc pas seulement le Consistoire qui était en état d'alerte. Et voici qu'à la veille du 26 août, rentrant à la maison dans l'après-midi, j'appris par ma femme, qu'un employé d'une entreprise d'autocars avait passé pour nous prévenir que ceux-ci avaient été réquisitionnés pour le lendemain matin, à la première heure. Aussitôt, l'alerte fut donnée. Tandis que ma femme se rendait à la campagne, à Dausse, pour avertir du danger, je fis mon possible pour prévenir le plus de monde. Nous ne fûmes pas les seuls à le faire. Et c'est ainsi que le 26, au matin, ne furent arrêtés que trois hommes qui n'avaient pas tenu compte de notre avertissement. C'est ce qui se passa à Agen. Ce ne fut, hélas, pas le cas pour le reste du département. La Préfecture Régionale de Toulouse, mécontente du résultat obtenu, particulièrement à Agen je suppose, exigea une enquête. Et c'est ainsi, que deux inspecteurs de police débarquèrent chez moi, avec une convocation au commissariat de police. Ils repartirent bredouilles, puisque je me trouvai. à ce moment, au bureau du Service Social des Etrangers.
Ils se rendirent chez Max Lazare, qui, je le rappelle, faisait fonction de président de la communauté d'Agen pour lui dire:
"Hein, le rabbin a filé !"
"Non, il n'a pas filé", répondit Max Lazare.
Finalement ils me trouvèrent au bureau mentionné ci-dessus, et me demandèrent de les accompagner au Commissariat. Pendant que nous cheminions, je leur dis: "Messieurs, je vous plains, je ne voudrais pas être à votre place".
Arrivé à destination, je me trouvai devant un commissaire de police que je ne connaissais pas. Après avoir fait enregistrer mon identité il me demanda : "N'êtes-vous pas en rapport avec vos coreligionnaires étrangers?" Je lui répondis par l'affirmative. "Voyez-vous, j'ai l'habitude de leur demander des nouvelles, notamment de leur santé, de celle de leurs enfants."
"Ce n'est pas de cela que je veux parler", me dit-il ."Ne les avez-vous pas prévenus de ce qui allait se passer ?"
"A quoi bon perdre notre temps", répliquais-je. "J'ai prévenu le plus de gens possible, comme c'était mon devoir."
"C'est très grave, ce que vous avez fait", me dit-il. "En effet, c'est très grave, répondis-je, car en nous livrant, nous, vous vous livrez, vous, et vous êtes perdus, car vous ne pourrez plus leur résister."
Il me dit : "Puis-je faire une perquisition chez vous ?"
"Non", répondis-je, "mais je sais que vous êtes le plus fort."
Il me dit : "Bien que ce ne soit pas nécessaire, mais par égard pour vous, j'ai demandé a la Préfecture, un ordre de perquisition."
Et nous nous mîmes en route, lui, se tenant à une petite distance de moi, sans doute, pour que les passants ne remarquent rien d'anormal. Chemin faisant, il eut l'air de s'apitoyer, "Il s'agit de mon poste", me dit-il. Je lui répondis : "Sans doute s'agit-il de votre poste, mais pour moi il s'agit de ma peau, et ma peau a plus de valeur que votre poste."
A mon domicile il trouva la liste de tous ceux qui étaient provisoirement à l'abri des rafles, ce qui le mit, évidemment, en fureur.
A peine était-il parti, que j'appris qu'il y avait un camp à Casseneuil, par des amis de Villeneuve-sur-Lot, Jean Bader et Paul Enoch, qui eurent d'ailleurs, durant toute cette période, un comportement admirable. Je suppose que ce sont eux, qui furent en rapport avec le ou les médecins qui nous apportèrent une aide digne d'éloges. Ils me dirent, que je ferais bien d'aller voir ce qui se passait dans ce camp. Je me rendis aussitôt chez le préfet Destarac pour lui demander une autorisation me permettant de pénétrer dans le camp. Le préfet garda le silence. Je lui dis : "Je me débrouillerai sans vous. "
Sur ce, je me rendis à Casseneuil, et fis ma demande au directeur du camp.
Celui-ci me dit : "Je vous comprends, mais vous ne possédez aucun document nécessaire pour pénétrer dans le camp." Puis il me montra un exemplaire de la lettre pastorale de Monseigneur Théas, évêque de Montauban, dans laquelle il était déclaré : " (. . .) et je proclame que tous les hommes, aryens ou non aryens, sont frères parce que créés par Dieu ; que tous les hommes, quelles que soient leur race ou leur religion, ont droit au respect des individus et des Etats.
Or, les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. (...)"
Et il me fit la proposition suivante : "Je veux bien vous autoriser à entrer dans le camp, mais à la condition que vous y demeuriez, sans en sortir, jusqu'à sa liquidation." J'ai accepté immédiatement sa proposition, lui demandant, uniquement, de faire prévenir ma femme de mon absence, dont j'ignorais la durée. Et c'est ainsi. que j'ai été un interné volontaire au camp, jusqu'au 3 septembre, et j'ai accompagné jusqu'à la gare ceux qui allaient partir en direction de Drancy. Ce n'est qu'à mon retour à la maison que j'ai découvert dans le courrier arrivé en mon absence, le document du grand rabbin Hirschler, aumônier général des Camps, m'accréditant comme son représentant pour le camp de Casseneuil (Voir le DOCUMENT n°4). J'ai retrouvé ce document, envoyé de Marseille le 27 août seulement, alors que j'y étais déjà depuis le 26. Il ne me fut dont d'aucune utilité.
On m'y attribua une baraque pour moi tout seul, ce gui allait s'avérer fort pratique.
Tout en étant enfermé dans le camp, j'ai pu garder le contact avec mes amis de Villeneuve-sur-Lot, et c'est ainsi que j'ai su que des médecins étaient prêts à nous aider. Cette aide a été décisive pour sauver des vies humaines. Il me fut dévolu de faire savoir à certains internés que l'on s'occupait, à l'extérieur du camp, à les faire libérer. Mais ils devaient accepter les conditions suivante : simuler une très grande douleur, ce qui permettrait de les faire évacuer vers une clinique de Villeneuve-sur-Lot. Là, on pratiquerait sur eux un semblant d'intervention chirurgicale, c'est à dire qu'on ferait une incision sur une partie de leur corps, qui serait ensuite munie d'un pansement. De sorte que, si un policier allait faire une enquête, il ne supposerait pas qu'il y avait une supercherie. Je me souviens de deux cas, celui d'un certain M. Aspis, et celui d'un M. Kohn. J'allai trouver M. Aspis et lui dis : "Je veux que dans dix minutes vous vous sentiez mal !" Il ne fallut pas cinq minutes pour qu'il se torde par terre et qu'il simule si bien une appendicite, que nous-mêmes crûmes, qu'il ne jouait pas la comédie. Et c'est ainsi qu'il fut évacué du camp, et je ne le revis plus. Mais cela se passa mal pour M. Kohn. Il mourut sous le choc opératoire.
Mais il y eut surtout le sauvetage des jeunes filles Je fus chargé de les voir, l'une après l'autre, et de leur déclarer qu'on allait dire qu'elles étaient enceintes, et ainsi les faire sortir du camp. Ce plan réussit, mais comme il m'était interdit à moi, de sortir du camp, j'ignore ce qu'elles sont devenues, une fois libres, et combien ont survécu à la guerre Je me souviens que l'une d'elles me dit :
"Je donne ma place à ma mère, faites-la sortir !."
"Il ne peut malheureusement pas en être question", ai-je répondu, je vous laisse une demi-heure pour me dire si vous acceptez."
Ainsi, contrairement à ce qui est écrit au chapitre 11, verset 19 du livre du prophète Ezéchiel : "J'ôterai le coeur de pierre de leur corps, et je leur donnerai un coeur de chair", il nous fallut, parfois, transformer notre coeur de chair, en coeur de pierre.
Par ailleurs, un jeune médecin me fit la proposition suivante : amener dans ma baraque, et ceci à l'insu de leurs parents, tous les petits âgés de plus de deux ans, et qui de ce fait, étaient déportables en même temps que leurs parents. Et là, il ferait en sorte, qu'on puisse les identifier plus tard, si on allait les en séparer. Il va sans dire que j'ai accepté. Et tandis que je tenais ces enfants sur mes genoux, ce médecin pratiqua sur eux une sorte de léger tatouage, sur la tempe ou entre les doigts Je fis une liste de tous ces enfants, en indiquant leur nom et leur signe distinctif. Lorsque je dus quitter Agen précipitamment en mars 1943, je confiai cette liste à Madame Reine Geismar, femme d'un dévouement et d'un courage exceptionnels. Après la guerre, lorsque nous pûmes, à nouveau, être en contact, elle me demanda quoi faire de cette liste. Je lui répondis, avec le sentiment que l'on peut deviner : "Inutile de la conserver". Ce qu'on avait appris alors, du sort réservé tout particulièrement aux enfants en bas âge, fut si accablant, que l'idée même de conserver une telle liste, ne pouvait qu'ajouter à notre douleur.
C'est à moi qu'incomba aussi, la mission de prévenir ceux qui étaient hospitalisés à l'infirmerie du camp, qu'ils ne devaient se faire aucune illusion, car ils partiraient comme tout le monde. C'est à ce moment, qu'un groupe de "partants" me demanda avec insistance, que l'un d'entre eux, du nom de Ellenberg, puisse être libéré. Sur ma demande, le médecin désigné pour accompagner le convoi, me promit de le faire descendre du train, lors d'un arrêt avant le passage de la Ligne de Démarcation, sous prétexte qu'il venait d'être victime d'un malaise. La promesse fut tenue puisque, peu après, je revis notre homme à Agen.
| Page précédente |
 |
Page suivante |