Introduction
Cette interview essaie de mettre en lumière certains événements atroces et très éprouvants pour la population juive d’Alsace durant la deuxième guerre mondiale. Nous exposons dans ces lignes le témoignage de Colette Meyer-Moog, née à Strasbourg en octobre 1926 et qui a grandi dans cette ville. Elle a vécu pendant la guerre et a été témoin des événements tristes et douloureux de cette période de l’histoire des Juifs d’Alsace, qu’elle nous rapporte dans un récit singulier et très poignant.
Nous l’avons rencontrée en 2015 dans son appartement à Jérusalem, alors âgée de 89 ans. C’est le témoignage authentique sur le parcours d’une adolescente juive au moment de la guerre – poursuites, fuite, cachette, détresse, peur, angoisse et faim sont des réalités et des sentiments qui ont fait partie de son quotidien pendant cinq années de sa jeunesse. La pertinence de ce témoignage se trouve dans sa qualité historique (notamment dans la chronologie des événements), les précisions dans les faits – souvent très rares dans les ouvrages historiques couvrant cette période de l’histoire des Juifs de Strasbourg en raison d’une part de la rareté des témoignages des témoins oculaires (réticence à raviver des souvenirs traumatisants de leur enfance liés à la Shoah) et d’autres part, de la disparition progressive de la génération qui a vécu pendant la guerre.
Les autorités françaises donnent l’ordre officiel d’évacuer Strasbourg le 1er septembre 1939. Chaque famille avait reçu de la mairie une carte d’évacuation et savait à l’avance vers où elle devait se diriger. La communauté juive de Strasbourg a été évacuée vers Périgueux et Limoges, mais aussi vers d’autres villes de la zone libre : on essayait en fait d’éviter une forte concentration de Juifs dans une même ville – au contraire, ils étaient dispersés à différents endroits. Les personnes étaient conduites en voiture dans les Vosges – à Senones et à Bruyères – puis tous devaient monter dans des trains qui les emmenaient ensuite vers leur lieu de destination. Les quelques familles qui sont restées à Strasbourg ont pris le soin d’éloigner les enfants et les personnes âgées afin de pouvoir, en cas de nécessité, s’enfuir rapidement à leur tour.
Le récit de Colette Meyer-Moog
Comme beaucoup de familles, nous nous sommes rendus – mes parents, mon frère Raymond et moi – dans les Vosges rejoindre des parents et des amis, parce qu’on pensait échapper ainsi aux Allemands. Pendant la dernière guerre (1914-1918) l’armée allemande avait effectivement été stoppée par les Vosges qui avaient freiné leur progression à l’intérieur de l’est de la France. Mes parents qui se sont montrés prévoyant avaient loué dès l’été 1939 un appartement à Plombières-les-Bains dans les Vosges (en Lorraine). Nous avons donc passé avec ma famille tout l’été à Plombières-les-Bains. Mon père qui travaillait dans le commerce de gros, se rendait à son magasin à Strasbourg en semaine et rentrait pour le weekend nous rejoindre. Il y avait aussi à Plombières d’autres familles juives de Strasbourg ou de la campagne, comme par exemple la famille du Rabbin Deutsch – rabbin de Bischheim. Je me souviens que nous avons passé Kippour ensemble à Plombières.
Finalement, quand les choses se sont précisées à l’issue de la "drôle de guerre" et de l’offensive allemande à partir de mai 1940, mes parents se sont rendu compte que nous ne pouvions plus rester à Plombières. Nous sommes partis à Dijon où il y avait une communauté juive. A Dijon habitaient aussi avec nous mon grand-père qui vivait dans une petite ville du Bas-Rhin ainsi que des cousines. Dijon était une ville suffisamment importante pour ouvrir un magasin et ainsi permettre à mon père de poursuivre son activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de la famille. Moi j’allais à l’école et mon grand frère aidait mon père au magasin, tout en préparant son baccalauréat par correspondance. Nous étions donc installés à Dijon, confiants dans l’armée française. Mais quand les Allemands ont commencé à envahir la France par la Belgique et le Luxembourg, on voyait toutes les voitures filer vers le sud – avec des matelas sur le toit – à la recherche d’un refuge.
Mon père ne voulait pas quitter Dijon parce qu’il avait une confiance inébranlable dans l’armée française et la croyait encore capable de repousser les Allemands. Par ailleurs, Dijon étant située au cœur de la France, les Allemands ne pourraient jamais franchir toutes les lignes de défense françaises pour arriver jusque-là. Finalement, comme les Allemands ont avancé et occupé Paris le vendredi 14 juin 1940, après la capitulation de la France, nous avons décidé de quitter à notre tour Dijon le soir même, dans un véhicule que mon frère – alors à peine âgé de 17 ans – conduisait. Mes parents n’étaient pas orthodoxes mais ils ne roulaient pas Shabbat, toutefois l’urgence des événements nous obligeait à partir ce jour-là – et effectivement le lendemain, samedi 15 juin 1940, les troupes allemandes rentraient dans Dijon. Les Allemands ont tout de suite occupé la maison où nous avions loué un appartement et ont en fait le Q.G. de la Gestapo. Tout ce que nous avions laissé dans l’appartement ou moment de notre fuite a été confisqué par les Boches (2).
Nous étions ainsi que plusieurs familles, en fuite sur les routes en direction du sud, voiture derrière voiture, ne sachant pas où aller. On avançait tant bien que mal, on dormait où on pouvait. Nous avons continué à rouler et sommes finalement arrivés dans un village du Cantal en Auvergne. Les gendarmes étaient sur les routes et nous empêchaient de circuler, afin de laisser la voie libre à l’armée qui battait en retraite. Nous sommes donc restés dans ce village. Il n’y avait plus de place à l’hôtel et la mairie nous a logés provisoirement dans le château du baron. Tous les matins lorsqu’on croisait le baron il nous demandait : "alors, quand est-ce que vous partez ?" Ce sont là des souvenirs qui restent et qui marquent un enfant. Nous avons été ensuite logés à l’hôtel.
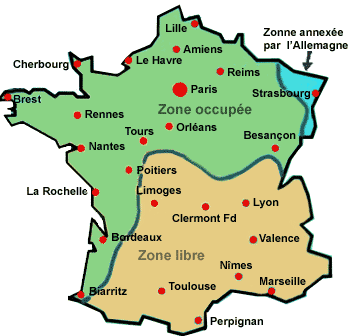 |
A Montpellier il y avait une communauté juive, une université où mon frère pourrait continuer ses études, et c’était également une ville suffisamment importante pour que mon père ouvre un nouveau magasin. Montpellier se trouvait en zone dite libre. Nous y avons passé deux années relativement calmes et en avions gardé de très bons souvenirs. Il n’y avait pourtant rien à manger : on avait beau aller chercher du ravitaillement, il n’y avait absolument rien. De plus, les cartes de rationnement étaient très limitées et ne permettaient pas d’obtenir suffisamment de nourriture. Nous nous sommes un peu débrouillés : comme mon père a pu rouvrir un magasin de gros et qu’il était bien apprécié de ses fournisseurs, ils lui envoyaient de la marchandise et alors nous faisions un peu de troc – on échangeait des tissus contre de la nourriture. On était un peu mieux lotis que les autres, on essayait de partager nos petites provisions avec la famille (parce qu’une partie de la famille était venue nous rejoindre à Montpellier) et avec des amis. On ne pouvait certes aider tout le monde, mais on a essayé de faire ce qu’on a pu.
Il y avait à Montpellier une communauté juive très chaleureuse autour du Rabbin Henri Schilli (1907-1975). Il avait de grandes qualités de rassembleur : au sein de la communauté sont arrivés pendant la guerre des Juifs de partout – des Juifs de Belgique, du Luxembourg, d’Allemagne, de Pologne, de Turquie, de Grèce, etc. et il est arrivé, de tous ces gens-là, à faire une communauté unie et solidaire. Le rabbin organisait des cours de kodesh (4) et mon frère s’occupait des E.I. (scouts).
Le Rabbin Schilli, accompagné très souvent de mon frère, allait visiter les camps d’internement qui avaient été installés dans le sud de la France. C’était d’abord le grand rabbin de Strasbourg nouvellement nommé, René Hirschler (5), qui supervisait en tant qu’aumônier tous les camps d’internement du sud après l’invasion allemande. Mais il est arrêté avec son épouse le 23 décembre 1943 à Marseille par la police allemande puis déporté. Après lui, cette tâche sera accomplie par le Rabbin Schilli (de 1943 jusqu’à la libération). Les camps d’internement dans la zone libre étaient sous supervision française. Les conditions d’internement étaient affreuses : il n’y avait aucune hygiène et rien à manger. Des assistantes sociales venaient aider les gens internés dans les camps. Le Rabbin Schilli et mon frère allaient remonter le moral des personnes – femmes, hommes et enfants – ils essayaient d’en faire sortir : ils sont arrivés à faire sortir pas mal d’enfants et même quelques adultes. Grâce à la générosité d’un grand donateur de Montpellier, ils ont pu mettre les enfants dans l’une des propriétés de ce Monsieur et ainsi les sauver de déportation.
Comme toutes les bonnes choses ont toujours une fin, à partir du mois de novembre 1942 les Allemands occupent la zone sud. Nous habitions par hasard dans une rue qui menait à la garnison militaire, et nous avons vu le Général Leclerc partir avec tous ses soldats. Alors on s’est dit "il faut partir aussi !" – d’autant que des rumeurs circulaient disant que les troupes allemandes se concentreraient dans les zones côtières. Dans notre départ précipité, nous avons une fois de plus abandonné notre appartement ainsi que plein d’affaires à Montpellier. Nous sous sommes rendus à Brive-la-Gaillarde dans le Limousin parce que j’avais un oncle et une tante qui y habitaient.
Lorsque nous sommes arrivés à Brive et que nous nous sommes renseignés auprès des habitants pour trouver la rue où habitait mon oncle, c’est un Allemand qui nous a répondu. Les Allemands occupaient déjà toute la zone sud. A Brive nous n’étions pas heureux, nous n’avions pas trouvé de logement et étions à l’hôtel. J’étais moi-même malade – j’allais quelques jours à l’école, puis restais à la maison plusieurs semaines en raison de mon état de santé.
L’ambiance à Brive n’était pas agréable à vivre, alors nous l’avons quittée et commencé à errer de ville en ville, à la recherche d’un autre endroit sûr ou nous serions en sécurité. Nous sommes d’abord allés à Saint-Flour (dans le Cantal en Auvergne), puis à Millau (dans l’Aveyron).
Dès l’été 1942, quand les Allemands décident de rafler les Juifs étrangers, mon frère a commencé à les cacher. Il leur trouvait des cachettes et aidés par des jeunes scouts, il leur apportait à manger. Mais par la suite ce travail a été coordonné sur un plan national par les E.I, notamment par la "Sixième" (6) Les E.I. de la Sixième ont caché énormément d’enfants, ils en ont fait passer quelques-uns en Suisse, et en ont caché un peu partout : dans des internats et des couvents, dans des fermes ou des fermes-écoles, dans tous les lieux possibles ou ils pouvaient être en sécurité, à l’abri des Allemands. Il y a eu des gens formidables, y compris de non-Juifs, qui ont aussi aidé. Ces enfants cachés sont demeurés juifs, même s’ils devaient parfois et dans certaines circonstances se comporter en chrétiens (aller à la messe le dimanche, étudier dans des écoles chrétiennes, habiter en internats pour filles ou garçons chrétiens, vivre dans des couvents, etc.) afin de tromper la vigilance des Allemands.
Les Allemands ont arrêté un jeune de la Sixième. Il a été interrogé et a dû leur révéler, certainement sous la torture, les actions clandestines de l’organisation ainsi que l’identité de ses membres actifs. Il leur a aussi donné le nom de mon frère. Les Allemands sont venus tout de suite le rechercher à la maison. Mon frère se sentant en danger, avait pris ses précautions et quitté le domicile familial. Il s’est pris un petit studio à l’écart de la famille. Mais Millau était une petite ville et tout le monde savait que nous étions ses parents. La milice, la gendarmerie et les Allemands venaient à tour de rôle chez nous – presque tous les jours – fouiller la maison et nous interroger. Ils ont continué à venir fouiller plusieurs fois notre domicile mais n’ont jamais rien trouvé, bien qu’il y ait eu chez nous des faux-papiers : on les avait dissimulé dans des pages de livres.
Dès qu’on a pu, nous sommes aussitôt partis. J’ai préparé mon premier baccalauréat dans ces conditions-là. Je n’ai pas pu poursuivre ma scolarité parce que j’avais entretemps changé de nom : je n’avais en fait en ma possession aucun document officiel émis sous mon "faux" nom, attestant que j’avais obtenu mon baccalauréat et que j’ai eu jusque-là une scolarité normale. Sur ma "fausse" carte d’identité, je portais le même nom de famille que mon frère, alors que mes parents avaient sur leur carte un autre nom différent du nôtre. En cas d’arrestation, nous pouvions passer mon frère et moi pour des orphelins.
En fait, c’est grâce à la gentillesse d’une employée de la Municipalité de Dieulefit (commune du département de la Drôme en région Rhône-Alpes), que nous avons pu obtenir de nouvelles (fausses) cartes d’identité qui étaient enregistrées dans le registre d’Etat Civil de la commune. Dieulefit est un petit village bien connu où les habitants (à majorité protestants) ont beaucoup aidé les Juifs. Certains des habitants du village ont été reconnus après la guerre comme "Justes parmi les Nations."
Nous avons continué à nous cacher. Nous évitions de circuler en train ou en bus car il y avait des contrôles réguliers dans les gares, sur les routes et les stations de bus. Mon frère a repris ses activités à la Sixième mais cette fois-ci depuis Clermont-Ferrand. Mes parents et moi nous sommes rendus à Vic-sur-Cère dans le Cantal. Il y avait là-bas une maison d’enfants ouverte par l’OSE (OEuvre de Secours à l’Enfance) et dirigée avec l’aide de la communauté protestante. Dans cette commune vivaient beaucoup d’enfants juifs cachés. J’étais monitrice au centre d’accueil pour enfants et habitaient sur place avec eux, mes parents logeaient quant à eux à l’hôtel. Le matin j’accompagnais les enfants à l’école du village et ensuite je passais dire bonjour à mes parents. Un jour quand j’arrive à l’hôtel, mes parents me disent : "file vite, les Allemands vont nous emmener, ce n’est pas la peine que tu sois prise aussi !" Les Allemands sont effectivement venus : "préparez vos valises, on vous emmène !" nous disent-ils. Mais par chance ils m’ont laissé sortir sans faire attention à moi. Par miracle, ils ne sont pas revenus chercher mes parents et on n’a jamais su pourquoi.
Nous sommes partis tout de suite à Murat (dans le Cantal en Auvergne). Il y avait à Murat une femme extraordinaire issue d’une famille protestante originaire des Cévennes, nommée Alice Ferrières (1909-1988), qui a sauvé beaucoup de gens pendant la guerre. Elle était professeur de mathématiques au collège de jeunes filles de Murat. Elle a pu ainsi cacher des filles juives à l’internat de l’école. Elle est arrivée à convaincre la directrice de l’établissement où elle enseignait ainsi que le directeur du collège des garçons, et certains de ses collègues de l’aider. Commence alors son action clandestine d’aide aux familles juives réfugiées : les enfants sont placés dans des familles des campagnes alentours, elle cache aussi des adultes à Murat et dans les campagnes environnantes – dans des fermes ou dans des maisons, elle essaie de trouver du travail à des Juifs allemands, leur fait obtenir de faux papiers, etc. Elle organise des offices juifs et fait donner des cours d’hébreu dans sa maison. Tout le monde dans la commune savait ce qu’elle faisait mais on avait tellement de respect pour elle que nul ne l’a dénoncé.
 |
Plusieurs mouvements de résistance l’ont contactée pour qu’elle se joigne à eux mais elle refusait toujours. Elle faisait tout par elle-même, par ses propres moyens et ses propres méthodes. Elle a adressé des lettres aux autorités juives qu’elle connaissait : au rabbin de Clermont-Ferrand, de Nîmes, de Montpellier, afin de leur proposer son aide. Elle expédiait aussi des colis avec des vêtements et de la nourriture dans les camps d’internement (à Gurs, Noé, Rivesaltes, La Guiche, etc. où étaient cantonnés des Juifs français et étrangers) qui rencontraient des difficultés en ravitaillement. En raison de son efficacité, elle a été sollicitée par beaucoup de gens. Cette femme a écrit ses mémoires dans lesquels elle partage ses souvenirs de guerre : elle a conservé toutes ses lettres et les brouillons des lettres qu’elle écrivait, toutes ses correspondances. Elle a également tenu, entre 1943 et 1944, un journal dans lequel sont consignées toutes ses activités. Après le décès de Mademoiselle Ferrières, le recueil de toutes ses collections de documents historiques datant de la guerre a été conservé au Mémorial de la Shoah à Paris et publiés par la suite (7).
Après tous nos déménagements, nous sommes arrivés au Mont-Dore (également en Auvergne dans le département du Puy-de-Dôme) où nous avons passé les derniers mois de la guerre jusqu’à la libération (8). Nous essayions d’être discrets et nous efforcions de ne pas être perçus comme des Juifs. Bien qu’il y ait des Juifs au Mont-Dore, nous sommes restés à l’écart de la communauté pour éviter de nous mettre en danger (la solution finale pour l’extermination de tous les Juifs des camps avait été décrétée par les Nazis). Nous ne sommes même pas allés chercher des matsoth à Pessah cette année-là. Nous avons chanté à voix basse ce que nous connaissions par cœur du Seder. Mon frère avec des copains nous ont rejoints pour la fête. Nous étions logés dans une grande maison où il y avait beaucoup d’appartements loués aussi par d’autres familles juives, et tous les matins pendant la semaine de Pessah, j’allais apporter à tous nos voisins une assiette de pommes de terre rôties que ma mère avait préparées. C’est tout ce qu’on pouvait manger en substitution de matsot.
Quelques temps après, ma mère a subi une grosse opération à Clermont-Ferrand, qui l'a ensuite beaucoup affaiblie. J’allais moi-même souvent en vélo depuis Mont-Dore jusqu’à Clermont-Ferrand (9) (ville départementale du Puy-de-Dôme) pour chercher des faux papiers pour des oncles et tantes.
Au moment du débarquement, mon frère et ses copains se sont réunis chez Mademoiselle Ferrières afin de décider de ce qu’ils allaient faire. L’ordre donné par les responsables du mouvement E.I. et de la Sixième, était pour les garçons de rejoindre le maquis ou le F.F.I. (Forces Françaises de l’Intérieur) (10) ; tandis que les filles pouvaient quant à elles continuer à aller visiter les enfants cachés. Cette entreprise était devenue en réalité trop dangereuse pour les garçons qui encouraient de grands risques d’être repérés puis attrapés – ils devaient limiter leur circulation en ville. Un couvre-feu était aussi imposé le soir et empêchait les gens de sortir la nuit. On pouvait se faire prendre n’importe où et à n’importe comment. Certains jeunes E.I. se sont fait attraper – dont mon propre frère – et personne ne sait ce qu’ils sont devenus. Ce n’est qu’après la libération que les familles ont fini par découvrir ce qu’a été le sort de ces jeunes. On m’a fait venir à Clermont-Ferrand pour m’annoncer cette triste nouvelle. Je devais me charger d’en informer mes parents et mon grand-père.
Quand le midi de la France a été libéré, nous sommes retournés à Montpellier. On ne pouvait pas encore rentrer en Alsace jusqu’à la signature de l’armistice (du 8 mai 1945, marquant la fin de la guerre en Europe). Puis nous sommes rentrés à Strasbourg. Il fallait tout reconstruire. De retour à Strasbourg, je me suis occupée des éclaireuses de toute la région. Je n’ai pas pu reprendre mes études parce que je devais aider mon père à tenir le magasin : mon père était tellement déprimé par le décès de mon frère, et par celui de ma mère survenu peu après en 1946 – il n’était plus capable de diriger tout seul son magasin et j’ai donc dû rester travailler avec lui. Certains juifs alsaciens ont quitté Strasbourg pendant la guerre et ne sont jamais revenu dans cette ville. Ils ont préféré s’installer ailleurs.
Les années post-guerres seront consacrées à la reconstruction de la communauté juive d’Alsace et de Lorraine, décimées par les atrocités nazies. Sur les dix milles Juifs qui vivaient à Strasbourg avant la guerre, ils sont seulement huit mille à y revenir après la Libération : mille d’entre eux périrent en déportation, et un autre millier décida de s’installer ailleurs. C’est le Grand Rabbin Abraham Deutsch (1902-1992) – succédant au Grand Rabbin René Hirschler (1905-1945), déporté à Auschwitz – qui fut chargé de reconstruire la communauté éprouvée et disloquée. Après la guerre, la Grande synagogue consistoriale située quai Kléber étant rasée, les Juifs de retour à Strasbourg vont tous prier dans la synagogue de la rue Kageneck. Quelques années plus tard, en 1954, commencent les travaux de construction de la Grande synagogue de la Paix – située rue de la Paix près du parc des Contades.
Notes
- La ligne Maginot était une ligne de fortification construite par la France de 1928 à 1940, le long de ses frontières avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l’Italie et l’Allemagne. Retour au texte.
- "Boche" est un mot péjoratif de la langue française servant à désigner un soldat allemand ou une personne d’origine allemande. Son utilisation remonte à la première guerre mondiale mais a persisté jusque bien après la seconde guerre. L’usage de ce mot, devenu rare et plutôt familier aujourd’hui, peut être considéré comme injurieux.. Retour au texte.
- Les zones d’occupation allemande en France de 1940 à 1944. Initialement à partir de juillet 1940, le pays est coupé en quatre : la zone occupée, la zone libre (séparées par une ligne de démarcation), l’Alsace-Moselle annexée de facto par le Reich, et deux départements du Nord sous l’administration militaire allemande de Bruxelles. Mais en novembre 1942, en réaction au débarquement allié en Afrique du Nord, la zone occupée allemande s’étend désormais de la zone initiale (dite "Zone Nord") à laquelle s’ajoute la majeure partie de la zone libre (dont l’appellation devient alors "zone sud"). Simultanément, l’Italie occupe la plupart des territoires à l’est du Rhône et la Corse. Les Italiens se retirent en octobre 1943 et la zone occupée allemande s’étend alors à tout le pays. Au cours de l’été 1944, plus précisément à partir du 6 juin, la plus grande partie du territoire est libérée par les forces alliées et de la Résistance.. Retour au texte.
- cours de kodesh : enseignement d’instruction religieussur des thématiques juives.. Retour au texte.
- René Hirschler reçoit son investiture en juillet 1939 comme grand rabbin du Bas-Rhin, succédant à son prédécesseur le grand rabbin Isaïe Schwartz nommé alors grand rabbin de France.. Retour au texte.
- En septembre 1942, création au sein du mouvement E.I. de la "Sixième", organisation clandestine de sécurité, d’auto-défense, de planquage et de fabrication de faux papiers. Elle se divise entre la section nord ou "Sixième nord" (terrain d’action dans la zone occupée au nord de la France) et la section sud ou "Sixième sud "(terrain d’action dans la zone libre puis occupée au sud de la France). Cette organisation sauvera des milliers d’enfants et de jeunes juifs, jouera un rôle important au sein de la résistance : sabotage de trains transportant des soldats allemands, participation à la libération de Castres en août 1944, ainsi que d’autres actions de bravoure.. Retour au texte.
- CABANEL, Patrick. Chère mademoiselle… : Alice Ferrières et les enfants cachés de Murat. Paris, Calmann-Lévy, 2010.. Retour au texte.
- J’ai un jour calculé que nous avions déménagé en tout treize fois pendant la période de guerre.. Retour au texte.
- C’est d’abord à Clermont que se replie le gouvernement après la signature de l’armistice du 29 juin 1940. Pour quelques jours, la capitale de l’Auvergne est aussi la capitale de la France, avant qu’il ne se replie sur la ville voisine de Vichy. Plusieurs ministères ainsi qu’un certain nombre d’administrations gouvernementales resteront encore sur place. Clermont-Ferrand accueille également l’Université de Strasbourg, chassée de la capitale alsacienne par les autorités nazies qui y ont installé la Reichuniversität Straßburg (après l’annexion de l’Alsace au Reich).. Retour au texte.
- Nom donné en 1944, par le Comité français de libération nationale, à l’ensemble des formations militaires des mouvements de résistance.. Retour au texte.
 |